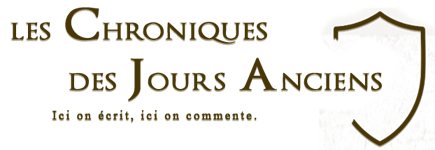Un fragment d'apocalypse qui est aussi un peu une réponse au pitch proposé par San (http://www.les-chroniques.eg2.fr/forum/10-la-taverne/17610-une-idee-pour-ecrire.html), le "switch". Je ne respecte pas toutes les contraintes données puisque ce n'est pas le narrateur qui change de sexe, il n'est que témoin.
**
A mon reveil, elle était devenue un homme. Dans la pénombre et l'ombre de la fenêtre du matin de la ruelle, où des réverbères s'accrochaient les tiges hautes de lierre et de vigne vierge. Dans la pénombre elle dessina l'ombre massive d'un homme dans la force de l'âge, de ses hanches disparues les rondeurs, de ses épaules la fragilité évanouie sous la rigueur costaude des omoplates.
Il me sourit. Il n'était pas rasé et je remarquai ce détail comme j'en avais remarqué tant depuis hier soir, comme j'avais remarqué la douceur de ses joues et par-dessus elles les boucles brunes de cheveux descendant jusqu'au coin inférieur de la mâchoire, coin que j'aimais mordre et lécher tant qu'il m'abreuvait. Ce matin-là, dans la pénombre, il n'était pas rasé, et sous la douceur naissait la fermeté. Alors il ne savait pas que je ne dormais pas, ou que je ne dormais qu'à feindre, que des années de fugue m'avaient appris à voir derrière les paupières, à ressentir, mieux que les formes, les impressions et les traînées d’ombre, à leur lente et pleine masse d’argile reconnaître les hommes et à la légèreté de leur tracé reconnaître les femmes. Il ne sut pas que je le voyais me sourire, du même sourire d'arpège, intact lui, qu'elle m'avait adressé lors de notre première rencontre.
Dans la pénombre et l'ombre de la fenêtre du matin de la ruelle ses traces s'envolèrent et je ne pu en garder que les sensations, trop fugaces et pourtant gravées, profondément gravées en portraits négatifs au dessin lisse que je reproduisais aussitôt son départ au fusain sur le papier laissé sur le bureau, ou la table de nuit, ou l'ancien guéridon. Le fusain était craie et le papier ardoise. Les blancs s'exhibèrent en noir, et les noirs en blancs comme je cherchais la mémoire de cette silhouette. Les épaules carrées ne pouvaient qu'être celles d'un homme, et même alors j'hésitais au tracé, j’hésitais aux masses, j'hésitais à la reproduction des gestes, à l'exactitude du levé, à la position précise de la cuisse nue, dans l'ombre blanche. Le dessin achevé, je glissais le papier dans ma poche. Je m'habillais. La rue sombre et vide, comme le village.
Je ne cherchais pas à le suivre. Cela n'aurait pas eu de sens, car j'avais gardé son image qui me suffisait, même en négatif. Hier, elle ne m'avait rien volé comme je l'avais craint d'abord en la voyant attendre au bord de la margelle. Alors il me restait les provisions du jour et du lendemain, et même du surlendemain, et une ration d'eau pour atteindre le prochain bourg où allait se remplir le vide. En revanche, en partant ce matin – je l'avais laissé faire – il m'avait pris mon vélo, robuste aux pneus adaptés aux chemins de terre du village au bourg, pour me laisser le sien trop lisse. Je me trompais ; il me fut suffisant. Le soleil du matin séchait la boue de la pluie et je n'eus qu'à suivre les ornières tracées.
En vue du bourg, je ne pensais plus à lui. La pluie reprit pourtant.
Au bourg convergeaient les commerçants ambulants, les colporteurs, les marchands de ferraille, les vieux paysans solitaires qui élevaient encore des bêtes. Plus personne ne vivait au bourg mais de ses ruines renaissaient tous les deux jours un marché qui semblait comme au temps d'avant l'Apocalypse. Les échoppes s'établissaient dans l'espace laissé libre par de grandes baies vitrées, le moindre muret devenait un étal ou un banc et le goudron des vieilles rues, fissuré par endroits, s'affaissait très lentement au pas des nomades venus de partout pour participer à la résurrection du vieux bourg. Tous ici traitaient le vieux bourg avec déférence, et moi qui d'ordinaire évitais les foules repoussait l'herbe grimpante aux marches de fer et m'y assis.
Il n'était pas là. Je ne l'avais pas suivi.
Pourtant, elle m'avait dit aimer, elle aussi, les places anciennes et y voir s'animer comme des fantômes d'êtres routiniers d'avant l'Apocalypse. En venant jusqu'ici peut-être avais-je cru la trouver elle, oubliant que ce n'était plus elle. Je sortis mes plaques et mon burin, je sortis ma cuve et mon papier, je sortis le chiffon sale et le pinceau tâché, et commençai ma besogne.
« Portraits ! Portraits ! Votre portrait gravé ! »
La femme s'accroupit à mon niveau des marches. J'écartais les lichens pour ne pas tâcher sa robe ni son profil qu'elle présenta. Commença ma besogne.
J'appliquais le vernis au pinceau. La plaque de cuivre au contact du burin peu émoussé grinça et siffla puis se tut. Les premiers traits souvent étaient difficiles, puis venaient l'habitude et la patience et le tracé venait de lui-même. Le profil était sobre, sans variété, linéaire, le nez à peine arqué et les cheveux en frange régulière au front sans fioritures, sans rubans, sans arceau, sans peine je capturais la bouche qui se mit à parler.
« Comment vous appelez-vous ? »
« Je suis le marchand de visages. »
« Oui, mais votre nom ? Votre identité ? »
« Personne ne l'utilise. »
Le rythme des lèvres déviait le burin, et les fausses entailles m'obligeaient à sortir le diamant à polir avant de recommencer. Je voulus qu'elle se tût mais elle parlait.
« Que voulez-vous contre le portrait ? »
« En général, je demande une conserve, ou du frais, quand le client à l'air à l'aise. Mais vous n'avez pas l'air à l'aise. Vos traits sont gracieux sans être beaux, sans être extraordinaires. Ils n'ont pas de charme. Je n’y trouve pas de grâce. »
« Et vous, croyez-vous que vous avez du charme ? »
« Je ne demande à personne de me dessiner. »
Les lèvres s'arrêtèrent. Je crus avoir capté la ligne qui se recourbait pour la huitième fois.
« Vous avez raison. Vous aurez une conserve. A moins que vous ne souhaitiez autre chose que seule une femme peut vous apporter. »
Les lèvres se fermèrent, se raidirent, se calmèrent enfin pour que je puisse en suivre la ligne. Il me restait à accentuer les rides au coin, et volontairement je laissai sa question en suspens pour achever la gravure.
Encore quelques traits et je lui répondrai. Encore les reflets de la chevelure et la percée des sourcils, par touches.
« Je prendrais la conserve. Le reste, je l'ai déjà eu aujourd'hui. »
Les lèvres s'enclôsèrent encore davantage, mais cela ne m'importait plus car j'avais terminé de graver. Je plongeai la plaque dans l'eau-forte. L'acide pénétrait et fondait le vernis.
« Qui ? »
Les lèvres avaient à peine bougé. Je lui montrai l'ardoise.
« C'est à l'envers. »
« Il faut imaginer les blancs en noirs. »
Les sourcils se froncèrent et s'enfoncèrent encore dans le noir de l'ardoise, dans l'empreinte de ce matin. Les mains, absentes jusqu'ici, s'agitèrent.
« Je le connais ! »
Elle me tendit la conserve et me demanda :
« Quand l'avez-vous vu ? Où l'avez-vous vu ? »
Elle s'empressait, maintenant tout son corps bougeait d'un bond et vers moi qui tenait la plaque de cuivre à mi-doigt, au-dessus du pinceau d'encre.
« Vous ne voulez pas voir votre visage d'abord ? »
L'encre se déposa dans les creux du cuivre. Elle s'allongeait lentement, suivait une courbe inattendue, hésitant vacillant entre deux traînes ; quand elle fut décidé sur sa forme j'appliquai le papier et fermai la presse.
« Prenons le chemin pendant que votre visage s'imprime. Nous parlerons. »
Elle me suivit. Après quelques pas la foule était loin.
« Comment l'avez-vous rencontré ? »
Je commençai mon histoire.
« Elle n'était d'abord qu'une silhouette que j'avais aperçue depuis la colline, immobile sur la place du village je crus à une statue quand un bras bougea, et une jambe, et ce ne pouvait pas être un marbre. Jamais je n'avais vu quelqu'un dans ce village où je m'endors, et encore moi sur la place si parfaitement ronde, comme l'ombre du soleil, quand je reviens du bourg avant le coucher. Je n'avais vu personne d'autre que les oiseaux migrateurs, et eux s'envolaient quand j'arrivais, en courant, depuis le haut de la colline, pour les effrayer. Elle n'avait pas bougé. La femme au centre de la place me dévisageait. J'arrêtai ma course à moitié de colline.
Le temps que je perdis à chercher mon burin et mon cuivre, elle avait disparu. Je traçai le cercle de la place, les rayons des moellons grossiers de pavés sales, les orifices des pierres et les trouées du sol par endroits. Un parterre de bosses et d'élévations dans une perspective faussée par l'afflux soudain du soleil du soir.
Voyez-vous, le soir les ombres du soleil sont autant d'intrigantes ; elles se cachent sous les toitures remplacent les tuiles manquantes effacent les poutres et recouvrent la place comme d'une fausse perspective, et l’animent. Et je crus que la femme de la place n'était qu'une de ses ombres. Vous l'auriez cru aussi, et même encore davantage comme vous ignorez les tracés en chaque heure ici. »
« Non, je l'aurais reconnu, votre femme de la place. Je l'aurais reconnu car je la connais. »
« D'où la connaissez-vous ? »
« Finissez d'abord votre histoire. Je veux m'assurer que nous parlons bien de la même personne. »
Je continuai mon histoire.
« Sur la feuille s'imprimait le dessin de la place au sortir du soleil. Les ombres bougeaient lentement, mais quand je voulus comparer la nuit était déjà là. Il y avait trop d'ombres. Je descendais de la colline.
J'habite dans la troisième maison de la rue la plus vaste autour de la place du soleil. C'est la seule maison à avoir tenu. Elle possède encore ses quatre murs joints et son toit, et sa porte même ses gonds. La cheminée tire et le lit est intact. Je vous y emmènerai une fois que nous aurons terminé nos histoires. Ce soir-là – à peine encore le jour perçait derrière quelques fenêtres – je devinai sa présence car dans le noir il y avait plus d'ombres qu'avant dans la maison aux murs joints. Trop d'ombres dans la cuisine où je faisais chauffer, sur le poêle en fonction, la conserve du jour ; trop d'ombres dans la véranda envahit de fleurs vivantes ; trop d'ombres enfin surtout à l'étage où était le lit intact. Dans chaque pièce le décompte m'affolait. Je ne croyais pas aux fantômes mais ce soir-là j'y croyais. Sur le pas de chacune des portes je dispersais de la poudre de charbon de bois pour lire leurs traces. Moi je m'asseyais, contre le poêle.
Le charbon dessina des pas. Des pas petits. Des pas étroits, entre les miettes noires amoncelées. Des pas qui contredisaient les ombres en éclairant le sol de petites taches brunes claires, au fur et à mesure. »
« Là ! Il est là ! »
La femme glissa le long du poêle pour s'accroupir à nouveau, et son doigt étendu du bout du bras désignait l'encoignure de l'escalier droit aux marches de bois. Un peu du charbon s'y déposait, au fur et à mesure.
« Nous l'avons retrouvé, je crois. Il est encore chez vous. »
« Mais... Je n'ai pas fini mon histoire. »
« Il faut le suivre ! »
Les pas de charbons étaient lourds et épais. Il était toujours homme, car une femme ne laisse pas de telle trace. Elle monta. Je restai au bas des escaliers.
« Vous ne venez pas ? »
« Non, je veux terminer mon histoire. »
« Votre histoire est terminée. La mienne arrive déjà. Elle court derrière. Elle nous rattrape. »
Ce soir-là les traces étaient légères et m'attirèrent à monter avec elle. Jamais je n'avais eu de visiteur dans mon village, et même un fantôme m'excitait profondément, m'introduisait des rêves nouveaux, des traits déviés et suggestifs. Le long de l'escalier la courbe des hanches dansant dans le tissu de la robe d'une pièce apprêtée ; l'échancrure le long du dos jusqu'au lever des omoplates, fines précieuses sous le tissu de la robe, noire, à moins qu'elle ne soit blanche. Comme je me mis à courir elle s'arrêta, et moi avec elle. Il est inutile de se presser ainsi, il suffit d'avancer pas à pas, marche à marche, au rythme du jour. La nuit ne va pas s'échapper. La nuit garde le temps à sa merci et permet de vivre éternellement.
J'obéissais à ses ordres muets en entendant craquer le bois des marches. En paroles elle me dépassait. L’histoire qu’elle racontait maintenant dépassait mon espace.
La nuit dans le village vide et sauvage n'appartient pas au temps traditionnel. Il est le territoire des rêves, et des fantômes. Il est le territoire où les ombres jouent à créer et font de la margelle un clair de Lune, des tuyaux éclatés au milieu de la rue les rameaux d'un jeune manguier, de la cheminée effondrée le nid d'un calao, endormi encore. Les lianes poussent à toute allure et couvrent les briques en cascade de fleurs de la passion, bientôt écloses en bourgeons fruitées. L'eau coule proche, la chaleur monte, les rochers s'érodent sous le flot. Les chants sont lointains mais gais à la lueur d'un feu qu'on ne fait que sentir, en attendant la pluie. Il faut trouver refuge sous la palme gigantesque, ou sous le promontoire avec les autres bêtes qui ont peur de l'orage. Tout le monde craint l'orage, mais tout le monde le vénère ici. C'est un soir d'orage qui sent la pluie.
Le linge a mouillé sur ma peau, et je sens le rythme de mon coeur aux tressautements de ma poitrine sur le tissu, sur le tissu de la chemise blanche déboutonnée d'en bas. Il pleut trop, et la chaleur étouffe le village qui n'est plus déjà. Le promontoire dessine un chemin de pierraille fraîche, comme si là le temps n'échauffait pas le sol, et comme si l'air chaud s'amenuisait au contact des marches de granit naturel. J'escalade à mains nues et l'eau apaise les ampoules qui se forment sur mes doigts. Les rougeurs s'exhibent, et les reflets bleutés du ciel de nuit d'orage à la lueur du reflet de Lune capturent le blanc de mes ongles courts, taillés de près. A la force de mes bras, forçant sur mes puissantes omoplates, je me hisse en haut du promontoire. De là-haut, même si la pluie atteint et masque la vue se fait nette entre les gouttes énormes de l'averse tropicale. J'ai vu distinctes les dernières flammes éteintes et les derniers chants montés qui étaient des cris de surprise à la venue de la pluie, comme des cris d'animaux comme envolés à la colère des dieux, si les animaux ont des dieux et s’ils y croient. En contrebas de la colline le bassin rond de Lune pleine, et en son centre comme ce qui serait une sirène. Je suis venu de loin, j’ai marché longtemps dans la jungle pour trouver ce bassin et y trouver la vie, voire plus. De mon sac en toile, je sors l'appareil photographique. Abrité sous le tissu, il n'est pas trop humide. Mais le temps que je règle l'objectif la sirène est parti. Maintenant je peux dévaler la pente, atteindre le bassin sacré.
Dans l'eau des tourbillons, qui sont autant de masses claires imposées par le rythme puissant de la pluie d'orage. L'eau se trouble. Tout se trouble. Ma vue avec. Je remarque au centre de l'eau quelques débris de charbon de bois encore bouillants d'un feu récent, déclenché près d'ici. Ce feu aux chants joyeux que je suivais sous le promontoire avant la pluie. Les chants parlent de l’éternité qui loge depuis toujours dans le bassin. L’éternité se transmet comme un trésor, et comme une malédiction. Ici les chants le savent qui ne s’épuisent jamais et se transforment toujours. Les voix aigues s’aggravent, les basses s’amenuisent. La légende d’ici dit que le secret de l’éternité est dans la transformation permanente du monde. La légende est naïve à nos yeux, une métaphore enfantine pour comprendre la science avec des mots de poète, mais crédible ici comme tonne l’orage et comme luit le bassin.
Comme mes yeux s'habituent aux forces conjuguées et trompeuses de la nuit et de la pluie, je remarque que le bassin est un puits rond de pierres lourdes et gravées. De loin les arbres d'où l'eau dégouline tracent des canalisations infinies, des conduits imbriquées qui se joignent par endroits. Le vaste promontoire, dont m'étonnaient les reliefs déchirés par les dents d'un géant, est l'avancée sommaire du toit effondré de l'immense bâtisse municipale. Simplement les herbes ont-elles jailli pour l'habiter.
Il me vient alors qu'ici des hommes ont vécu un jour, et peut-être même avant la pluie dernière, quand le feu chantait encore au milieu du puits. Les hommes et les femmes qui m’ont transmis le chant et avec eux ont évanoui la science sous l’orage. Je m'assois sur la margelle du bassin pour y passer la main dans l'eau. Elle est froide, si froide qu'il me prend de m'en étonner. Si froide qu'il me prend d'en boire.
La lune captive se débat au rythme des gouttes. Elle m'avertit, et avec elle la jungle qui tremble. Des fruits trop mûrs s'écrasent au sol. Des branches cassent sans que l'éclair, lointain, les ait touchées. Les lianes se rétractent le sol éclate des dalles se soulèvent les briques se fissurent en forme d'éclair dont l'ombre s'est gravé jusqu'ici. Le déluge ne s'arrête pas et la force de la pluie fait craquer les derniers toits encore debout. C'est l'Apocalypse, la forme ultime de la transformation.
Je sens sous ma poitrine gonfler des seins, sous mes hanches s'arrondir un bassin large et fertile, sur mon visage les traits s'affiner et la barbe rétrécir jusqu'à disparaître. Mes pas se font si légers que je ne les sens plus. Dans les marches de l'escalier je trébuche, indécise.
L'éclair passa par la fenêtre sans pénétrer la maison. Il n'avait été qu'un écho fugace éclairant la chambre d'une ombre assise au coin du lit. Elle se tut enfin. Elle m'aida à me relever. Elle avait raison : il ne fallait pas se précipiter, tant les marches sont trompeuses. Elle conclut enfin son histoire :
« Voilà exactement ce qui s'est passé. La jungle. L'orage. Le bassin. Certaines légendes humaines d'avant l'Apocalypse évoquent des fontaines de jouvence, qui rendraient la vie éternelle. Il m'est arrivé d'en entendre quand je parcourais des régions plus méridionales, celles où les pluies de cette ampleur sont fréquentes et agitent la tête des hommes. La fontaine de jouvence est le mythe éternel, celui que tout le monde espère et craint en même temps, car qui voudrait vivre pour toujours ? Qui ose penser aux conséquences, aux concessions que cela impose ? Peu d'histoires s'attardent sur le bassin chaotique qui ensorcelle les corps et fait d'une femme le jour un homme, et d'un homme une femme la nuit, comme le prix à payer pour que l’autre légende, la jouvence, se réalise. Et ce ne sont souvent que des récits mêlés, sans cesse interrompus car tout se mêle et se fond dès qu'est avalée l'eau. L'homme et la femme. La jungle et le village. La nuit et le jour. »
La masse et le tracé. Il faisait nuit à présent. Les traits du jour ne portaient plus. L'homme se leva du bord du lit pour ouvrir la fenêtre. Dans la pénombre j'observais la ligne de ses épaules, comme une obsession infernale, pour m'assurer encore du sexe de mon invité.
« Nous étions deux quand nous avons trouvé le bassin. Mais il s'est enfui avant mon réveil. Je me retrouvais seule dans un matin brûlant, de ceux qui succèdent aux pluies nocturnes, et qui sèchent en quelques heures la terrible inondation. Je pense qu'il est devenu fou de ne plus pouvoir contrôler son corps. Je pense qu'il cherche à semer le désordre où il passe, dans les villages. Et, quand il en trouve, dans les esprits la confusion. Mais je crois que votre village tient encore debout après son passage. »
L'homme prit la robe noire jetée au pied du lit dans la confusion de la nuit passée. J'hésitai à poursuivre un récit qui allait m'enfoncer dans la crainte. L'homme prit la parole et anticipa mon souvenir.
« Il était belle, n'est-ce pas ? En tant que femme, il est bien plus belle que moi. En tant qu'homme aussi d'ailleurs. Vous l'avez dit vous-même : mes traits sont quelconques, je n'ai pas de charme, je n’ai pas de grâce, je ne suis pas aussi jolie que lui. Je ne suis pas surprise que vous ayez été attiré par lui. »
L'homme referma la fenêtre. J'entendais maintenant la pluie comme s'il s'éloignait. L'orage s'en allait. Je demandai :
« Où est le bassin ? »
« Vous ne souhaitez pas vraiment le savoir, ou alors vous êtes fou, et je l'ai oublié. Il me faudrait un orage et une pluie aussi forte pour m'en souvenir. Lui le sait sûrement, mais je doute que vous le retrouviez un jour. »
Comme il partait, il me tendit la robe noire.
« Je vous la laisse. Elle ne me va plus cette nuit. Je ne vous souhaite pas qu’elle vous aille un jour. »
J'entendis son pas lourd sur les marches de bois.
Une fois seul dans la chambre, je m'aperçus qu'il avait oublié son visage, conservé précieusement dans la presse portative. D'un geste délicat je détachai les deux morceaux de bois aux chaînons de métal ; je tournais délicatement la vis. A la lumière du jour revenue, j'examinai la feuille.
Les hésitations de la bouche enfoncée d'encre formait le nid d'un grand rapace nocturne, le nez un large promontoire. Et l'oeil, dont toujours je laisse la pupille blanche, était un puits ou était un bassin.