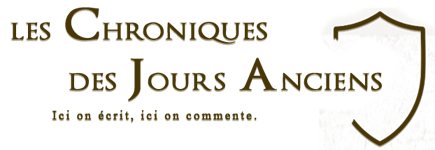Il me faut avant tout justifier ce que je suis sur le point d'écrire. Vous avez dû vous rendre compte de cette part irréductible de confusion dans mes textes, qui les rend illisible malgré des années d'efforts pour l'atténuer. Laissez-moi vous expliquer cette confusion à travers une histoire confuse qui s'est terminée ce matin, qui continuera encore quatre ans et qui remonte aussi loin qu'on voudra.
Commençons donc par les prémisses. En deux mille un, les télévisions s'étaient mises à diffuser les images muettes de tours en flammes, puis d'un avion s'écrasant dessus. En deux mille trois, les lycéens (collégiens, pour la Suisse) se massaient dans les trains en direction de quelque part pour manifester contre une guerre dont ils n'avaient que la plus vague idée. L'Amérique, en ce temps, c'était Bush, un cowboy archétypé et haïssable. Puis, en deux mille huit, on m'explique qu'il y a quelqu'un appelé Obama, qu'il est noir et qu'il va être élu président des États-Unis. À dire vrai, je m'en moque. Mais le personnage promet l'Espoir et le Changement et son message résonne avec une bonne partie du monde. Enfin, février deux mille dix, j'apprends que ce président voit sa réforme de santé sociale en péril. Je commence à me renseigner et ce premier pas dans la politique américaine durera deux ans.
Voilà donc, à travers mon expérience, la présidence de Barack Hussein Obama.
L'histoire commence le jour de son élection. Elle est déjà férocement compliquée. L'Amérique a un président et un Congrès composé d'une Chambre et d'un Sénat. Ce Congrès était déjà passé démocrate, le camp d'Obama, vers deux mille six, et se renforçait encore à l'occasion de la présidentielle. Il y avait eu des primaires dont je ne sais à peu près rien, une crise économique datant de deux mille sept et trente ans de luttes partisanes entre démocrates et républicains, dans un espace politique qui ne connaissait que ces deux partis. Obama élu n'avait qu'une seule tâche, d'où découlaient toutes les autres : mettre fin aux luttes partisanes, mettre d'accord les deux camps.
Avec le recul, c'était impossible. Les défaites de deux mille six, suivies par celle de deux mille huit avaient forcé les républicains à se remettre en question. Il leur fallait déterminer ce qui causait leur manque de popularité. D'ores et déjà l'opinion était qu'Obama avait gagné grâce à Bush, mais cela ne répondait pas à une question fondamentale. Les valeurs républicaines étaient-elles en cause, ou au contraire le parti s'était-il trop éloigné de ces valeurs et en payait le prix ? Selon la réponse, le parti de droite se porterait plus au centre ou plus à droite, soit à la modération soit à l'extrêmisme. L'histoire veut que ce soit le sénateur Mitch McConnell qui emporte la décision, en faveur des valeurs du parti, et propulse le parti dans l'extrême-droite.
Rien n'est aussi simple que cette version romancée où McConnell, au moment où le président prête serment, promet de faire de lui le président "d'un seul terme", cimentant l'opinion des démocrates que le parti républicain n'agira plus que par but politique. En vérité le parti n'est pas aussi soudé, pas encore, et la première tâche d'importance du gouvernement va autant le montrer qu'y mettre fin.
Le stimulus
L'économie américaine est, en février deux mille neuf, en chute libre. Le pays perd en moyenne sept cents mille emplois par mois, environ cinq millions pour l'ensemble de la crise. Sur cent quarante-deux millions de travailleurs mais cette chute emporte le chômage à hauteur de dix pourcent. Déjà l'administration Bush avait pris des mesures pour refinancer les banques et ainsi relancer l'économie, mais ces mesures bien que continuées étaient insuffisantes. La solution, approuvée par les deux partis, était un stimulus économique pour mettre fin à la crise.
La question fondamentale en était la nature. Les démocrates voulaient des dépenses, notamment dans l'infrastructure, dans des chantiers "déjà prêts" qui n'attendaient qu'un financement. Les républicains voulaient des baisses d'impôts. La polarisation, dans le fond, était faible. Le président, avant même son entrée en fonction, avait projeté un plan mêlant dépense et baisse d'impôts, un compromis dont la proportion, à peu près moitié pour chaque pôle, semblait sur le papier devoir satisfaire tout le monde.
Mais le Congrès est démocrate, majorité à la Chambre et majorité écrasante au Sénat. Les démocrates vont donc négocier en leur faveur et obtenir du président un ratio de presque un dollar de baisse d'impôts pour deux de dépense. Et les démocrates eux-mêmes ne sont pas soudés. Une partie d'entre eux, les "chiens bleus" plus centristes discutent de la somme totale, le stimulus atteignant presque neuf cents milliards de dollars. C'est trop. Ils exigent un plafond de huit cents milliards et l'obtiennent. Les républicains n'ont pas encore eu leur mot à dire et ne l'auront qu'après ces deux compromis, du fait de leur minorité et de leur manque de moyens de pressions. Obama est populaire, son soutien est massif, les démocrates n'ont aucune raison d'écouter le parti des perdants. Les républicains vont se sentir délaissés des négociations et, quand le stimulus sera voté, aucun d'entre eux ne votera pour.
Il y a donc une première version où l'écrasante domination démocrate va écarter les républicains, sous l'image populaire de la voiture où les républicains sont "sur le siège arrière". Et cette version est crédible, les républicains acceptant dans l'ensemble le stimulus, son prix, et ne discutant pour l'essentiel que la proportion de baisse d'impôts, qu'ils aimeraient plus grande. Ce n'est qu'en ne pouvant rien obtenir qu'ils commenceront à critiquer les dépenses, jugées inutiles ou scandaleuses, comme les ponts ne menant nulle part ou des programmes douteux pour d'autres pays.
Seul problème à cette version, les propositions républicaines sont affolantes. Ils veulent deux dollars de baisse d'impôt pour un dollar de dépense, parfois le ratio va même à trois pour un et certains proposent d'effacer toute dépense. Or ces propositions précèdent les discussions, avant qu'ils puissent en être écartés. Il est donc loin d'être clair jusqu'à quel point le compromis était possible avec de tels écarts. Que les républicains aient demandé trop ou que la majorité triomphante les ait ignorés, au terme du stimulus les républicains se déclarent déçus par un processus expédié en moins d'un mois. Cette précipitation, aussi, peut expliquer les mésententes produites à cette occasion.
Pourtant, même au terme du stimulus, le compromis semble encore possible. D'autres réformes ont lieu, dont Dodd-Franck, mais elles sont anecdotiques. Le véritable titan dans l'histoire d'Obama, après ce premier sursaut du stimulus, sera la réforme de santé sociale.
Obamacare
Obama veut le système de la caisse unique, une assurance santé gérée par le gouvernment. Cette idée, populaire en Europe, est imprononçable en Amérique. Les États-Unis sont une fédération, une série d'États sous la domination d'un État fédéral dont les pouvoirs sont limités par la Constitution. Pour les républicains, la santé sociale est anticonstitutionnelle. Les programmes Medicare et Medicaid sont aussi, de fait, une cause de déficit dans le budget américain, avec des coûts dépassant le trillion de dollars. Il faut réformer ces programmes pour économiser de l'argent, mais à côté il faut régler le problème de cinquante millions d'américains qui ne sont pas assurés. Les démocrates brandissent des études montrant que les coûts de la santé sont un facteur majeur de faillite pour les citoyens.
Aussi, à l'aube de la réforme sur la santé sociale, les deux priorités sont la baisse des coûts et l'augmentation du nombre d'assurés. Les républicains favorisent la première et argumentent que la baisse des coûts, notamment des primes d'assurance, premettra aux gens de s'assurer. Les démocrates favorisent la seconde et raisonnent de telle manière qu'un assureur qui a plus de clients pourra baisser les coûts sur chacun d'eux. Vers deux mille sept ou deux mille neuf, la fondation héritière, un groupe républicain, avait proposé de créer un mandat tel que le citoyen américain qui n'est pas assuré devrait payer une amende. Obama va se saisir de cette idée pour former le coeur de sa réforme, l'ACA ou acte de soins abordables, dans un compromis que les démocrates apprendront vite à détester.
De fait, comme pour le stimulus, Obama se retrouve à négocier plus avec son propre camp qu'avec les républicains. Les démocrates les plus à gauche veulent la caisse unique promise durant la campagne tandis que les modérés questionnent le mécanisme et la complexité de la loi qui atteindra les deux mille sept cents pages. Mais ce n'est rien face aux républicains. L'idée du mandat a été mal interprétée, son application au niveau fédéral est jugée inacceptable. Les républicains n'offrent presque aucune alternative, sinon isolée, et au grand sommet où les deux camps se rencontrent, et diffusé publiquement, les républicains ne cesseront de proposer une approche "pas à pas" sans aucune autre précision. Ils n'ont pas de plan mais ils ne veulent pas de l'ACA.
Or, en février deux mille dix, un sénateur démocrate a laissé son siège qui sera repris par un républicain. Ce changement ne retire pas la majorité des démocrates au Sénat mais offre aux républicains juste assez de sièges pour empêcher une loi d'être votée. Ils peuvent donc paralyser le Sénat et, donc, empêcher l'ACA d'être votée. Cela, ajouté aux divisions de son propre parti, force l'administration d'Obama à convaincre au moins trois républicains à soutenir sa réforme, d'où le sommet qui sera un échec. Le responsable de la Chambre, Boehner, sera parmi les derniers à y parler, et lorsque viendra son tour de parler il ne fera que critiquer le texte de loi, le président et l'ensemble du processus en cours. Le compromis est devenu impossible.
Pour passer outre, l'administration de la Maison Blanche envisage la réconciliation, un processus complexe qui permettrait de contourner le bloquage des votes au Sénat. Ce choix met fin à des discussions qui n'avaient déjà plus cours, chaque camp dénonçant l'autre d'abandonner la table des négociations. Le déroulement chronologique est incroyablement confus et la loi ne cesse plus d'évoluer. Le public n'y comprend rien, s'inquiète et la loi devient impopulaire. Un mouvement de fond, le Parti du Thé inspiré de la révolution américaine, se soulève en réponse aux efforts pour passer cette loi.
Je ne saurais trop souligner à quel point la loi est complexe. Un simple exemple. Au sein de la loi se trouve une provision autorisant les États à ne pas appliquer le mandat de la loi si ces États arrivent à mettre en place une réforme au moins aussi efficace, en termes d'assurés et de coûts.
Enfin, vers juin, la loi est votée à travers le processus de réconciliation des deux chambres du Congrès. Les républicains s'y opposent en bloc, le peuple manifeste devant la Maison Blanche, les démocrates hésitent. Obama utilisent néanmoins une dizaine de plumes pour signer ce qui relève alors d'un suicide politique. Cette réforme aura mis fin à l'idée même de compromis, soulevé une vague d'extrême-droite et alors même que les États, les uns après les autres, poursuivent le gouvernment en justice pour cette loi jugée anticonstitutionnelle, les démocrates se préparent pour les élections du Congrès, qui ont lieu tous les deux ans et se dérouleront dans l'automne de deux mille dix. Ils savent qu'ils vont perdre des sièges, mais la vague soulevée par Obamacare les prend de court. Les démocrates perdent leur majorité à la Chambre plus une quarantaine de sièges et se retrouvent affaiblis au Sénat, avec une majorité de quatre sièges. Pire, entre quarante et soixante républicains à la Chambre sont des gens du Parti du Thé, l'extrême-droite qui voit le compromis comme une faiblesse.
Les républicains avaient-ils raison ? La politique d'Obama, comme celle d'Hollande en France au courant de deux mille douze, déplaisait massivement. Le gouvernment n'agissait pas, les disputes, les scandales se multipliaient et le président semblait ou trop faible ou trop partisan. J'avais forgé mon avis sur un simple détail : il avait signé sa lettre de suicide en signant la réforme de santé sociale. Il le savait. Il l'avait fait.
Et ce n'est pas cette signature seulement qui allait me frapper. Lors du grand sommet entre les deux partis, fin février deux mille dix, Obama se retrouve en tête d'une table regroupant peut-être quarante personnes, des sénateurs, des représentants des deux partis. Le sommet dure six heures, et tour à tour républicain et démocrate s'expriment sur les différents sujets de la santé sociale. J'ai déjà dit la réaction de Boehner, je n'ai pas dit celle d'Obama. Presque tous les participants ont eu ces réponses formatées de politiciens, au ton posé, vague que, dans mes études de linguistique et d'analyse de discours, encore à la porte de la CDA, je pouvais mettre en doute. Mais Obama parle, et il hésite, et il semble parler sans retenue, avec conviction. Le ton est différent. Et quand Boehner critique la loi, critique le président et critique le sommet, Obama répondra plus ou moins : "Je sais que nous ne sommes pas d'accord." Et ne cherchera pas à aller plus loin.
Vous devriez commencer à comprendre, à ce stade, ce que je suis en train de construire, mais encore à travers des anecdotes. Ce jour-là Obama était seul face à une classe de politiciens à laquelle il ne semblait pas appartenir et les américains auxquels j'allais m'adresser me le confirmaient : Obama est incompétent, incapable de jouer le jeu de Washington. Mais justement, Obama avait promis de changer ce jeu, et durant ce débat il avait tenu sa promesse. Il fera de même au moment de l'accord sur la dette.
L'accord sur la dette
Fin deux mille dix, l'économie américaine sort péniblement de la crise, il faut attendre deux mille onze pour déclarer une convalescence qui peine à convaincre. Le chômage est toujours au-dessus de huit pourcent et le phénomène normale, d'une brusque accélération du produit intérieur brut, observé à la sortie d'autres crises ne se produit pas ici. Je n'apprendrai que bien plus tard que c'était dû à la cause même de la crise, l'effondrement du marché immobilier aux causes elles-mêmes étourdissantes de complexité - et impliquant Wall Street mais aussi, selon la version, le gouvernement - et qui laissait des millions de foyers américains avec des hypothèques colossales sur des maisons sans valeur, des intérêts hors de prix dans ce contexte de chômage.
Mais, en deux mille onze, la priorité n'est plus de sauver l'économie, on s'attend à ce qu'elle reprenne d'elle-même. Le gouvernment doit à présent affronter son nouveau défi : rétablir les finances publiques. Le budget, depuis deux mille neuf, est déficitaire à hauteur d'un trillion et demi de dollars par an. Pour les républicains, les dépenses mandataires sont la cause : la sécurité sociale et la santé sociale, les autres programmes étant relativement négligeables face à ces titans représentant la moitié du budget. Pour les démocrates, le problème est un manque massif de revenus causé par les réformes d'impôts de deux mille un et deux mille trois, sous Bush.
Je ne sais pas combien de fois j'ai dû revoir ces chiffres, tant le sujet a été abordé. Les nombres que j'ai sont les suivants : le gouvernement dépensait de trois trillions sept à trois trillions neuf et ne recevait que deux trillions deux, ou deux trillions quatre de dollars par an. La différence avait quatre causes. D'abord la crise économique, causant la moitié du déficit par une baisse de trois pourcent des recettes par rapport au produit national brut. Cela signifiait que près de sept cents milliards, la moitié du déficit, devait disparaître une fois la reprise économique achevée, et cela se retrouvait dans tous les budgets proposés par les deux camps, y compris à l'extrême-droite. Ensuite les mesures contre la crise, essentiellement temporaires, comme les tickets de nourriture et autres aides sociales qui composaient à peu près dix pourcent du déficit et devaient également disparaître avec la reprise.
Les deux autres causes sont en faveur des démocrates. Sur les six cents milliards restants, cent milliards étaient dûs aux deux guerres alors en cours, Irak et Afghanistan, tandis que trois cents milliards étaient dûs aux baisses d'impôts mises en place sous Bush. La différence, deux à trois cents milliards, était structurelle, causée par la hausse d'âge de la population et les coûts des programmes de sécurité et de santé sociales.
Il fallait donc réformer les programmes sociaux mais, même alors, et en opérant d'autres coupes le complément était inévitablement de relever les impôts. Cette hausse d'impôts, acceptable en Europe, était taboue en Amérique. Avec le soulèvement du Parti du Thé les républicains avaient signés massivement le serment de Norquist leur interdisant formellement de voter pour une quelconque forme de hausse d'impôt. Obama lui-même avait promis de ne pas lever les impôts sur les tranches inférieures à deux cent cinquante mille dollars de revenu par an. Mais il n'était pas question non plus de toucher aux programmes sociaux, les partisans de l'extrême-droite eux-mêmes défendant des services pour lesquels ils avaient payé. Depuis un an le Congrès n'avait passé aucun budget, la dette s'accumulait et approchait le seuil autorisé par la loi, qu'il allait falloir relever inévitablement.
C'est dans ce cadre que s'est opéré l'accord sur la dette, visant à une loi de réduction du déficit en l'échange du relèvement du plafond de la dette.
Cet accord allait se réaliser dans le secret, courant juillet deux mille onze, entre l'administration d'Obama et les aides du républicain Boehner, à la tête de la Chambre. Boehner et Obama se parlaient encore. L'administration envoie alors un message aux aides de Boehner avec une proposition de réduction du déficit que les aides refusent. Mais, à leur surprise, le contre-projet des aides contient une clause étrange. Boehner est en train de dire, de manière détournée, qu'il envisage une hausse d'impôts de six cents milliards, contre un trillion quatre de coupes de dépenses pour un plan de réduction de deux trillions sur dix ans. Il espère faire accepter la hausse d'impôts non pas par des relèvements de taux mais par un "élargissement de la base", c'est-à-dire en mettant fin à des exemptions. C'est sa seule chance pour que la Chambre, avec ses membres du Parti du Thé, puissent jamais soutenir le plan de réduction.
Les négociations, qui se déroulent dans le secret, ne sont pas les seules. À côté de ce projet de deux trillions sur dix ans, un groupe de Sénateurs travaille lui aussi à un projet de réduction du déficit plus ambitieux, lui, de cinq trillions sur dix ans, dont un trillion par le même procédé de simplification du code fiscal, en mettant fin à des exemptions. Le groupe de sénateurs, dirigé par Simpson et Bowles, présente leur projet dans une petite salle où les gens des deux camps, présents, applaudissent l'effort. L'administration l'apprend, Obama également qui s'empresse d'aller offrir son soutien au projet.
Grave erreur.
À l'instant où les républicains apprennent qu'Obama soutien le plan Simpson-Bowles de réduction de la dette, ce plan devient impopulaire. Ils découvrent les hausses d'impôts, rejettent la proposition en bloc. Avec l'effondrement de ce plan l'accord plus modeste en cours de négociation entre Obama et Boehner est également menacé. Boehner se sent trahi, pense qu'Obama a déplacé les objectifs et demande bien plus que le chef de la Chambre ne peut offrir. McConnell est mis au courant de l'accord et, à l'instant, dit à Boehner de tout abandonner. Ce dernier n'a pas le soutien qu'il espérait, il ne peut pas compter sur les républicains de la Chambre. À l'instant même où les républicains enterrent l'accord, Obama discute avec les deux chefs démocrates, Harry Reid au Sénat et Nancy Pelosi à la Chambre, et obtient d'eux leur soutien que ce soit pour le plan à deux ou à cinq trillions, malgré leurs réticences. Puis il appelle Boehner pour apprendre que tout est fini.
Le plan de réduction du déficit qui passera au final sera réalisé dans l'urgence, et créera ce qui s'appellera ensuite, courant deux mille douze, la "chute fiscale". Le plafond de la dette est relevé pour l'année, une commission est mise en place pour trouver quatre trillions de réduction du déficit sur dix ans d'ici à la fin de l'année et si cette commission échoue, la loi provoquera automatiquement des coupes dans les programmes de santé, ainsi que dans les dépenses de l'armée. Nous sommes alors en août, aucun camp ne croit que la commission va réussir et aucun camp n'envisage de laisser ces coupes automatiques se produire. Ils ne savent pas encore qu'elles auront lieu en même temps que la fin programmée des baisses d'impôts opérées par Bush, et qu'Obama, dans le même temps, reportait d'un an. Fin deux mille douze se préparait une bombe à retardement de quatre cents milliards qui pouvait faire entrer l'Amérique en récession.
Obama avait-il commis une erreur, en soutenant un plan de réduction du déficit qui semblait jusqu'alors un compromis acceptable pour les deux partis ? Politiquement, oui, mais l'accord que cette erreur a anéanti était déjà voué à l'échec et cette erreur, et l'incompétence qu'elle implique, confirme ce qui s'était déjà produit lors de la réforme de santé sociale. Obama n'est pas un politicien, du moins, pas un bon politicien. Et il le prouvera encore, tout comme les républicains prouveront à la face de l'Amérique leur intransigeance.
L'anecdote des dettes d'étudiants
Cette histoire est brève et se déroule presque au Noël de deux mille onze. Parmi les mesures votées jusqu'alors se trouvait une loi temporaire réduisant de moitié le taux d'intérêt payé par les étudiants pour leurs bourses d'études, de six à trois pourcent. Ce taux devait remonter en fin d'année et les démocrates avaient commencé à négocier leur prolongement. Les républicains, et notamment les membres du Parti du Thé, refusaient cette nouvelle dépense sans une compensation. Ils voulaient, notamment, couper les fonds pour l'ACA, la réforme de santé.
Le compromis est impossible, Obama le sait désormais. Sa stratégie change brutalement et de novembre à décembre, il va commencer à voyager dans les États-Unis et s'adresser directement aux citoyens pour leur apprendre ce qui se passe : les étudiants vont payer plus. Son message est martelé, l'opinion s'intéresse au sujet et les républicains se dépêchent d'affirmer qu'ils ne veulent pas faire payer plus aux étudiants, et que ce sont les démocrates qui empêchent les négociations d'aboutir. Jusqu'alors, les deux camps ont raison. Les républicains sont fiscalement responsables face à un déficit toujours intouché puisque la commission a échoué peu avant, tandis que les démocrates ne posent aucune condition au renouvellement de la loi. Mais alors que la date fatidique approche, que le Congrès s'apprête à partir pour les fêtes et que la pression augmente pour trouver un compromis, Boehner et sa Chambre s'entêtent.
Avec un résultat brutal. Peu avant Noël, alors même que les démocrates s'en vont les républicains restent et présentent au public une table à laquelle ils sont assis, avec les sièges vides des démocrates. C'est l'événement qui change l'opinion et un mot des démocrates le souligne : les républicains offrent à l'Amérique, en cadeau de Noël, une hausse des frais pour les étudiants. Ce bloquage provoque la furie du public et Boehner bat en retraite, en moins de deux jours, et la loi est renouvellée sans condition. Obama est désormais persuadé que rien ne pourra être fait sans mobilisation du public, et ce même public est désormais convaincu que les républicains sont responsables du verrouillage du gouvernement, et de son dysfonctionnement. Toutes les conditions sont alors réunies pour la réélection.
La réélection
Elle commence du côté des républicains qui doivent aligner un candidat contre Obama. Ce dernier n'est pas menacé, à peine en deux mille onze un démocrate s'était-il proposé contre lui mais, en deux mille douze, il est le seul démocrate en liste. Pour les républicains, le problème est de taille. Aucun des grands noms du parti ne veut s'engager, y compris Chris Christie que les républicains supplient de se présenter. C'est un refus borné. Les candidats aux primaires républicaines sont alors des inconnus, pour certains de nouveaux venus en politique. Les sondages passent d'un candidat à l'autre et à chaque fois qu'il y a un favori, ce dernier s'effondre en une à deux semaines sur une erreur ou une autre, la plus célèbre étant celle de Perry citant les trois programmes auxquels il mettrait fin, et ne pouvant pas se rappeler du troisième. Bientôt, ils ne sont plus que quatre, et déjà le favori se dessine. C'est Mitt Romney.
Romney n'a qu'un seul avantage, son expérience professionnelle. Il a fondé Bain Capital, une compagnie rachetant des entreprises en difficulté pour en redresser les comptes avant de les revendre. Un rêve républicain, mais déjà les primaires et leurs sondages montrent que Romney ne parvient pas à convaincre. Avant même d'être le favori il accumule les gaffes. Il refusait que le gouvernment aide General Motors, il a parié, lors d'un débat, la somme de dix mille dollars, et il est mormon. Plus frappant encore, son travail de sénateur au Massachussetts n'est même pas mentionné. Perry et Gingrich critiquent son travail à Bain et surtout, il a créé Romneycare, sur le même mandat utilisé par l'Obamacare. Mais c'est la seule option, et tandis que le candidat Ron Paul, en vérité un libertarien dont le soutien notamment chez les jeunes étonne, quadruplé depuis la dernière primaire de deux mille huit à vingt pourcent de soutien, le parti et ses ressources se concentrent déjà pour préparer Romney à la grande élection.
La course, en juin, est déjà entre Obama et Romney, avant même les conventions de septembre où l'élection est censée commencer. Romney n'a qu'un seul avantage : l'économie est catastrophique. Les rapports sur l'emploi sont trop faibles, le chiffre du chômage peine à baisser, il y a toujours huit pour cent de la population active sans emploi et trop de maisons aux hypothèques écrasantes, de gens jetés dans la rue. Cet argument seul fait prédire la défaite d'Obama et Obamacare, qui avait écrasé le parti démocrate en deux mille dix, devient secondaire. Quant à Obama, il n'a qu'un seul avantage : il est populaire. Malgré ses quatre ans de crise tant économique que politique, il est toujours apprécié par la population tandis que Romney est mal perçu même par les républicains. L'objectif de Romney est clair, marteler l'économie, tandis qu'Obama doit donner l'image la plus négative possible de Romney.
L'événement clé de la réélection sera la remarque de Romney, sur les quarante-sept pourcent d'assistés votant Obama. Jusqu'en septembre les sondages favorisaient Obama à raison de deux points, un faible avantage dans la marge d'erreur dû à sa popularité. Les conventions donnent un léger avantage à Obama qui se traduira, une semaine après la remarque, par une avance de quatre points. Il faut deux cent septante votes pour remporter l'élection, Obama fin septembre pouvait en compter sur trois cent trente, dont la Floride que Romney ne peut pas se permettre de perdre. À cet instant les journaux commencent à demander si la campagne n'est pas déjà finie.
C'est là qu'Obama commet une nouvelle erreur.
La campagne prévoit trois débats, et le premier est désormais connu, pour "Big Bird" mais aussi pour l'attitude d'Obama. Les attentes sont faibles pour Romney qui se montre à l'aise et crédible, rattrapant ainsi son retard de popularité. Mais le coup de butoir, dévastateur, est la passivité d'un président qui ne répond pas aux attaques, qui n'attaque pas, qui se contente de donner son plan durant l'heure et demie du débat. Il n'y a pas de débat. Romney gagne et remporte quatre points dans les sondages, effaçant l'avantage d'Obama et le menaçant jusqu'au Colorado, jusqu'alors acquis. En un quart d'heur les gens réalisent qu'Obama vient de perdre les élections. L'anecdote veut qu'obama, en quittant la scène du débat, ait été lui persuadé d'avoir remporté l'événement.
Ce résultat cependant ne durera pas. Les gains de Romney s'arrêtent début octobre, et les deux débats suivants où Obama, beaucoup plus actif, confrontera Romney avec deux événements marquants - la modératrice du second débat "corrigeant" Romney et les "chevaux et baïonnettes" du troisième débat - sans jamais obtenir de véritable victoires, suffiront à redonner à Obama son avance de deux points dans les sondages. Fin octobre, Romney est de nouveau en difficulté, Ohio semble hors de portée et ses options sont réduites à des choix improbables. Pour les républicains, l'ouragan Sandy est le coup de grâce où Obama apparaît aux côtés de Christie, le modèle républicain, qui donne de facto son soutien au président. Les votations se produisent et Obama l'emporte avec plus de trois cents votes électoraux.
Même alors, sa victoire est contestée. Alors même qu'il l'emporte, les républicains affirment déjà que cette victoire ne signifient rien et s'appuient sur le vote national, serré, pour lui refuser le soutien populaire. Et la question avait été posée tout du long, de ce qui se passerait si Obama gagnait. Avec une Chambre toujours en faveur des républicains et même en conservant le Sénat - chose qui n'était pas assurée - il serait toujours confronté au verrouillage politique pour au moins encore deux ans. Et les républicains n'envisagent pas plus le compromis après l'élection qu'avant. Ils ne l'envisageaient pas même avec Romney : quand celui-ci aurait gagné, le Parti du Thé et ses quarante à soixante membres se promettaient de le bloquer s'il ne suivait pas exactement leur politique.
Quant à Obama, peu avant l'élection, après avoir répété aux gens d'aller voter - la crainte démocrate étant celle d'une faible mobilisation de leur base désabusée - avait dit encore deux choses. La première rappelait une remarque de son addresse sur l'état de la nation face au Sénat, une remarque qui critiquait le manque de bonne volonté des démocrates dans le compromis. "Ne fuyez pas dans les collines." Une remarque de détail pour laquelle les démocrates avaient critiqué leur président, et exigé qu'il les soutienne. Il répètera, à nouveau dans sa campagne, comme un détail que les démocrates, aussi, doivent faire preuve de compromis. Le second détail, dans la même veine, était un appel à l'électeur, à quelques jours de l'élection, d'élire des républicains modérés. Obama leur conseillait, bien sûr, d'élire des démocrates, mais aussi des républicains tant que ces politiciens étaient favorables au compromis.
Enfin, et c'est un détail, lors d'une apparition dans un show télévisé, lorsque le présentateur demandera à Obama quels sont ses échecs la première chose qui viendra et spontanément - en terms de conversation, un remplissage pour élaborer la réponse - a été de mentionner Guantanamo, "elle n'est toujours pas fermée". Ce sont ces détails, tout au long de sa campagne comme de sa gouvernance, qui ont fait de lui pour le temps que je l'ai suivi, un véritable politicien. Un politicien qui rende le nom de politicien agréable.
La promesse d'espoir
Je n'ai élaboré jusqu'à présent que la partie du "changement", qui a cherché à dressé l'image d'un politicien dans lequel on puisse à nouveau croire, loin de l'image cynique du politicien menteur par défaut et nécessité. Mais je n'ai pas parlé de la partie "espoir", quand bien même elle est liée. L'espoir, pour nous autres étrangers, c'était surtout la politique étrangère et ces guerres d'Irak et d'Afghanistan. C'est l'envoi de trente mille hommes en Afghanistan qui fera douter d'Obama, après son prix Nobel déjà questionable. Ce sont ses attaques de drones et, pour les américains, sa faiblesse face à la Russie comme face à la Chine, son abandon d'Israël. Romney parlera de faiblesse.
Pour nous, c'est le Printemps Arabe.
On peut honnêtement douter que le discours du Caire ait rien déclenché, quelque noble qu'il fut, l'honneur en revient aux tunisiens. Je ne ferai qu'esquisser ce mouvement de Tunisie, de Lybie, d'Égypte - et d'autres pays moins médiatisés. Obama s'implique très tôt, affirme que les dirigeants doivent partir, soutient la foule de la place Tahrir. Son action est symbolique mais, en Égype, permettra le départ ordonné du dirigeant Mubarak et le gouvernment provisoire de l'armée en vue d'élections. L'honneur en revient aux Égyptiens, Obama n'en revendiquera rien, sans doute parce que c'est déjà impopulaire. Il a abandonné un allié de longue date, menaçant Israël, et les élections risquent de propulser un groupe islamiste à la tête de l'Égypte, ses huitante millions d'habitants et son armée. Les aides versées à l'Égypte par l'Amérique sont remises en question.
Lorsque les événements de Lybie se précipitent, la France obtient l'intervention militaire avec l'interdiction formelle de poser une botte sur le territoire lybien. Toutes les mémoires ont encore en tête le désastre d'Irak, dix ans d'occupation et le chaos qui s'ensuit. L'armée américaine ouvre les hostilités avec ses bâtiments de guerre, tirant plusieurs centaines de missiles Tomahawks et écrasant les défenses sol-air de Lybie. L'aviation lybienne est clouée au sol et les colonnes de char rebroussent chemin. Obama se retire bientôt pour laisser la direction à l'Otan, en tête les Royaume-Unis et la France. Il ne fournira plus que la logistique dont ces pays ne disposent pas, ravitailleurs, radars et drones notamment. Après des mois de conflit la France fait intervenir ses hélicoptères, surmontant la crainte de pertes en matériel et en personnel. Les sorties de nuit décuplent au sens littéral l'efficacité des frappes, l'aviation légère écrase les forces régulières tandis que les rebelles progressent à l'ouest et, le siège de Misrata s'achevant, menacent Tripoli. Après six mois de conflit, malgré les morts la guerre de Lybie est un succès, presque un modèle à suivre.
Pourtant Obama n'en retire aucune gloire, qu'il le veuille ou non : la mort d'Osama Ben Laden sera bien plus valorisante que ce conflit auquel les Américains étaient réticents, épuisés par la guerre et ne voulant plus s'impliquer. On critique qu'il n'intervienne pas également en Syrie, on critique qu'il ait laissé les armes de Lybie se disperser et tomber entre les mains terroristes - des lanceurs sol-air personnel notamment - et on critique que son action menace la Lybie de guerre civile, avec, à nouveau, la menace des "musulmans". Craintes exacerbées avec l'attentat de septembre contre l'ambassade américaine, parmi d'autres attentats passés sous silence, et la mort de l'ambassadeur. Je ne détaillerai pas mais, sur un simple détail, les républicains construiront une critique acerbe de l'administration. Le public, pourtant, ne suivra pas, malgré les inquiétudes la politique étrangère d'Obama convainc massivement.
Et en Amérique même le Printemps Arabe inspire son propre mouvement, les Révoltés ou Occupants de Wall Street. OWS se mondialise - partiellement - et pendant quelques mois d'automne serviront de balance au Parti du Thé d'extrême-droite. La différence est cependant frappante, face à un parti organisé et clairement en faveur des républicains OWS se révèle plus cellulaire ou communautaire et surtout, sans affiliation. Les démocrates n'arrivent pas à capitaliser dessus, les révoltés critiquent autant Obama que ses opposants. Le mouvement, après Noël, s'essoufflera, et encore actif à la fin des élections, il a disparu des médias. Ce mouvement, comme celui de Moyen-Orient, est indépendant des actions d'Obama.
À deux exceptions près, que les républicains accusent Obama des conséquences du Printemps Arabe et ce péril d'instabilité qu'il représente pour eux, et qu'OWS, essentiellement mouvement de jeunesse, correspond au très fort avantage d'Obama parmi les jeunes - avantage également partagé par le libertarien Ron Paul. Obama n'a pas créé OWS. Par contre le contraire n'est pas improbable. Le Printemps Arabe était un mouvement de désespoir face à une tyrannie véritable, OWS une sorte de miroir occidental dans une société riche et démocrate de gens pourtant également désespérés, soit par le manque de travail, par la perte de leur maison, que par la différence de richesse, les conséquences de Wall Street sur leurs vies et le verrouillage du Congrès. L'idée fondamentale de ces gens étaient qu'ils n'avaient pas enfreint les règles, que Wall Street les avait enfreintes, que Wall Street - ses banques - était sauvée de la faillite mais pas les individus dont les erreurs en bourse comme en prêts avaient causé la faillite également. Les employés de Wall Street eux-mêmes sympathisaient.
Il existait donc bien un espoir, sous quelque forme que ce soit, une attente qui finira par s'exprimer d'abord sous la forme du Part du Thé puis sous celui des Occupants de Wall Street. Obama n'était pas seulement un vote contre Bush - Hillary Clinton aurait pu être élue, et être la première femme présidente - mais l'élu d'une idée ou d'une valeur, d'une attente belle et bien présente dans la population, et seule - avec une amélioration de l'économie au chômage tombant sous le seuil fatidique des huit pourcent - à expliquer une réélection aussi forte, dépassant les trois cents votes électoraux. Je ne sais pas combien de pages il aura fallu pour arriver à cette conclusion toute simple : Obama représentait, en deux mille huit, pour la jeunesse américaine comme pour beaucoup de jeunes dans le monde, comme le renard, l'espoir. Obama incarnait cet espoir, aussi vague cette notion soit-elle.
Et c'est la raison pour laquelle mes textes sont aussi confus. Il vous suffira, au terme de ce pavé à l'argumentation hâtive mais fondée sur deux ans de suivi, d'observation, de recherche et d'analyse, d'un simple battement de sourcil pour réfuter cela. "Non, Obama est juste un politicien", et vous aurez tout balayé à l'instant. Nombre de républicains, presque tous les indépendants et certains démocrates le font sans peine. En fait, l'idée d'Obama comme symbole d'espoir est même ridicule, ou puérile. J'ai proposé là une version de son premier terme, jusqu'à sa réélection, mais ce n'est qu'une interprétation et j'espère avoir montré à quel point elle était incertaine, et précaire. Comme le sont les symboles, incertains et précaires, et ne tenant qu'à un souffle.
Après quatre ans d'Obama, cependant, on peut se demander pourquoi Hollande a été élu - un vote de protestation contre Sarkozy - et ce qu'il représente - juste un autre politicien. Et s'il échoue, qu'est-ce que cela aura signifié - ce sont les grenouilles qui demandent un roi.