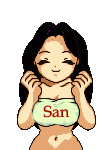en hommage au feurnard
L’hôpital est vieillot. Il est bâti en béton blanc sombre, tout en angles et en larges fenêtres soigneusement closes. On y accède par une barrière qui grince en se soulevant. Dans le parking, les véhicules des visiteurs croulent sous les feuilles mortes. C’est l’automne. Les saules pleurent des larmes brunes et rousses. Des brochures en papier glacé tourbillonnent dans la cour, évadées des poubelles. Un balayeur balaie en vain. La voiture se gare et, après s’être équipé, il en descend.
Le sac à la main, il pénètre dans le hall d’accueil. Une hôtesse lui sourit et lui fait oublier l’espace d’un instant les craquelures aux murs. Il espère que seule l’entrée est dans ce cas. La suite lui donnera raison. Une infirmière vient le chercher. Elle éclaire les lieux de sa conversation, et ils en ont bien besoin. Les couloirs sont vert lavande. Ils sentent le désinfectant. Ils croisent des visiteurs, des infirmiers, des médecins. Tous l’observent avec curiosité. Au troisième étage, par les escaliers, ils finissent par arriver devant la porte de la chambre 319. La main sur la poignée, l’infirmière l’avertit :
« Elle n’est pas seule. Vous aurez du public ! »
Il entre. Les paroles nasillardes d’une vieille télévision lui sautent aux oreilles et lui arrachent un rictus discret. A côté du lit où se redresse la jeune agonisante, il y a une grande femme chapeautée, sèche comme un vieux bout de bois, et une adolescente qui bat des mains à son arrivée.
« Regarde, Fanny, c’est le clown !
C’est vrai, il est artiste, il est interprète. Il est clown. Il a d’ailleurs un gros nez rouge qui sonne comme un klaxon. Il esquisse sa plus belle grimace et déjà l’amie ou la sœur au chevet de Fanny sourit. Celle-ci aussi, et quel joli sourire elle a ! Elle a peut-être douze ans, mais déjà les fils blancs parsèment ses cheveux d’or. Si pâle, elle semble si fragile… La femme se lève et, toute raide, lui tend la main.
— Bonjour. Je suis la mère de Fanny. Je vous ai fait venir parce qu’elle me l’a demandé.
Un instant, le clown a un doute. Veut-on lui faire une farce de mauvais goût ? Puis il comprend que la jeune fille a demandé un clown, pas ce clown. Il respire, peut-être un peu trop tôt car la femme reprend plus bas :
» Sachez que je considère cela comme un caprice ridicule. Mais ma fille est aux portes de la mort, alors ayez au moins la décence de la faire rire.
Que répliquer à cela ? Il ne réplique rien. Une personne suffit à rendre l’atmosphère lourde, moite. Il transpire dans ses vêtements. Il se rapproche de Fanny et prend son ton le plus réjoui pour lui demander ce qu’elle souhaite.
— De bonnes blagues ? Des devinettes, des énigmes ? Des chansons ? Des marionnettes ?
A chaque proposition, il soulève son sac qui recèle mille merveilles. Fanny l’observe avec des yeux ronds. Elle ne semble pas souffrir, mais paraît perdue. Son amie, compatissante, prend la décision à sa place.
— Il faudrait quelque chose de silencieux, parce qu’elle regarde la télé.
La télécommande est posée près de Fanny. La jeune mourante ne fait pas mine de la saisir pour s’en emparer. Il ne peut s’empêcher de se sentir humilié par cet intérêt limité, d’autant plus que le poste diffuse un spectacle de cirque. Cependant, il fait contre mauvaise fortune bon cœur. Il a en face de lui une adolescente qui n’a plus que quelques jours à vivre. Il doit l’égayer, à tout prix. Il ne faillira pas.
Il choisit le mime. Le voilà qui brasse le vent, fait les gros yeux, se prend la gorge et se roule par terre, dans d’hilarantes convulsions ! Il bondit, il trépigne, il grogne, il imite des professions et des super-héros. La sœur bat des mains, toute réjouie, elle en redemande et elle est bien la seule. Bien qu’il soit en sueur après tous ses efforts, la mère est restée de marbre. Fanny, elle, arbore toujours ce même sourire poli sur le visage. Il a l’impression que le volume de la télé a augmenté, mais la télécommande n’a pas changé de place. Il doit rêver. Une sueur froide lui coule le long du dos.
— C’est tout ce dont vous êtes capables ? Feu mon mari en aurait fait autant.
Il frissonne. Avait-elle vraiment besoin d’invoquer les mânes d’un défunt dans cette pièce, dans ce contexte ? Le sourire de Fanny s’est fané et, il en est sûr, le volume vient de baisser. Il hasarde un œil vers l’écran. C’est un documentaire sur la savane.
— Des devinettes ! réclame l’amie.
Il obtempère. Il puise dans son sac un recueil dont il est l’auteur, fait mine de le lire en prenant des accents bizarres. Il leur propose un tour de France des patois ! De la Picardie à la Corse, en passant par la Bretagne et le Pays-Basque, il les fait voyager à travers le pays. Il récolte les éclats de la rire de l’amie, la lumière sur le visage de Fanny, la désapprobation de la mère.
— Comment voulez-vous qu’elles trouvent la réponse ? Vous baragouinez dans un langage incompréhensible.
Le clown a l’habitude du scepticisme, le même que l’on réserve à la foi. Il a régulièrement l’impression de prêcher dans le désert. Parfois, la conversion est au bout du calembour. Le plus souvent, c’est le mépris. Celui-ci n’aura que ce qu’il mérite.
— La petite dame n’est pas contente ? Mais c’est qu’elle est grincheuse, la petite dame, c’est qu’elle n’enlève pas son chapeau ! Oh, dis-donc !
La raillerie, une autre arme de sa panoplie. La femme rougit violemment, va pour s’offusquer… Le clown est trop leste. Il s’empare du chapeau, le remplit de mousse à raser et le rabat sur le crâne de la rombière. La sœur hurle de rire, elle en pleure, ses larmes coulent jusque sur la couette du lit que le clown regarde. Les petits poings de Fanny se sont serrés. Pour la première fois, ses lèvres s’entrouvrent :
— Pourquoi es-tu si méchant, Monsieur le clown ?
Il tressaille. Il ne s’attendait pas à des reproches.
— Mais, hoquète encore son amie, il n’est pas méchant ! C’est pour rire, juste pour rire !
— Mais oui, ma jeune demoiselle, abonde-t-il avec une gaieté forcée, juste pour rire !
Le cœur n’y est pas. Il a manqué à son devoir. Pire encore : il a attristé Fanny. Cette fois, il voit bien qu’elle s’empare de la télécommande, qu’elle change de chaîne, remonte le volume. La porte de la chambre d’hôpital claque : la mère est de retour, après un passage aux toilettes. Elle est furieuse.
— Sortez.
Pensez à votre fille ! veut-il s’exclamer. Si j’ai fait cela, c’est pour elle, pour la faire rire ! Néanmoins, comment ces paroles pourraient-elles encore porter ? Le visage de Fanny s’est fermé. Il remet ses accessoires dans son sac, tête basse, fait volte-face.
— Pourquoi tu pars, Monsieur le clown ?
— C’est vrai, renchérit sa sœur : reste ! Tu as encore plein de tours à nous montrer !
Il observe la mère à la dérobée. Elle est assise, le chapeau sur les genoux. Elle le défie du regard. Il a failli déjà deux fois. Le spectre du passé et de la mort étend déjà son ombre mais en réalité, ce n’est que le soir qui tombe – il tombe tôt, en automne. Il reste la lumière de cette fille aux cheveux blancs. Il ne tournera pas les talons sans combattre.
— Vous rappelez le clown, le voilà qui accourt !
D’un bond, il se jette à leurs pieds et leur présente une rose brillante. Surprise, la sœur la saisit…et se retrouve tout de go arrosée ! La télécommande crépite, elle a pris l’eau, elle n’en fait qu’à sa tête. La télé s’éteint d’un coup. Il est seul face à son public, seul face à son défi. Il déploie toute la palette de ses nombreux talents. Il leur narre des énigmes insolubles ou loufoques, cabriole dans la chambre à qui mieux mieux et les bombarde d’anecdotes truculentes. Sans cesse, il quête du coin de l’œil l’approbation de Fanny, la joie, le bonheur ; sans cesse, il est déçu car seule son amie ponctue de battements de mains les facéties du clown.
La mère n’a rien rajouté. Cependant, elle semble grandir sur sa chaise et son ombre s’étendre dans le soir qui tombe. Elle le fixe, accusatrice. Pourquoi ? Sait-elle ? Il jongle avec des boules, fait des tours de magie. Fanny demeure imperturbable. Pourquoi ? D’un coup, cela sort :
— Pourquoi ? Pourquoi ne rit-elle pas !
Il n’a pas d’interlocuteur. C’est à lui-même qu’il s’adresse. Ses yeux s’agrandissent. Fanny ne répond pas. Elle le contemple, blême, avec ses cheveux blancs de morte.
» Je ne l’ai pas tuée ! s’exclame-t-il.
— De quoi tu parles ? demande l’amie.
Il ne l’entend pas, car la télé s’est remise à grésiller, plus fort que jamais. Il se retourne, aux abois, entend les rires préenregistrés d’une série télévisée américaine. Le son monte, monte, monte… La voix de la mère prend le dessus, lugubre.
— Ce n’est pas votre rôle.
— Arrêtez de parler comme s’il s’agissait d’un jeu !
— Mais c’est un jeu, s’étonne la sœur.
— Un simple jeu, confirme enfin Fanny.
Elle s’est redressée et triture les coins de son oreiller. Elle lui a tendu une main qui n’est ni sèche, ni raide. Il s’adosse au mur, vacillant. Les rires factices l’oppressent, narguent ses tentatives. Il ouvre la main et implore presque la mère :
— Votre chapeau, ma petite dame ?
Le ton est misérable plutôt que cocasse. La mère lui livre le couvre-chef, mais son rictus plein de morgue ne trompe pas : elle pense triompher. Les rires redoublent. Il se recroqueville, tente le tour de magie. Un pigeon sort du chapeau – il n’a pas pu faire mieux. Il relève la tête, craintif. Lentement, très lentement, les mains de Fanny quittent l’oreille et applaudissent lentement, très lentement. Il y a de la compassion dans cet applaudissement.
— Bravo ! s’écrie l’amie. C’était bien, hein, Fanny ?
La jeune fille aux cheveux blancs paraît à bout de forces. Ces efforts physiques lui ont coûté. Le clown se met à paniquer. Les souvenirs affluent dans sa mémoire, les souvenirs de ce rire… Fanny plonge ses yeux dans les siens. Elle chuchote :
— N’aie pas peur, Monsieur le clown. Tout va bien. N’est-ce pas que tout va bien, maman ?
— Bien sûr que tout va bien, ma chérie.
— Ce n’est pas de sa faute.
Il sue à grosses gouttes. Il lit entre des lignes tracées à l’encre sympathique.
— Je ne l’ai pas tuée !
— Pas encore, dit la mère.
— Il ne veut pas le faire, dit la sœur.
Les rires préenregistrés ponctuent l’échange, autant de sarcasmes à son intention. Il recule, pas après pas. Il sent le mur contre son dos, le mur froid et lisse d’une chambre d’hôpital.
— Vous n’en avez pas encore fini ?
— Il n’en a pas encore fini, répond Fanny en écho.
— Il faut qu’il continue, ajoute l’amie.
Non, il n’est pas trop tard ! Il peut encore mettre un terme à ses simagrées, assagir ses grimaces. Il se sent accablé par les reproches silencieux de la mère et jette, horrifié, le couvre-chef par terre. Le pigeon se heurte à la fenêtre, encore et encore, dans un choc sourd rendu plus sonore par la soudaine extinction de la télé. Il ne peut plus se dérober. Il doit aller jusqu’au bout. Fanny l’a demandé : C’est elle qui a appuyé sur la touche rouge.
— Pourquoi ne mettez-vous pas le chapeau ? Je crois qu’il vous irait à ravir.
Il succombe au son de la voix. Les mains tremblantes, il se couvre la tête et dévoile un jeu de cartes. Il s’approche de Fanny, lui murmure de choisir une carte.
— Je ne t’entends pas, Monsieur le clown. N’aie pas peur.
Il répète la consigne, plus fort. Fanny choisit une carte, la regarde, la mémorise, la remet dans le paquet. Le pigeon se cogne contre la vitre. Charitable, la sœur va lui ouvrir et le laisse s’envoler, tandis qu’un courant d’air glacé sillonne jusqu’au lit de la jeune mourante. Elle frissonne et bleuit à vue d’œil. Pourtant, elle a rejeté ses couettes. Ses yeux brillent. Il veut croire que ce n’est pas de la fièvre. Il mélange le jeu, tire une carte et la lui montre.
— C’est celle-là.
Fanny secoue tristement la tête. Il sursaute, il n’en peut plus de ce vent ! Il se précipite vers la fenêtre, regarde en bas des trois étages. L’amie lui prend la main. Le contact est chaud, réconfortant.
— Ne fais pas ça, Monsieur le clown ! Tu l’as dit : ce n’est pas de ta faute.
— C’est ce qu’il dit, lui, persiffle la mère. Et qu’en dit-elle, elle ?
La jeune fille aux cheveux blancs reste d’abord silencieuse. La sœur ferme la fenêtre tandis que le clown s’arrime aux lèvres de Fanny. Elles s’entrouvrent, s’apprêtent à lâcher un filet de voix, et finalement c’est un dernier souffle qu’elles expirent. Le petit corps s’affaisse.
— Non !
Le clown se rue vers le lit, prend la jeune fille dans ses bras, prend ses doigts, les pose sur son gros nez rouge qui sonne comme un klaxon. Les larmes brouillent son maquillage blanc, tachent son costume. Il sanglote à présent, vaincu, et ne cesse d’hoqueter qu’il ne l’a pas tuée. Une petite main lui tapote dans le dos, prolongée par une voix gorgée de bonté.
— C’est fini, à présent.
— Je ne voulais pas.
— Tout est fini.
— Je l’ai tuée, n’est-ce pas ?
La mère se lève. Elle a rejeté un voile sur son visage, un voile impénétrable. Ses paroles en ressortent étouffées.
— Regardez-vous.
Il se tourne vers l’écran éteint, où il peut contempler son reflet déformé. C’est elle qui a raison. Il porte le chapeau.
— Je l’ai tuée.
La mère est partie de la chambre. Il ne reste plus que l’amie ou la sœur, qui lui reprend la main.
— Tu as fait de ton mieux. Tu n’as rien à te reprocher.
— Mais je l’ai tuée !
— Donne-moi ça, Monsieur le clown.
Elle s’empare du couvre-chef, l’essaie pour voir, puis le jette par la fenêtre après qu’elle l’a rouverte. Il s’en va tourbillonnant dans la cour, virevoltant sur le parking. Abattu, le clown le regarde se poser près de sa voiture. Le balayeur, qui balayait non loin, doit le trouver à son goût puisqu’il s’en saisit aussitôt et le juche sur son crâne.
— …
— Tu vois ! Allez, viens, maintenant. »
Elle le tire en avant et c’est main dans la main qu’ils sortent ensemble de la chambre.