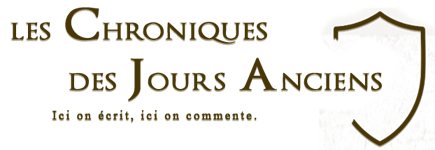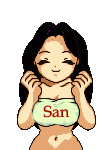J'ai écrit un texte. Je sais, choquant. Et durant ce texte j'ai écrit ça :
... amas de pierres fumantes au sein d'un bouillon d'eau infecte...
Vous ne voyez sans doute pas de problème à ce qui tient de la prose habituelle de la fantasy : des termes forts pour asséner une fiction excitante dans ce qu'on pourrait appeler une surenchère. Pour l'anecdote, le "bouillon d'eau" était à l'origine de l'eau "bouillonnante" et là peut-être vous commencez à deviner pourquoi ce moment m'est resté en tête.
Je vais donc patauger ici dans de la pseudo-science, parler de communication, de focalisation et de saturation.
1. Communication
C'est un grand classique de la pragmatique (au sens des sciences du langage) : si on vous dit "chien", vous n'aurez pas en tête la même image d'un chien que moi. Selon le modèle ostensif-inférentiel de Sperber & Wilson, on ne communique pas par télépathie, on présente des indices (c'est le "ostensif") et les autres doivent deviner ce qu'on pensait (c'est le "inférentiel"). Je simplifie évidemment mais ce décalage est bien connu des auteurs, entre ce que vous avez en tête, ce qui finit sur le papier et ce que le lecteur va en tirer. Le papier, ce sont vos indices, et vous-même en vous relisant (après 2-3 jours ou plusieurs années) risquez de ne plus reconnaître votre propre histoire.
Heureusement ça fait ~200'000 ans que l'humanité gère ce problème et la langue (française comme les autres) est bardée d'outils pour aider à la compréhension. À partir d'un nom commun, comme "eau", on peut lui attacher : des adjectifs, des prépositions et ce que je vais enrober dans "des conjonctions" :
- Une eau claire
- Une eau de cristal
- Une eau qui perlait à la lumière
- Une eau perlant à la lumière
Sans parler bien sûr du moyen le plus direct de qualifier l'objet :
- L'eau perlait à la lumière
Parce qu'in fine la phrase sert à ça. Je ne sais pas si je suis exhaustif ici mais notre boïte à outils est suffisamment riche et peut, ce qui fait notre bonheur, rapidement bâtir un château de cartes :
- Une eau claire, fraîche, abondante, si vive, trop vive, qui scintillait, qui les appelait, perlant sur les surfaces, une eau de merveille...
- Une eau perlant d'une fraîcheur abondante et si vive qu'elle scintillait et sur les surfaces magnifiait...
Accumuler les adjectifs (ou prépositions, etc.) devient vite un jeu et devient vite, très vite, très, très, trop, bien trop lourd pour le lecteur. Ce sera la saturation dont on parlera bientôt mais l'anecdote est bien connue, d'un texte entier construit simplement à partir de tels qualificatifs, de cet empilement incessant. Et oui, à la fin oui, normalement, il y a eu suffisamment d'indices, votre lecteur a compris que l'eau avait été filtrée et chlorée comme il faut. Ou que votre assoiffé est très content. Ou qu'il y a anguille sous roche. Ou que...
2. Focalisation
Maintenant qu'on a énoncé l'évidence, continuons dans la pseudo-science. Là, on avait un seul nom, l'eau, et donc on pouvait le qualifier sans crainte. Mais un texte manipule beaucoup de noms. Beaucoup. Puisqu'on parle d'eau, imaginons un cours d'eau : il y a l'eau, il y a le lit du cours d'eau, les berges, les plantes, les insectes, l'air, les odeurs, les cailloux, les débris et que sais-je dont votre scène a besoin. Ou alors, imaginons une cuisine : il y a l'eau, il y a la casserole et oh mon dieu tout le reste.
Tout comme un peintre n'a pas le temps pour chaque brin d'herbe, votre prose ne peut pas tout décrire ; on sélectionne. Et quand il lit, le lecteur ne peut pas tout retenir ; il va sélectionner aussi. Petite anecdote : notre oeil fait de même, en ne retenant qu'une très étroite part du champ de vision et en reconstruisant le reste. Bref, nos ressources sont limitées, nous sommes économes par nature et ne retiendrons que le plus important.
C'est ça, la focalisation.
Donc, quand on donne des indices au lecteur pour qu'il interprète notre vision de l'histoire, on doit lui donner des indices pour diriger son attention : pour qu'il se focalise sur ce qui compte. Si j'ai des pierres et de l'eau, lequel compte ? Et ces pierres et cet eau se trouvent au milieu d'une phrase qui, elle-même, est noyée au sein d'un paragraphe (et le paragraphe...).
Ici, la théorie scientifique est quelque peu compliquée. Il y a d'abord la "mémoire discursive", qui est essentiellement l'ensemble des objets construits par le discours. Pour nous, c'est la mémoire du texte, tout ce qui a précédé le passage que vous écrivez. Quand on parle de tenir compte du contexte, on parle en fait de la "mémoire discursive", de ce que le lecteur est censé avoir encore en tête quand il lit le passage ; cette mémoire à son tour fournit les indices pour interpréter les indices suivant, le passage en question ; et ces indices s'ajoutent ensuite à la mémoire pour le passage suivant.
Il y a ensuite "l'objet de discours". Il faut comprendre que la langue est puissante. Absurdement puissante. Si j'écris :
Il entra dans la chambre. Des chaises en vrac, la table renversée, dans le frigo le lait dépéri avec une étiquette des années 1965, une mauvaise année, très mauvaise année ; un singe suspendu hurlait comme un fou ; un paquebot à toute vapeur, penché sur le côté, allait sombrer bientôt, si bien que l'équipage s'affolait, qu'ils gagnaient les chaloupes, qu'ils se battaient sur le pont, forçant le capitaine à tirer au pistolet. Le sang coulait, les clameurs ne cessaient pas. Quelques cornichons entamés près d'une fenêtre ouverte derrière laquelle les cheminées crachaient leur fumée sans fin.
Tout cela, tout ce que je viens d'écrire, la mémoire l'a enregistré comme un et un seul objet. C'est la chambre. Il y a un singe, il y a un paquebot, j'aurais pu y mettre un immeuble et des moutons électriques mais voilà, c'est la chambre. Et il faut comprendre que ce n'est pas la "chambre" mais un objet en constante révision : pour le lecteur ce pourrait être littéralement une chambre de douze mètres carré où le paquebot est un tableau, ou bien la chambre peut être une dimension parallèle, aux murs disloqués, et il y a vraiment un paquebot là-dedans. Mais quand on parle d'unité, on parle de ça : des objets de discours, formés par le discours, qui condensent l'information en des paquets informels, sans véritable étiquette. Je peux donner des ailes à ma chambre, ce sera toujours le même objet.
Pour compliquer encore, un objet peut en contenir un autre. La chambre contient un paquebot. Et un singe. Et si vous vous en rappelez seulement, une bouteille (ou brique ?) de lait. Le pistolet est-il contenu dans la chambre ? Dans le paquebot ? Dans le capitaine ? Eh. Pour amusante que serait l'arborescence de la scène - essayer de décrire exhaustivement qui contient qui - cela n'aurait pas d'intérêt. Le lecteur ne va pas le faire, vous non plus, parce qu'une fois encore : on sélectionne.
Maintenant que j'ai ma "mémoire discursive", qu'on va juste appeler la mémoire, et mes "objets de discours", qu'on va juste appeler des objets, cela me permet d'imposer quelques règles :
- Le lecteur n'a jamais qu'un et un seul objet en tête.
- Le dernier objet rencontré est le candidat le plus probable.
- À chaque temps du texte, le lecteur modifie l'objet qu'il a en tête ou en reprend un autre.
Et tout cela a un coût, demande de l'effort au lecteur. Il doit non seulement calculer si on parle toujours du même objet, il doit aussi modifier cet objet ou, pire, bien pire, il doit trouver de quel objet on parle désormais, et le classer parmi les autres. On a parlé d'un crime dans un train, on passe à une toute autre scène dans un palais de Shéhérazade, puis on nous parle d'une gare, est-ce que la gare est liée au train ? Et là ce ne sont que trois objets au plus haut niveau du texte mais si le lecteur se trompe, il est bon pour réviser toute une branche de sa mémoire discursive et si l'effort devient trop grand, un lecteur va faire une pause ou abandonner le texte.
Donc la grande leçon de la focalisation consiste à s'assurer qu'en tout temps du texte, le texte dise clairement au lecteur quel "objet" il manipule. Et s'il y a changement d'objet, comme cela arrivera inévitablement - à moins que vous ne parliez de Godot, et encore - le texte doit l'aider à savoir si c'est un nouvel objet, ou de quel ancien objet il s'agit. Et pour parler - dans les grandes lignes - de comment on fait, parlons de saturation.
3. Saturation
La saturation n'est pas une notion scientifique. Non que ce qui précède doive être pris pour argent comptant mais ici on parle du moment où le lecteur doit faire trop d'efforts pour interpréter ce qu'il lit. Je le répète encore : interpréter a un coût (cognitif) et tout l'enjeu de la communication est de le réduire autant que possible (tout en préservant le message). Pour nos textes, c'est la même chose : tout l'enjeu pour l'auteur est de faciliter l'accès à l'histoire, de s'assurer que le lecteur comprenne.
Alors bien sûr, un texte trop simple à comprendre est plat. Le non-dit, l'implicite, est non seulement nécessaire (puisqu'une fois encore, on ne peut pas tout narrer, on sélectionne) mais aussi infiniment riche en faisant participer le lecteur : c'est même explicite dans le genre de l'enquête où c'est le but que de s'efforcer à deviner la fin. Un lecteur qui n'a aucun effort à faire va s'ennuyer prodigieusement.
Mais on va quand même lui tenir la main, en lui disant sur quel objet se focaliser afin qu'il n'ait à réviser que quand on le veut - la surprise - toujours pour qu'il y gagne quelque chose.
Comment détecter la saturation ?
Je vais étaler ici quelques recettes de cuisine, rien de véritablement formel. Et pour commencer, reprenons la division classique : histoire en chapitres, chapitres en parties (ou pages ?), parties en paragraphes, paragraphes en phrases et phrases en passages (avec ou sans virgules). On peut descendre jusqu'au syntagme mais calmons-nous, de toute manière le phénomène de saturation ne devient véritablement apparent qu'à partir de la phrase ou du paragraphe. Pour gagner de l'espace, prenons mon écriture favorite, où je saute des pans entiers de l'action :
Le train passa, caravane d'acier, une cavalcade à ses côtés, la main à la barre, dedans déjà, pistolet en main.
Et là je suis gentil mais ça peut devenir cryptique très vite. Si vous avez compris, un cavalier a sauté à bord d'un train. Sauf que pour le lecteur, on a commencé par parler d'un train - c'est son objet - et soudain on lui parle d'une cavalcade. Le consonantisme en /k/ suggère que c'est toujours le même objet mais un train n'a clairement rien à voir avec la chevauchée (ou alors il faut forcer un peu pour retomber sur ses sabots...) et "à ses côtés", en référant au train, le renforce. Le texte dit clairement de changer d'objet. Puis on parle d'une main et d'une barre et qu'est-ce que ça a à voir avec des chevaux... mais on a déjà sauté "dedans" et après un long calcul, oui, c'est le train ; on ne peut qu'espérer qu'à ce stade le lecteur a eu le temps de fabriquer, à partir de la "main", l'objet du cavalier sur lequel se focalisent sans jamais le mentionner les deux tiers de la phrase.
Mais le lecteur lit vite. Très vite. En général il a déjà fini la phrase avant de se rendre compte qu'on ne parle plus de la même chose à la fin qu'au départ. Ce genre de narration lui demande d'avoir le nez collé sur l'encre pour ne pas rater le moment où il doit sauter de voiture. C'est épuisant. C'est très plaisant, si vous vous souciez d'user du moins de mots possible, mais après quelques paragraphes de ça votre lecteur devrait être mort.
D'où notre tendance à attendre une nouvelle phrase pour changer d'objet. Voire, assez souvent, d'attendre un nouveau paragraphe.
Le train passa, caravane d'acier, roues crépitantes dans la nuit tombée. Une cavalcade à ses côtés, affolée, excultante. Main à la barre, dedans déjà, le pistolet en main.
J'ai brisé ma phrase en trois, à chaque fois qu'on changeait d'objet : la première, le train. Le second, le cavalier. La troisième réunit les deux. Je n'ai pas à me soucier de comment le lecteur va traiter mes roues et ma nuit : elles font partie de la même phrase et vont donc tomber dans cet objet "train" typique du far-west. Mais à chaque fois j'ai allongé les deux premières phrases et la raison est simple : le lecteur lit vite. Je veux lui laisser le temps de traiter le début de phrase pendant qu'il la finit. Si j'avais fini la première phrase comme à l'origine, il aurait fait "mais pourquoi on me dit 'caravane d'acier', ça mène où ?" C'est la dernière chose qu'il a lue et il ne sait pas si ça modifie l'objet "train" ou si c'est un nouvel objet (voire si le "train" doit modifier cet objet, ça peut tout à fait arriver). En en rajoutant une couche je lui fournis de nouveaux indices : ce sont les roues du train, c'est évident, et donc oui tout cela ne fait que qualifier le train, c'est pour faire joli - et lui faire imaginer le fameux "cheval de fer" sauvage. La partie sur les roues n'est pas réellement là pour qualifier le train, elle est là pour lui dire sur quoi se focaliser.
De même pour la seconde phrase. Si je m'étais juste arrêtà à l'original, il y aurait eu mille questions ; mais en qualifiant la cavalcade, je lui dis bien de se focaliser dessus, donc, que c'est un nouvel objet. Et oui, vous pouvez fabriquer le contre-exemple :
Le train passa, caravane d'acier, roues crépitantes dans la nuit tombée. Une épaisse fumée à ses côtés, affolée, exultante.
Notez que je n'ai pas juste pu écrire "la fumée à ses côtés". J'ai dû rajouter "épaisse" dans l'espoir que le lecteur en déduise que c'est la fumée de la locomotive. Mais même si on a changé de phrase, par défaut - et parce que ça coûte moins - le lecteur est toujours en train de modifier le train. C'est son contexte. Donc oui, fumée du train, pas de problème, puis on qualifie - et on se répète. À ce stade ce serait l'occasion de nuancer notre train, de ne pas juste itérer sur son côté sauvage et impressionnant ; mais on n'est pas là pour ça.
C'est la "cavalcade" qui indique un nouvel objet et c'est donc au texte, avant que le lecteur n'ait à faire l'effort, de lui dire de modifier ou de changer de focalisation. Ce qui n'était que de la description de routine devient alors l'indice de focalisation. Voilà.
On a maintenant deux objets, et le lecteur a le "cavalier" (ou peu importe quelle étiquette il lui donne, si ça se trouve il imagine un troupeau de buffles) en tête. La troisième phrase commence par une main, c'est le bon objet, puis une barre, puis dedans, et on pourrait insister plus lourdement pour indiquer au lecteur de réactiver le train. Notre cavalier y monte, le train fait désormais partie de notre objet "cavalier" qualifié à partir de là comme étant "dans un train".
Voilà la logique, et voilà pourquoi la surenchère d'adjectifs peut devenir un piège.
4. Conclusion
Revenons au passage qui m'a valu toutes ces réflexions :
... amas de pierres fumantes au sein d'un bouillon d'eau infecte...
Ce passage arrive déjà en fin d'un phrase assez chargée qui essaie d'enchaîner beaucoup d'objets (dont la pierre et l'eau) pour décrire toute une scène. Et mon probème est simple, le lecteur termine sur une structure qui met la pierre en avant - l'eau est dans un syntagme prépositionnel qui qualifie la pierre - mais cette eau est elle-même absurdement détaillée : bouillon, infecte... Et donc le lecteur est en train de recevoir des signaux contradictoires. L'eau n'est pas importante, mais l'eau est l'objet sur lequel la phrase s'arrête et dépense beaucoup d'efforts à décrire.
Ma crainte à cet endroit n'est pas que le lecteur décide soudainement de s'intéresser à l'eau, d'en faire un objet à part. Déjà, la mémoire est là, le contexte est censé l'avoir fait attendre qu'on parle d'eau, il sait à quoi s'en tenir. Ensuite, le lecteur est habitué, sinon au style du texte au moins aux conventions du genre ; il sait qu'on va lui décrire de menues choses qui ne reviendront jamais ; il n'a aucune incitation à se passionner pour des flaques d'eau. Enfin, comme dit, la structure même de la phrase subordonne l'eau au reste.
Ma crainte porte sur l'adjectif "infecte".
Parce que ma phrase est en train de créer un objet (ou plutôt de "réactualiser" un objet), que le lecteur doit se focaliser sur cet objet, que je suis focalisé sur cet objet et je ne suis donc pas à en train de parler d'eau mais de cet objet. Disons que ce soit la pierre fumante. Or, j'ai qualifié l'eau d'infecte. Le lecteur, donc, va se dire : "l'eau est infecte, l'eau fait partie de l'objet, donc l'objet... est infecte ?" Ce qui n'est pas fauuuuuuuux... mais pas ce qui m'intéresse et donc pas ce qui doit intéresser le lecteur. Si l'eau s'était trouvée ailleurs dans la phrase, ce qualificatif aurait été assez vite oublié, mais elle se trouve à la fin. Et pour ne rien arranger, il y a une répétition d'adjectifs, ce qui réduit le contraste.
... Je ne vais pas parler de contraste ici mais on évite les répétitions pour que le lecteur remarque quand quelque chose change. Ici, à force de coller des adjectifs à tous les noms, les adjectifs s'effacent ; or pour moi, ce qui compte, c'est que le lecteur comprenne que la pierre est chaude. "Fumantes" devrait donc être l'adjectif saillant et "infecte", rien qu'en existant, l'atténue.
Dans la réalité je n'ai passé que 10-12 secondes sur cette phrase, mais elle m'a posé suffisamment problème pour que j'écrive tout ça à son sujet.
Et si j'ai conservé - de dépit et par obstination - l'adjectif ici, une écriture moins lâche aurait cherché à s'en passer, ce qui aurait sans doute appelé à restructurer tout le passage, voire toute la phrase. C'est ce genre de choix que, sans y penser, on fait des centaines, des dizaines de milliers de fois en écrivant.