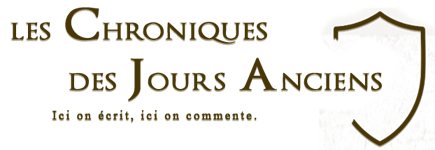Depuis le chemin de ronde de Fort Locarnal, on ne peut pas voir la ligne vierge de l’horizon, et les paisibles montagnes qui marquent la frontière avec l’inconnu, avec des territoires délimitées par la seule imagination des arpenteurs qui n’en sont pas revenus mais ont laissé, à travers les siècles, des témoignages beaux et contradictoires. Depuis le chemin de ronde de Fort Locarnal, quand la nuit est tombée, le brouillard est si épais qu’on ne fait que deviner l’horizon, quand seulement on sait sa présence, derrière la nappe huileuse montant du vieux fleuve. Depuis le chemin de ronde de Fort Locarnal, on ne fait que savoir les formes ; elles se dessinent en négatif, avec en arrière-plan les paisibles montagnes.
Les hommes de fort Locarnal le savent, et leurs yeux sont habitués à ne pas voir, mais à saisir et prendre ce qui leur est laissé, pour inventer le reste. C’est pour conjurer la peur qu’ils lèvent leur vieux tromblon à poudre sèche quand un bruit monte du brouillard ; ils s’observent l’un l’autre, cherchent sous les ombres pourpres de la lumière de lune la même étincelle de peur qu’ils devinent sur eux-mêmes. D’un côté à l’autre du chemin de ronde, ils se font signe ; toujours le même signe qui ne veut pas trahir l’inquiétude tout en la suggérant. Les claquements de leur casque résonnent dans la nuit quand ils traversent le chemin de ronde, comme s’ils voulaient avertir le capitaine de ce qui se trame, entre les signes, à la lumière de la lune ; ce claquement régulier est l’alarme sourde qu’ils destinent à l’officier de garde. Lui sort de la torpeur où l’avait plongé un demi-sommeil aux multiples et délicieux rêves et interprète le ballet des silhouettes progressant sur le chemin de ronde, de la tour est à la tour nord. Des ombres. De simples ombres qui s’arrêtent, qui pointent du doigt l’horizon impalpable, qui semblent parfois se tourner au hasard vers son petit baraquement. Il se lève. Il glisse à sa ceinture un large poignard de chasse dont il sait qu'il ne se servira pas mais qu'il aime avoir en main, comme un jeu. Il est maintenant suffisamment proche pour écouter, mais suffisamment loin pour ne pas être vu – à moins que ce ne soit les ombres qui le masquent de ses soldats craintifs pour qui l’ombre est le danger.
« Là ! »
« Où ça ? »
« Là, à côté du buisson. Là où ça perce. »
« Ha ! Là ! »
Le silence. Le capitaine devine ses soldats en train de placer leur main en visière, comme s’il y avait un soleil pour éblouir, ou comme pour se persuader qu’ils cherchent, alors qu’ils évitent. Depuis le début de cette guerre, ils évitent. Depuis que la horde d’Abigard Rasmussen a annoncé son intention de conquérir les Cités de l’Ouest mais que rien n’arrive, tout s’évite, tout s’attend, tout se dissout dans l’incertitude. On ne sait par où il viendra. On ne sait quelles seront ses forces exactes, quelles seront ses intentions et sa cruauté ; alors la peur se dissout dans l’attente et fort Locarnal se décompose quand la nuit vient, que le brouillard masque l’horizon, et que la lumière de la lune donne aux choses des contours trop incertains pour juger. Le capitaine serre ses doigts sur le manche d’os de son poignard pour conforter le jeu et contrefaire l'idée que fort Locarnal est loin derrière la frontière – si frontière il y a, car la frontière est apparue avec la guerre : avant, il y avait les montagnes, il y avait le fleuve, il y avait la lisière des champs et les côteaux des collines. Maintenant il y a la frontière, qui est le mot pour désigner là d’où la horde d’Abigard Rasmussen, avec son incroyable cavalerie motorisée, peut jaillir ; si elle jaillit un jour. A fort Locarnal, la frontière s’évite.
« T’as raison, il y a quelque chose. Il y a le mouvement. Et ce n’est pas le vent, c’est trop régulier. Ce n’est pas un animal, non plus : un animal, ça se cache, ça s’arrête, ça hume. »
« C’est peut-être une de nos expéditions qui revient. »
Pas d’expéditions depuis une semaine, pense le capitaine en se calant entre deux ombres, celle du poteau, et celle du tonneau.
« Pas d’expéditions depuis une semaine. Ce n’est pas une expédition. Et ils nous auraient fait signe, avec la lumière. »
« Alors il faut prévenir le capitaine. »
« Oui, il faudrait prévenir le capitaine. »
« Ça se rapproche. Ça vient vers nous. Il y a de la poussière dans le brouillard. C’est plus flou.
« Il faut prévenir le capitaine. »
« Je suis là, soldats. Repos. L’un de vous me rapporte ce qui se passe. »
Il est sorti de l’encoignure de la tour nord, après avoir lui-même scruté à l’intérieur du brouillard. Lui n’a pas peur de voir, alors il a cherché. Et il s'est satisfait de ne pas plus comprendre que ses soldats les frontières des figures dessinées dans le brouillard. C'est l'inconnu qui vient. C'est la surprise.
« Il y a une forme qui bouge, loin, dans le brouillard, mon capitaine. On ne sait pas ce que c’est. C’est trop loin. Mais ce n’est ni le vent, ni un animal, ni une de nos expéditions. »
« En effet, il n’y a pas d’expéditions depuis une semaine. »
Il se tait. Les deux soldats n’osent pas parler. Ils sentent autour d’eux les autres sentinelles nocturnes, des tours sud et ouest, qui n’ont pas quitté leur poste mais suivent à distance l’incident. Ils ont compris d’où vient le danger, mais ils préfèrent suivre ses représentations déformées dans les gestes de leurs camarades plutôt que d’y faire face eux aussi. On dit que la horde d’Abigard Rasmussen est immense, qu’elle fonderait sur les Cités de l’Ouest en une seule journée, qu’elle réduirait en esclavage les survivants, et qu’ils s’y plieraient pour éviter la mort atroce dont ils avaient été les témoins. Les hommes de fort Locarnal sont des vagabonds, des orphelins, des errants, de trop jeunes recrues que la guerre a saisi comme une aimable geôlière, dont les sourires masquent la cruauté. Le capitaine pense brièvement à eux, comme il les sent, puis son rôle l'incite à ne pas bouger, dans le noir.
« Attendons alors. »
« Attendre quoi mon capitaine ? »
« Que l’on puisse y voir quelque chose. Que l’on puisse y voir mieux qu’avec ce brouillard. Cela finira bien par se rapprocher. »
« Bien mon capitaine ! »
« En attendant, allez prévenir les artilleurs et sortez le canon à mitraille. Au cas où. On ne sait jamais. »
« Bien mon capitaine ! »
Les sentinelles de nuit s’agitent, enfin, et cessent de penser. Car les unes doivent aller réveiller les artilleurs, et les autres armer le canon à mitraille. Le capitaine ne cesse plus d’étudier le petit nuage de fumée qui grossit à l’intérieur même du brouillard. Se peut-il qu’Abigard Rasmussen envoie un éclaireur, ou qu’il envoie un piège, ou qu’il envoie n’importe quoi d’autre qui annonce le degré de ses intentions ? Au moins, ça se passe, et il serait fixé, et il pourrait en rapporter à ses supérieurs, à Mannen. Quand la forme est suffisamment proche, le capitaine commande à deux de ses soldats de lui trouver un large brandon de bois garni de poix et de l’allumer, puis de le lancer le plus loin possible, mais pas trop, pour que, l’espace de quelques secondes, on puisse déduire des détails plus fins d’une lumière plus vive. Le feu se répand sur l’herbe rase et humide de la steppe. Il ne durera pas longtemps ; la neige étouffe. Ils sont trois à scruter, mais un seul à regarder vraiment.
Quand les artilleurs arrivent, que le canon à mitraille est prêt, qu’ils attendent les ordres du capitaine, on leur dit de retourner se coucher. Non, de rentrer le canon dans l’entrepôt d’abord, car il n’y en aura pas usage cette nuit. Ce qu’on a vu à la lumière des feux ne demande pas l’usage du canon, mais n’est pas pour autant rassurant. Voilà tout ce qu’ils arrivent à tirer de leurs collègues, massés autour du capitaine.
« Ouvrez les portes ! »
On ouvre les portes et c’est comme si tout le brouillard des abords de fort Locarnal se laissait happer et se déversait entre les casemates, les tentes et les armureries. Avec lui vient le froid. Avec lui vient la forme rampante et pantelante d’un vieil animal, d’une bête épuisée qui ralentit son galop. Personne n’a plus vu ce genre de bêtes depuis des lustres. C’est un animal rare, disparu avec l’Apocalypse, symbole d’un passé que plus personne ne sait reconnaître. Alors on conforte sa peur et on s’écarte, en cercle, ainsi que le font les prédateurs effrayés. L’animal porte sur son dos deux petites figures comme des sacs endormis. L’un d’eux bouge, comme s’il s’éveillait, alors qu’il ne fait qu’épier la masse d’hommes qui l’observe et se fait sur lui milles idées, plus fausses les unes que les autres, s’il en est une de vraie. Il faut que quelqu’un parle. C’est le plus jeune des lieutenants du fort, celui qui croit qu’on l’a envoyé ici pour se battre, alors qu’il n’est là que par une obscure vengeance connue de tous. Il désigne un homme, un soldat à qui il tient rancune pour une histoire de dénonciation abusive.
« Vous ! Dételez les enfants. Et amenez le cheval dans l’armurerie, pour le faire reposer. »
C’est comme si il les nomme, se dit le capitaine en entendant “enfants” et “cheval”. C’est comme s’il les nomme et choisit parmi toutes les explications possibles la sienne et en fait aux yeux de tous la plus plausible. Il aurait aussi bien pu faire fusiller l’ensemble, bête et figures, mais maintenant ce sont des enfants et on ne fusille pas les enfants ; on ne fusille pas les chevaux car ils sont bien trop rares. Le capitaine prend le garçon par la main. Il lui arrive à mi-taille et se frotte les yeux, pour continuer de faire semblant. Il se laisse conduire à l’infirmerie où l’on a réveillé le médecin du fort. On l’installe entre une fracture du tibia et une pneumonie, car il n’y a guère de place ailleurs. Mais il s’endort aussitôt, et pour de vrai cette fois. Le capitaine se rassure en même temps qu'il l'admet. Ce n’est rien, presque rien, qui a remué le brouillard et la nuit. Rien qui n’ait à voir avec Abigard Rasmussen, ni avec la guerre. Pour l’instant, du moins.
Plus tard, on apprend que la fille est morte, depuis longtemps, de froid, sans doute. Le cheval a continué à la porter sans même s’en apercevoir.
Les jours qui suivent, on interroge le garçon. Mais il ne dit rien. Plusieurs versions se confrontent. Les uns disent que c’est un espion d’Abigard Rasmussen, dont la fourberie est légendaire, et qui n’hésiterait pas à utiliser le masque de l’innocence pour vaincre. Les autres disent qu’il fuit l’armée d’Abigard Rasmussen, qu’il vient du village de Fargo, sur les pentes des montagnes, à la frontière. Mais le garçon, on finit par l’aimer quand il sourit, quand on lui apprend à se servir d’une arme dans l’arrière-cour, quand on lui raconte des histoires, ses histoires, avant de le border entre une fracture et une pneumonie, dans l’infirmerie. Le capitaine écoute ses hommes. Comme eux tous, et parce qu’il est leur synthèse à tous, il finit par se plier à l’idée de la fuite depuis les montagnes, même s’il sait qu’il n’y a pas de cheval à Fargo, même s’il sait qu’il n’y a plus d’enfants à Fargo depuis des années, même s’il sait que Fargo est au sud de fort Locarnal.
On oublie la peur nocturne et les conjectures effrayantes. On oublie l’attente, et le froid qui s’engouffre avec le brouillard dans le fort à la lumière de la lune. Un jour, au crépuscule, avant que le brouillard ne tombe à nouveau, l’horizon se peuple encore, mais avec plus de force et de certitude, cette fois. Une figure, puis deux, puis trois, puis un attelage et des guenilles, traînant leurs pattes sur la neige qui se dépose en flocons de plus en plus épais. Elle bouche la vue, cette neige, pire que le brouillard. Les hommes du chemin de ronde commencent à se rassembler du côté sud. Une sentinelle, puis deux, puis trois, puis viennent les artilleurs et le médecin et les lieutenants. Le capitaine les voit s’agiter depuis son office mais ne bouge pas. Il saura assez tôt ce qui se passe, et presque s'en désinteresse.
Les soldats s’interrogent. Que se passe-t-il ? demande l’un (mais la question vaut pour tous). Les armes caquètent les unes contre les autres, se bousculent, et les mains se prolongent en visières et en index pointés. C’est un homme, ce sont des hommes, dit-on. Là, c’est un boeuf qui tire la carriole. On ne les voit pas à cause de la neige, ce sont des statues de neige. Et si ce n’était que les formes que dessinent les flocons quand ils retombent ? Et si ce n’était que les reflets du soleil qui nous fait une farce avant de se coucher ? Non, il y a bien des hommes, mais aussi des femmes. Les hommes sont vieux et leur barbe se confond avec neige, qui est sale de ne pas assez rester sur le sol de la steppe. Les femmes portent des robes claires et usées. La fuite. Les pattes des boeufs se soulèvent avec difficulté, à cause du froid et du chemin qu’ils ont du parcourir. Depuis où ? Depuis Fargo ! Ils fuient Fargo ! Le garçon n’était qu’un éclaireur qui aurait dû nous prévenir ! Nous prévenir de quoi ? La horde ! Elle arrive ! La horde d’Abigard Rasmussen ! Ils fuient la horde qui va attaquer Fargo. Il faut préparer les canons à mitraille. Ça ne suffira pas ; et d’abord ouvrir les portes pour laisser entrer les fuyards. Et qui vous dit que ce ne sont pas aussi des espions de Rasmussen, des soldats déguisés en vieillards et en femmes ? Il suffit de barbes et de robes, de jouer avec la neige et le brouillard qui va tomber, de se traîner lentement, de sacrifier quelques boeufs fatigués. Alors il vaut mieux ne pas ouvrir les portes tout de suite, pas avant d’être certains, absolument certains que ce ne sont pas les hommes d’Abigard Rasmussen.
Un des lieutenants allume une torche de poix. Il la jette juste devant la meute de vieillards et de femmes. Ils s’écartent et poussent des cris. La torche s’éteint aussitôt, asphyxiée par le manteau de la neige. Les brandons survivent encore quelques instants mais ils n’éclairent rien. Depuis le chemin de ronde, on distingue les braises comme de minuscules insectes rouges crépitant et dansant, alors que le poids du brouillard s’abat sur les épaules des soldats et que la disparition du soleil masque encore davantage les visages des vieillards et des femmes, qui ne bougent plus.
« Qui êtes vous ? D'où venez-vous ? »
Le jeune lieutenant s’est saisi du porte-voix en cuivre, et ses mots ont fait craqueler la neige, ont tendu la nappe de brouillard, ont vu frémir, d’un côté et de l’autre du chemin de ronde, les deux foules qui se font face. Dans la neige, on voit une silhouette qui jaillit du groupe antagoniste et s’élance avec une torche dans la main. C’est un flambeau qui perce encore plus le vide de la steppe, vers le fort et s’immobilise au premier coup de feu tiré depuis le chemin de ronde. La cible est manqué, le soldat a tremblé ; c'est un geste manqué. Le lieutenant cherche du regard le tireur, car il veut le désigner volontaire pour aller parlementer avec le groupe adverse ; mais comme il ne le retrouve pas, car tous les visages des soldats sont absolument identiques dans le fond du brouillard, il désigne logiquement l’homme à sa droite, en murmurant son ordre comme si la neige l’étouffait, lui aussi. Tous le détestent quand même.
« Prenez un véhicule et allez comprendre ce qu’ils veulent. »
Quand ils sont bien identifiés, quand il ne fait plus aucun doute que ce sont bien des vieillards, que ce sont bien des femmes, qu’ils viennent bien de Fargo, plus au sud, on fait entrer les réfugiés dans le fort. Ils parlent d’une armée qui se serait posté aux abords de Fargo, à la frontière. Ils parlent de la menace, et de la fuite des faibles quand les hommes sont restés pour défendre à l’attaque. Ils parlent de visages putrescents des créatures sans noms et des bêtes de cauchemar que montent les horreurs garnies de tentacules et de cornes aux endroits les plus improbables. Ils parlent d’une armée qui n’est pas une armée mais une nuée infernale de cafards prêts à les dévorer. Ils parlent de boucs à deux têtes, ils parlent d'hommes-serpents, ils parlent de masses informes qui se recomposent sans cesse de l'homme à l'animal. Ils parlent de gargouilles gigantesques qui volent en saint-esprit au-dessus de la meute et dont on n'entend que le cri, loin, depuis le chaos. Les mots qui sortent de la bouche des vieillards et des femmes sont des mots oubliés depuis trop longtemps qui rejaillissent et font écho dans l’esprit des soldats aux pires batailles ; à des batailles contre le Mal absolu, se murmure-t-on de dortoirs en dortoirs, à la lumière des petites bougies de veille tremblotantes comme la main qui les porte.
« Abigard Rasmussen a engagé des mercenaires »
« Des mercenaires, qu’en savez-vous ? Peut-être est-ce une autre armée de pillards ! » dit le jeune lieutenant.
« Ce ne sont pas des hommes. »
« Ce sont les racontars de vieillards peureux et de femmes impressionnables. C’est simplement la horde d’Abigard Rasmussen qui attaque enfin. Ils auront mis des peintures de guerre et revêtus des échasses pour se déguiser en monstres, mais ce ne sont rien que des hommes dans de ridicules déguisements de carnaval. »
Le jeune lieutenant a parlé. On envoie un petit groupe de soldats motorisés en éclaireurs, pour comprendre. C’est important de comprendre avant d’agir et avant d’affoler les autorités, à Mannen. On élabore un système de signes lumineux pour communiquer par-delà le brouillard. Un feu allumé signifiera qu’il s’agit de la horde d’Abigard Rasmussen. Deux feux allumés signifieront qu’il s’agit d’une autre armée.
« Est-ce que les habitants de Fargo ont reconnu le garçon, et l’ont nommé ? »
« Non, mon lieutenant. »
« Repos soldat. »
C'est le bruit du moteur de leurs véhicules qui les rassure. C’est un bruit, au moins, ce n’est pas le silence de Fort Locarnal. Ils aimeraient presque cette escapade loin de la peur, s’ils ignoraient qu’elle les conduit à une autre peur, loin dans la neige. Et puis le véhicule de tête freine brutalement. Il aperçoit des silhouettes en marche devant eux. Il n’a pas besoin de le signaler, tous les ont vu, ces silhouettes au pas de course. On sort les tromblons ; on arme le canon à mitraille. On sent le froid qui attaque les soldats immobiles, qui les mord aux chevilles et aux coudes, et on le chasse d’un revers de main, comme on chasserait une mouche. Du loin :
« Fargo ! Fargo ! »
Ce sont les hommes de Fargo. Personne n’ose suggérer qu’il s’agit peut-être de la horde d’Abigard Rasmussen déguisées en hommes de Fargo. Personne n’ose rien suggérer.
« Fargo ! Fargo ! »
Le vent commence à souffler et se joint au froid pour attaquer les soldats. On sent les flocons de neige, épais, lourds et lents, quand ils retombent sur les mains et l’appuient, la forçant vers le sol.
A présent, un lieutenant fait reposer les armes. Il veut allumer un feu pour signaler à fort Locarnal qu’on a retrouvé les hommes de Fargo, qu’ils fuient eux aussi la nuée de mercenaires infernaux d’Abigard Rasmussen, qu’ils préfèrent tout abandonner plutôt que de mourir entre les griffes et les crocs de tels monstres, de tels monstruosités. On demande au lieutenant combien de feux il faut allumer. Il hésite. Le code n’a pas prévu ce cas de figure. Le code est prévu une fois que les éclaireurs ont rejoint la horde, et l’ont identifié. Alors le lieutenant abandonne. Les éclaireurs poursuivront leur route jusqu’au village ; un soldat accompagnera les hommes de Fargo jusqu’au fort. Il pleure presque en entendant l’ordre, et ses larmes se gêlent aussitôt dans l’air.
Quand on arrive à Fargo, le village est vide et les mercenaires d’Abigard Rasmussen ne sont plus à l’horizon. Invisible, ils n'existent plus que dans les esprits des soldats, l’arme au bras, la main à la crosse, le doigt sur la gachette, la neige qui se dépose sur le canon. Un soldat entend un bruit, loin. Il se retourne. Il tire. Ce n’est rien qu’il a touché, juste un oiseau qui semble chuter lentement, retenu par ses plumes, minuscule au loin. Quand on va pour trouver le gibier, il n’y a rien, et on se dit que ce n’était qu’un flocon, qu’on a pris pour un oiseau, qu’on a pris pour un monstre.
« Qu’est-ce qu’on fait mon lieutenant ? »
Il regarde l’horizon qui semble luire, parce que la lumière sur la neige produit des reflets des ombres, et il lui prend que ce n’est que ça, que les habitants effrayés par le climat et l’attente ont vu, depuis les fenêtres sales de leurs petites maisons de couards ; la même peur qui a transformé le flocon de neige en un ennemi invincible. Alors il a envie d’ordonner à ses hommes de rentrer au fort, que la guerre n’est pas pour aujourd’hui, mais il se rend compte qu’il n’y a pas de code pour le signaler. Alors il ne reste que le langage des reflets de l’horizon, et la peur qu’il faut exorciser sur le visage des soldats.
« On avance. On continue vers le sud. On trouvera. »
Tous le savent quand la frontière est passée. Les montagnes sont franchies et le froid attaque, plus puissant encore, sur son terrain. Le lieutenant sait qu’aucune carte ne mentionne les territoires au-delà des montagnes, mais il veut savoir, parce qu’il est curieux et qu’il tuerait tout ses hommes pour savoir.
« Là ! »
Un des soldats à l’avant-garde tend le bras. Il murmure. Il s’immobilise, comme s’il imitait un animal apeuré, perché sur la crête. Le lieutenant lui demande ce qu’il a vu. Il répond en posant l’index sur la bouche, parce qu’il faut se taire, parce que le silence et l’ignorance deviennent plus importants que la parole et le savoir. Le lieutenant se hisse à son niveau, sur la crête, sans dépasser. Il voit les contours d’un bâti humain, carré, avec une grande cour en son centre, en contrebas de la crête, et des tours à chaque coin, et un chemin de ronde. Le tout est figé dans le blizzard, comme un énorme insecte pris dans la glace. Il espère un instant qu’ils sont revenus sur leur pas et qu'ils ont face à eux fort Locarnal : les boussoles ont pu se tromper et les faire rebrousser chemin. On n’aura pas reconnu les abords recouverts de neige, car la neige déguise tout, et transforme l’homme et ses réussites en sculptures indistinctes et molles, et mortes. On aura imaginé l’ennemi et la frontière, alors que tout n’est qu’une seule illusion des climats, une farce du temps, du soleil allié à la neige et du brouillard allié aux montagnes – mais le fort semble vide, et les montagnes trop hautes, et le drapeau tendu claquant à la tour nord est celui de la horde d’Abigard Rasmussen. Sans savoir, le lieutenant ordonne à ses hommes de dresser le camp sur le plateau, en vue du fort mais hors de vue de l’ennemi. Il ordonne à deux des hommes d’allumer un seul et unique feu pour signaler à fort Locarnal qu’il s’agit bien de la horde d’Abigard Rasmussen. Puis attendre, car d’ici ils peuvent les surprendre, et apprendre, et savoir enfin, en attendant les renforts qui devraient arriver. C’est la neige qui incite à l’attente, se dit le lieutenant pour se rassurer de sa propre folie, un peu.
La nuit, sous les réseaux des tentures qui résistent aux vents, on raconte. On raconte des histoires de guerres qu’on croyait enfouies mais que tous connaissent, au fond d’eux. Il y a ce dragon qui fond sur le village au bord du lac et le feu qu’il répand en queue de comète brandonne les maisons de bois, les anéantit, et les hommes sortent pour le chasser à coup de cailloux ; mais il les brûle et les tue. Il y a l’immense armée d’orcs sortis des sources de boues fétides des entrailles de la terre, et transformé en machines prêtes à tuer tout ce qui passe. Il y a le château mystérieux, endormi, froid le jour et au printemps quand tout est paix, mais dont sort, quand la nuit tombe sur l’hiver, une gigantesque horde de fantômes armés de lances et d’épées rouillées mais tranchantes, et d’arcs biscornus qui lance des flèches empoisonnées. Les soldats grimacent, les soldats miment, les soldats prennent des voix de cavernes pour faire semblant d’être des trolls et des elfes sauvages. Le château est piégé de multiples miroirs labyrinthiques et de trappes mortelles. Il y avait ces croyances, dit-on, avant l’Apocalypse, et peut-être étaient-elles vraies, au fond, ces croyances immodérés en des illusions magiques. Peut-être était-ce vrai, tous ces récits de batailles dans la neige et le froid et le malheurs du temps, car après tout la guerre n’est pas une invention de l’Apocalypse, dit-on, elle a toujours été et a toujours pris ses formes de monstres vengeurs contre l’humanité paisible. Ils sont des errants, des vagabonds, des orphelins, qui ont besoin d’histoires et se souviennent du fond de leur mémoire, du fond de leur propre obscurité masquée par la peur... Le lieutenant a sa propre tente mais il voit, en ombres, les gestes expressifs de ses soldats qui traduisent en signe chacune des chimères archaïques.
Après une journée à scruter le fort de la horde d’Abigard Rasmussen, il ne fait plus de doute qu’il s’est vidé de tout. Pas de sentinelles sur le chemin de ronde, ni de lever, ni de coucher. La nuit éternelle du brouillard de ses régions semble avoir métamorphosé le fort en un fossile de légende. A la fin du jour, le lieutenant décide d’aller explorer le fort. S’il n’y a rien à craindre, c’est que l’armée d’Abigard Rasmussen n’existe pas, en fin de compte, et que les Cités de l’Ouest ont déjà gagné le combat. Il envoie quelques uns parmi les soldats. On se rappelle les histoires du château fantôme et de son armée immortelle. En rampant dans la neige qui rentre dans le cou et l’anéantit, qui coupe le souffle, qui transperce le coeur de partout, on pense aux phalanges dociles du seigneur des morts révéillé par l’inconscience d’imprudents visiteurs.
Un tir depuis le chemin de ronde ! L’action fait oublier que la guerre n’est pas qu’en rêve et en esprit, qu’elle est aussi par eux, et qu’ils en font partie, d’une histoire de guerre. On répond au tir par plusieurs rafales, mais en face ne vient qu'un tir, à nouveau. Ils sont si espacés qu’on en déduit que les assaillants sont peu nombreux. Alors on cesse le feu et on attend, les uns couchés sous un buisson de graminées seches, les autres s’abritant derrière un énorme rocher couvert de givre. Plus de tirs. On scrute le chemin de ronde pour y voir la face difforme d’un des monstres d’Abigard Rasmussen. Un des soldats sent le courage, par l’action, et par les histoires de guerre qui sont aussi des histoires de courage. Il se lève de son buisson, évite un premier tir, jette un regard vers le chemin de ronde, ne voit qu’une face, et continue alors jusqu’à la porte du fort, éventrée.
Quand il arrive dans la cour, il fait face à un homme qui tient un fusil. Il ne se distingue de lui que par son crâne rasé, et c’est ce seul indice qui fait dire au soldat que l’ennemi n’a pas piégé la place de miroirs pour les forcer à s’entretuer, comme un piège des vieux châteaux. Qui est-il ? Un soldat de la glorieuse horde d’Abigard Rasmussen, répond-il. Que fait-il ici, dans le silence et la solitude ? Tout ses camarades ont fui le fort, mais lui veut rester jusqu’au bout, pour l’héroïsme, dit-il, et parce qu’il ne croit pas à la peur. Pourquoi ont-il fui le fort ? Le soldat d’Abigard Rasmussen, l’homme au crâne rasé pose son fusil au sol et s’assied en tailleur à même la neige. Le soldat de fort Locarnal fait de même et il écoute le silence. Puis il écoute l’histoire que lui raconte le soldat d’Abigard Rasmussen.
« On était sur le chemin de ronde, avec les armes affûtées, parce que l'attaque était pour demain. Pour demain ! Nous allions attaquer Fargo, et on en parlait entre nous, ça, oui, on en parlait entre nous ! Des femmes de Fargo ! De la bouffe qu'on allait trouver là bas, en quantité ! De la peur qu'on allait vous mettre aux tripes ! On était tous impatients et ça discutait sur le chemin de ronde, avec des clins d'oeil.
Et soudain, Karl a dit un truc comme : « Ils sont là ! ». On a couru vers lui, sur le chemin de ronde, sur les planches de bois qui craquaient presque tellement on courait vite et en désordre. « Ils sont là ! » qu'il disait, et il tremblait comme une vieille femme. Nous, on regardait par où disait son doigt, mais on voyait rien. Que le brouillard. Et un peu de neige, qui commençait à tomber. Un peu de neige, en flocons qui se voient à peine. Le chef est arrivé, a crié qu'on le reveillait, a demandé ce qui se passait. « C'est Karl qui rêve », qu'on lui a dit, et on a tapé sur l'épaule du vieux Karl, qui tremblotait de plus belle et on aurait dit qu'il allait pleurer. Le chef lui a mis une baffe, puis une deuxième. Alors Karl a crié, et il a crié tellement fort que ça résonnait partout dans le fort, et que ça a réveillé tout le monde, et pas seulement dans les lits, mais dans les têtes, aussi : « Les créatures d'outre-espace sont là ! ». Comme il pointait encore son doigt, on a regardé, tous.
Sur le plateau, on a vu les horreurs. Les pointes aiguës des montagnes, elles étaient éclairées par les lumières surnaturelles des vaisseaux venus de l'espace, et ce qu'on avait pris pour du brouillard, c'était de la fumée qui jaillissait de leurs turbines et de leurs moteurs, des gros engins qui ne pouvaient avoir été construit que par les créatures d'outre-espace dont parlent les histoires que nous racontent les bardes qui viennent parfois avec les filles, le vin et la musique, et qu'on se redit, dans les chambrées quand il fait froid. Ils parcourent le ciel depuis un nombre d'années qu'on ne peut pas concevoir, qui se compte en millénaires, ou en années-lumière, et quand ils trouvent une planète qui leur va, ils détruisent toute la vie qui se trouve dessus et installent leur base atomique, et leurs laboratoires pour mener des expériences sur les survivants qu'ils mettent en esclavage. Ils on besoin de la vie pour se nourrir, de la vie, et c'est pour ça qu'ils ne tuent pas tout le monde. Mais leur laser sont si puissants qu'on ne peut rien contre eux, avec nos petites mobylettes et nos mitrailleuses qui s'enraillent comme de rien.
Et ce soir ils étaient là, sur le plateau, à pointer leur tête pleine de tentacule et à éclairer la nuit de leurs rayons laser rosâtre, bleuâtre, jaunâtre, comme des faisceaux jaillissant des sommets vers l'infini de l'espace. Moi, je voyais cinq vaisseaux identiques qui planaient en suspension derrière les montagnes, mais Jonas en voyait trois autres, et la Fouine encore deux de plus, et Karl encore trop qu'il se mit à gerber. Le chef criait contre l'armée de tripodes qui se mit à apparaître, depuis l'autre versant, et à nous encercler en pointant sur nous leurs armes diaboliques. Il disait que les Cités de l'Ouest avait fait alliance avec les créatures d'outre-espace, et que c'était pour ça qu'elles n'avait pas cédé face à la grande horde d'Abigard Rasmussen. Il disait de préparer les mitrailleuses et même les vieux canons de dix, qu'on allait leur en faire voir, aux lutins du cosmos ! Mais l'instant d'après il avait déjà changé d'avis, parce que juste au-dessus du fort, on ne voyait plus la Lune. On voyait un kaléidoscope de projecteurs braqués sur la cour et le chemin de ronde qui nous masquait la vue du plus gros monstre d'acier à avoir jamais traversé l'espace. On entendait la respiration de leur ventilo, énorme. « Le vaisseau amiral ! » cria Karl.
Moi, je regardais les tripodes et je rêvais. Je regardais les tentacules qu'on ne savait pas si c'était leur bouche, où si c'était des pseudopodes en métal ; je regardais l'habitacle dans une sorte de matière vitrifiée, peut-être de l'adamantium, je me disais en me souvenant que les bardes colportent depuis des années et des années, et encore plus, j'en suis sûr. J'y ai toujours cru à ces histoires ! J'en rêvais la nuit, de monter dans un de leur vaisseau et de parcourir l'espace, ou de conduire le tripode sur les sols froids des steppes. Ça doit être autre chose que la moto ! Alors quand mes camarades sont tous partis, parce que le chef avait vu que le défilé vers l'ouest était notre seule chance de sortie, je me suis d'abord caché dans un tonneau, et j'ai attendu qu'ils attaquent.
Mais ils n'ont pas attaqué.
Je suis sorti de mon tonneau. Il n'y avait plus rien. Que les montagnes qui me regardaient et se moquaient de moi, avec leurs sourires de pierre. »
Quand ils reviennent à fort Locarnal, après une longue marche dans le froid, dans le vide, dans le silence des mots du survivant du fort qui résonnent dans leurs esprit, répétés et répétés et répétés encore de soldats en soldats, de pas en pas, pas tant pour combler le silence que pour l'alourdir encore, ils ne sont pas surpris de ne pas savoir distinguer les silhouettes des sentinelles sur le chemin de ronde, et pas non plus de traverser la grande porte vastement ouverte. Le lieutenant ordonne vaguement à quelques uns de ses hommes de fouiller, mais il sait déjà ce qui s'est passé, car il s'est répété l'histoire pendant tout le voyage du retour, et la connaît par coeur. Fort Locarnal est vide.
Il se rend vers l'infirmerie. Dans un des lits, entre ce qui fut une fracture et ce qui fut une pneumonie, le garçon est couché endormi. Le lieutenant l'observe un instant et se dit qu'il doit rêver paisiblement, et des beaux rêves à son sourire. Comme un de ses soldats arrive, il lui dit :
« Il ne reste plus que le garçon. »
« Quel garçon, mon lieutenant ? »
Il se retourne et oublie. Les lits défaits à la hâte de l'infirmerie sont vides, et il n'y a pas eu de garçon cette nuit-là de ronde à fort Locarnal.
Fraîchement publiés
Dernières Interviews
Dernières critiques
- Pas de messages à afficher
Fragments d'Apocalypse - Fort Locarnal
Discuter de cet article
Connectez-vous pour commenter