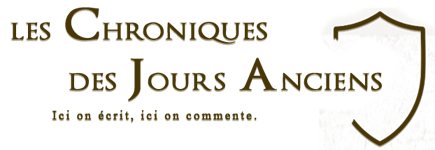C’était la veille de Noël, non loin d’Ypres, à proximité de la ligne de front. La nuit venait de tomber et tout était calme à l’extérieur en raison de l’épaisse couche de neige qui étouffait tous les bruits, lorsque le lieutenant fit irruption dans l’abri, amenant avec lui une rafale d’air glacé qui fit vaciller la flamme du poêle.
Les conversations s’arrêtèrent aussitôt et du coin de l’œil, nous le regardâmes tous en silence brosser la neige de son képi, l’air embarrassé ; il savait que nous connaissions la raison de sa visite et que cela ne nous réjouissait guère, mais il devait faire ce qu’il avait à faire, et cela nous le savions aussi. J’étais resté le nez sur mes cartes, l’air absorbé, comme je le faisais avec mon cahier à la communale lorsque le maître cherchait quelqu’un pour aller au tableau, mais – tout comme à la communale – cela ne me porta pas chance et c’est vers moi que le lieutenant se dirigea, avant de poser la main sur mon épaule en disant simplement ces mots :
- « Allez, Dornon, c’est pour vous. Il faut quelqu’un pour relayer Garrigues à l’avant-poste.
- Vous pouvez pas me faire ça mon lieutenant, pas ce soir !
- On vous gardera de la dinde aux marrons, ne vous en faites pas ! » répondit-il en souriant, et toute la casemate éclata de rire.
Je fis la grimace mais finis par me lever en jetant mes cartes, tandis que le lieutenant ressortait. Je pris ma pèlerine, attrapai mon fusil au passage et ouvris la porte. Le vent froid s’engouffra de nouveau dans l’abri. En jetant un coup d’œil en arrière, je vis que les autres avaient repris la partie de belote. Ils me lancèrent un dernier regard, un sourire gêné aux lèvres, à la fois soulagés de ne pas avoir hérité de la corvée et ennuyés que cela soit tombé sur moi.
Je passais pour un brave gars dans le régiment ; je ne faisais jamais d’ennuis à personne, je prenais ma part des corvées et je rendais service de temps à autre – j’ai toujours été doué pour me tisser des liens utiles avec n’importe qui un peu partout, et en temps de guerre cela peut servir de connaître un type qui peut vous procurer à peu près n’importe quoi grâce à ses relations : chaussures, tabac, chocolat, vêtements, pinard et autres. Parfois, des gars d’autres régiments venaient me trouver pour me passer une commande un peu spéciale : c’était en général des photos de pin-up allemandes – elles étaient beaucoup plus osées que les nôtres, et l’on en récupérait parfois dans les poches des cadavres de boches avec un peu de chance – mais ça pouvait aller jusqu’au casque à pointe ou au Luger, trophées dont les soldats américains étaient particulièrement friands. J’avais donc une faculté presque surnaturelle à me rendre d’emblée sympathique et indispensable où que j’allais, et pourtant ce soir-là pas un des gars n’offrit de prendre ma place pour me faire plaisir… Il ne fallait pas rêver non plus.
L’avant-poste où m’envoyait le lieutenant était un misérable petit trou, universellement haï de tous ceux qui avaient eu le déplaisir d’y mettre un jour les pieds. Planté au milieu du no man’s land, l’endroit était rempli de vermine, dangereusement exposé au feu des mitrailleuses d’en face et surtout situé juste à proximité d’une vieille église et de son petit cimetière aux trois-quarts détruits par les bombardements. Même les moins superstitieux d’entre nous redoutaient d’avoir à y passer la nuit, car les obus tombant sur le cimetière en avaient éventré les tombes, et non content d’y retrouver les morts du champ de bataille, on y trouvait aussi ceux des guerres précédentes, ce dont on se serait bien passé. Le sol gelé y était parsemé d’ossements divers et la Mort, plus qu’en tout autre endroit du front, y exhibait ses trophées de façon obscène et macabre. Et c’était là que j’allais devoir passer la Noël.
J’avais à peine quitté l’abri que je rencontrai le gros Fontaine, qui faisait office de facteur pour notre compagnie. Il m’agrippa le bras au passage et me demanda :
- « Tu vas rejoindre Garrigou ?
- Bonjour Fontaine. Oui. C’est pas de gaîté de cœur, mais il faut bien.
- Tu peux lui donner ça ? C’est pour lui, c’est arrivé tantôt, fit-il en me tendant une lettre.
- Tu peux pas lui donner toi-même ? Il te trouvera bien en revenant !
- Je serai parti, répondit-il. J’ai une permission, je retourne voir mes vieux à Vierzon par le convoi de ce soir. Il faut bien que quelqu’un lui passe son courrier. Alors, tu la prends ? » dit-il en me mettant la lettre sous le nez.
J’empochai la lettre et Fontaine se remit en marche sans un mot de remerciement. Il ne s’embarrassait jamais de politesses, surtout lorsqu’il était pressé. J’avais essayé, comme je le fais d’habitude avec ce genre de malotru, de le convertir au « bonjour » quotidien et je mettais un malin plaisir à ne jamais manquer de le saluer chaque fois que je le croisais, mais en vain. Ce type était né sans aucun sens des convenances sociales, bougon toujours et grincheux à vie ; un ours. Je l’aimais bien, pourtant, c’était le joueur de cartes idéal : il misait gros et perdait souvent.
J’arrivai rapidement au bout de la tranchée qui menait vers l’avant-poste. Il devait être au moins dix heures du soir, et ce sacré Garrigou devait sans doute attendre avec impatience sa relève. C’était un bon gars, un provençal qui avait gardé de son Midi natal un accent chantant qui m’amusait beaucoup et semblait apporter un peu de soleil aux tristes plaines des Flandres. Son vrai nom était Alphonse Garrigues, mais tout le monde – excepté le lieutenant – l’appelait Garrigou, à la fois en raison de ses origines méridionales et de son physique grand et sec de coureur cycliste, qui rappelait celui de son célèbre homonyme vainqueur du Tour de France avant la guerre. C’était un bavard incorrigible, un moulin à paroles doublé d’un conteur de talent qui se vantait de connaître mille légendes et anecdotes de sa Provence natale et qui ne manquait jamais une occasion d’en raconter une, sans se départir jamais de son accent à couper au couteau ni de sa pipe de bruyère qui l’accompagnaient partout. J’espérais bien ce soir-là qu’il aurait quelque histoire à me conter pour égayer mon réveillon avant de me laisser seul dans mon avant-poste pour le reste de la nuit.
Il y avait un passage difficile à franchir avant de parvenir à l’avant-poste. La tranchée s’arrêtait à une centaine de mètres de l’endroit, et il fallait pour y parvenir passer de trou d’obus en trou d’obus jusqu’à atteindre finalement le petit cimetière où se trouvait l’abri d’observation. De nuit on ne risquait pas généralement pas grand-chose, mais de jour c’était une toute autre histoire. Plusieurs pauvres bougres s’étaient faits surprendre par la mitrailleuse allemande installée juste en face en allant rejoindre leur poste, et leurs cadavres étaient restés là, trop exposés pour que l’un de nous se risque à aller les chercher. Pour mon malheur, cette nuit-là, la lune brillait de toutes ses forces dans un ciel sans nuages, illuminant toute la plaine enneigée du front.
J’attendis quelques minutes dans la tranchée, essayant de distinguer ce qui se passait dans le nid de mitrailleuse que j’apercevais là-bas, à l’autre bout du no man’s land. Il me semblait voir reluire le canon de cette fichue machine, pointée droit dans ma direction. Il y avait sans doute un soldat à cette machine, affalé sur son siège, l’œil rivé au viseur, et dont l’unique distraction pour la soirée consistait à essayer de me transformer en passoire au moment où je me déciderais à passer le bout de mon nez hors de la tranchée. Cette perspective ne m’enchantait guère, mais je ne pouvais rester là indéfiniment. En rampant dans la neige, je me glissai hors de mon trou, essayant de me faire aussi plat que possible et priant pour que l’ami Fritz soit en train de roupiller sur sa mitrailleuse. Je ne savais évidemment pas encore à cette époque-là que les allemands ne dorment jamais, sauf quand on leur en donne l’ordre. J’avais à peine parcouru vingt mètres en rampant dans la neige et j’étais déjà mouillé jusqu’aux sous-vêtements qu’en face, mon allemand eut l’idée saugrenue de lancer une fusée éclairante, à tout hasard, comme si la lune ne lui suffisait pas, comme pour être certain que je valais bien la peine d’être mitraillé. J’étais tombé sur un mitrailleur consciencieux. C’était bien ma chance.
J’eus tout juste le temps de rentrer mes oreilles et de m’aplatir encore un peu plus que le concerto commença. Les balles sifflèrent aussitôt dans ma direction, faisant voler la neige et les mottes de terre gelée tout autour de moi pendant un instant qui me sembla durer des siècles. Je sentais mes tempes battre sous les pulsations de mon cœur et mon estomac se serrer à l’idée que des centaines de balles me déferlaient dessus en ce moment même, et qu’une seule d’entre elles était suffisante pour m’ôter la vie ! Et cette maudite fusée qui refusait de s’éteindre…
Puis, d’un coup, tout s’arrêta. J’entendis des voix à l’autre bout de la plaine. Fritz avait l’air de s’engueuler avec quelqu’un. La fusée s’éteignit enfin, et je filai sans demander mon reste, non plus à plat ventre mais plutôt ventre à terre, en direction de l’avant-poste.
J’y plongeai plus que je n’y entrai, salué dans les derniers mètres par une nouvelle fusée accompagnée aussitôt de quelques rafales qui vinrent s’échouer contre la rangée de croix du cimetière. J’attendis encore quelques secondes le nez dans la boue de l’abri avant de me risquer à relever la tête, puis la mitrailleuse se tut et j’ouvris les yeux. Il faisait assez sombre dans l’avant-poste, mais je pus aussitôt distinguer la silhouette familière de Garrigou assis au poste d’observation, les jumelles à la main. Il rigola.
- « Tiens ! Alors c’est pour toi toute cette mitraille ? Je me demandais ce qui leur prenait, tout d’un coup…
- Désolé pour le retard…
- Pas grave, j’ai encore le temps avant la messe de minuit. Il faut te dire aussi que je n’en ai encore jamais raté une depuis ma naissance ; ça me ferait drôle de laisser tomber le bon Dieu pour son anniversaire l’année où j’ai le plus besoin de lui ! Allez, va, je te laisse, et ne va pas t’endormir à ton poste ! Joyeux Noël Louis !
- Joyeux Noël, Garrigou. »
Et mon provençal fila sans demander son reste, sans m’offrir ni conte ni légende, non sans avoir jeté un petit coup d’œil à l’extérieur avant de se risquer hors de l’avant-poste. Je me blottis dans la couverture qui était posée dans un coin et me perchai au poste d’observation, les jumelles au cou.
Garrigou n’était pas parti depuis une minute que le ciel s’illumina de nouveau et que la mitrailleuse se fit entendre. Depuis le poste d’observation, je tentai de scruter la ligne ennemie à l’aide des jumelles et je vis que mon mitrailleur allemand avait repris un canardage en règle de la plaine. L’affaire aurait pu s’arrêter là après quelques rafales, mais, probablement irrités par toute cette agitation un soir de Noël, les artilleurs de notre camp décidèrent de s’en mêler. Les canons, qui étaient restés muets pendant toute la soirée, se mirent à pilonner les tranchées allemandes qui répliquèrent aussitôt et bientôt, ce fut à celui qui envoyait le plus d’obus possible derrière les lignes de l’autre. Je n’étais pas à ce moment-là dans le meilleur des refuges possibles, certes, mais je ne pouvais m’empêcher de penser à l’ami Garrigou qui lui, était dehors et autrement plus exposé que moi.
Soudain, j’entendis au milieu du vacarme des bombardements un bruit que je ne connaissais que trop bien : le sifflement aigu de l’obus qui retombe, et qui va atterrir non loin de vous, sans qu’il soit possible exactement d’en déterminer l’endroit… Un bruit atroce, qui va en s’amplifiant et qui vous vrille les nerfs jusqu’au moment – presque un soulagement ! – ou l’obus tombe et explose enfin. Je me fis tout petit, me bouchai les oreilles et me serrai contre la paroi de l’abri, rentrant la tête autant que je pouvais. J’attendis, longtemps, tandis que le sifflement se faisait de plus en plus fort. Et enfin, tout explosa.
L’obus était tombé tout près. Le souffle avait fait vaciller les murs de l’abri et projeté de la terre mêlée de neige à travers l’entrée. Mes oreilles bourdonnaient et mes yeux rougis ne distinguaient plus les contours de l’abri ; sous le choc j’avais lâché mon fusil. Je me mis aussitôt à sa recherche à tâtons, à quatre pattes sur le sol boueux, pris d’une terreur subite et irraisonnée. Dehors, d’autres obus martelaient le sol non loin de mon abri, et cette pluie de métal et de mort pouvait s’abattre sur moi d’une seconde à l’autre. J’errai au sol empli de peur, tremblant de tous mes membres, jusqu’à ce que mes mains rencontrent la crosse de mon fusil enfoui sous une couche de terre et de neige et que je m’agrippe à cette arme dérisoire, cet ultime garant de ma sécurité qui ne pouvait pourtant me protéger de la formidable puissance qui s’abattait autour de moi.
Le bruit de tonnerre s’éloigna enfin, aussi subitement qu’il était arrivé. En grelottant de peur et de froid, je me redressai, tendant l’oreille, prêt à entendre ces coups de sifflet qui annonçaient le début des offensives d’infanterie qui suivaient souvent les canonnades, mais rien ne vint. Au lieu de cela, une voix me fit sursauter, une voix qui murmurait mon nom dans l’obscurité et que je ne reconnus pas de prime abord :
- « Dornon ! Tu es là ?
- Qui va là ?
- C’est Garrigou, pardi ! Les salauds ! »
Etrange, comme les accents disparaissent lorsque l’on chuchote. Peu a peu, je vis effectivement le corps efflanqué de mon camarade se glisser maladroitement dans le trou de l’entrée.
- Les salauds ! Ils auraient pu attendre un peu ! Ces fumiers-là ont bien failli m’avoir.
- Ca va ?
- Je crois que je me suis pris un shrapnel, j’ai eu un choc dans le dos, j’ai mal.
- Montre voir. »
Je l’entendis enlever sa chemise en gémissant, tandis que je rallumais ma lampe éteinte par le souffle des explosions. Lorsque j’y parvins enfin, j’eus un sursaut en découvrant le visage maculé de terre de Garrigou qui me toisait, torse nu, une grimace de douleur sur le visage. Il s’était assis sur une caisse et sa peau fumait sous l’effet de la transpiration ; dans la lueur vacillante de ma lampe-tempête, il ressemblait à quelque farfadet maléfique tout droit sorti de l’une de ses légendes occitanes.
Sa blessure n’était pas belle à voir. Un morceau d’obus lui avait effectivement déchiré le dos sur une grande longueur, et le sang coulait abondamment de la plaie. Je lui fis aussitôt un bandage de fortune avec les lambeaux des manches de sa propre chemise, avant de l’aider à la lui remettre sur le dos tant bien que mal. Il se leva, fit quelques pas en trébuchant et finit par s’affaler sur une caisse dans le fond de l’abri en gémissant.
- « Impossible de sortir comme ça, fit-il après avoir repris son souffle. Il va falloir que j’attende, avec cette satanée lune je n’ai aucune chance de passer sans qu’ils me voient. Espérons qu’il y ait un nuage avant la messe de minuit.
- Tu n’en mourras pas de la manquer, ta messe, Garrigou ! lui dis-je sur le ton de la plaisanterie. A ma grande surprise, il répondit le plus sérieusement du monde :
- Et qu’en sais-tu, mécréant ? Je n’en ai pas manqué une seule depuis ma naissance, je te l’ai dit ! C’est mauvais signe. D’ailleurs, c’est bien connu, il n’est pas bon de ne pas assister à la messe de la Nativité. »
Puis il se tut. J’attendis en silence, une fable, une anecdote ou quelque légende provençale comme il avait l’habitude d’en raconter lorsqu’il faisait pareille annonce solennelle – c’était en effet souvent le point de départ d’un de ses longs monologues – mais rien ne vint. Il s’était assis près d’un des soupirails par lesquels nous observions ce qui se passait dehors, et je le voyais regarder fixement quelque chose à l’extérieur. Son visage était livide et perlait de sueur.
De longues minutes s’écoulèrent ainsi en silence. Je nettoyais mon fusil à la lumière de la lampe, tandis que mon compagnon faisait le guet, arc-bouté au mur, immobile. Seul le bruit de sa respiration, presque imperceptible, troublait l’étrange recueillement dans lequel il semblait s’être plongé. Le froid s’était fait plus intense, et je regrettai amèrement la chaleur du poêle que je venais de quitter avant d’échouer ici. Enfin, subitement, Garrigou prit la parole :
- « Les vieux…
- Quoi ?
- Les vieux racontaient, quand j’étais gamin, toutes sortes de choses à propos de la nuit de Noël. Chez moi, dans mon village, personne n’aurait jamais manqué la messe ni même osé jeter un coup d’œil hors de l’église. Il ne fallait pas voyager la nuit de la Nativité.
- Pourquoi donc ?
- Oh, de vieilles superstitions, de vieilles histoires… Je m’en rappelle une que mon grand-père me contait chaque année… Pécaïre ! A vous faire froid dans le dos. »
Il s’interrompit pour bourrer sa pipe, et craqua une allumette. Je vis à la lueur de la flamme qu’il avait un petit sourire en coin, le sourire malicieux qu’il arborait à chaque fois qu’il nous tenait par la curiosité. Ses gestes étaient tremblants, toutefois, et une goutte de sueur perlait encore à son front ; je devinais qu’il luttait contre la douleur. Lorsqu’il eut fini d’allumer son brûle-gueule, il reprit :
- « On raconte qu’un jour, la veille de Noël, la diligence d’Arles s’arrêta pour le déjeuner dans une petite auberge. En descendirent, en plus du conducteur, cinq passagers qui avaient pris la route pour diverses raisons. D’abord, un notable de Nîmes accompagné de sa femme, qui voyageaient en tenue du dimanche pour impressionner les gens de la campagne et avaient passé tout le voyage à se disputer ; puis un vieux meunier aux joues rouges coiffé d’un bonnet de lin qui, se sentant d’humeur badine, s’était assis à côté du cocher pour lui narrer par le menu – le pauvre ! toutes les frasques de sa jeunesse en tortillant sa barbiche. Il y avait aussi un berger des Alpilles enroulé dans un grand manteau de laine vierge, qui ne parlait pas beaucoup et regardait ses pieds avec humilité, s’excusant presque d’être là. Et enfin, venu de Paris, une sorte de jeune artiste au chapeau extravaguant qui observait tout le monde en souriant d’un air béat, et lâchait de temps à autre un petit cri d’enthousiasme lorsqu’il apercevait un mas pittoresque – ces parisiens s’émerveillent d’un rien lorsqu’ils quittent leur capitale ! Tout ce beau monde descendit donc de la calèche, et fut accueilli chaleureusement sur le seuil par le patron – hum ! hum ! du moins le croyaient-ils ! Car il faut te dire, mon cher ami, que sous les traits affables du bon aubergiste se cachait en fait le diable en personne, qui pour jouer un de ses mauvais tours avait fait pousser au bord de la route ce charmant petit relais, tout prêt à accueillir d’innocents voyageurs pour les rouler dans le péché tout comme un cochon se roule dans sa fange ! Et il y parvint bien, le bougre de cornu : à grands renfort de vin du midi et de mets fumants ! A peine ses clients avaient-ils franchi la porte de l’auberge que les voilà déjà installés à table, bien au chaud, une grande serviette nouée autour du cou. Et les plats d’arriver sans délai, apportés à un rythme infernal par un petit diablotin aux oreilles de verrat déguisé en marmiton ! Dans sa cuisine, le Malin s’affairait aux fourneaux, et dans la grande salle de l’auberge, c’était un défilé de faisans farcis, tourtes aux morilles, rôti aux olives et carpes en sauce, le tout arrosé d’une clairette de Die qui délia les langues et fit chanter toute la tablée. Les malheureux s’empiffrèrent tant et plus, et lorsque la dernière bouchée fut engloutie et le dernier verre vidé, ils sombrèrent tous dans une sieste bienheureuse et profonde. Pécaïre ! Ils dormirent toute l’après-midi, et lorsqu’ils se réveillèrent de concert, la nuit était déjà tombée et l’auberge et son diable d’aubergiste avaient disparu, pfft ! avec la vaisselle. Je te prie de croire qu’ils regagnèrent bien vite leur diligence en se signant et en pleurant d’effroi ! Le cocher, pris de panique, fit claquer son fouet et emmena tout son équipage à un train d’enfer pour tenter d’arriver à temps à l’église, à une église, n’importe laquelle ! avant minuit. Mais l’heure était bien avancée, et la route était tellement sombre qu’on y distinguait rien à deux pas de distance. Les chevaux refusaient d’avancer ; la route enneigée embourbait les roues de la calèche et la lune se voilait la face derrière des nuages. Lorsque enfin nos compères atteignirent un village, il était trop tard et à l’intérieur de l’église on finissait la première des trois messes. Minuit sonna au clocher avant qu’ils n’eurent le temps d’atteindre le parvis, et alors nos six pécheurs virent avec effroi ce que l’œil de l’homme ne devrait jamais contempler. Dans les rues du village, les fantômes des morts des siècles passés se rassemblèrent en une macabre procession, battant leur coulpe et suppliant le Bon Dieu de leur voix d’outre-tombe de les prendre avec eux ; et sur leurs faces décharnées roulaient des larmes invisibles qui coulaient de leurs orbites vides. De tous côtés il en venait par bataillons entiers, et bientôt ils encerclèrent la diligence et ses occupants, battant les portes de leurs mains à la chair putréfiée et collant leurs faces livides contre le carreau de la fenêtre. Leur ventre vomissait des vers gros comme le doigt et leurs lèvres enflées suintaient un pus jaunâtre à l’odeur pestilentielle. Les chevaux succombèrent bientôt sous leurs assauts, et ce fut alors le tour des passagers. Les morts investirent la calèche, se jetèrent sur eux et déchirèrent leurs chairs de leurs dents pourries et de leurs ongles cassés. Lorsque le dernier coup de minuit sonna au clocher du village, c’en était fait de nos voyageurs et quand les bons paroissiens sortirent sur le parvis de l’église, après l’Ite Missa Est, ils découvrirent avec étonnement une diligence vide aux vitres brisées et aux coussins déchirés qui gisait renversée en travers de la grand’place. Point de traces de passagers, de cocher ou de chevaux : les morts les avaient emportés avec eux. Et depuis ce temps, chaque Noël à minuit, les six de la diligence d’Arles errent avec les brigands et les assassins du temps jadis dans les rues du petit village, pleurant sur leur péché de gourmandise qui les avait mis en retard pour la messe de Minuit… »
Il se tut, et nous nous regardâmes en silence pendant quelques secondes avant que je ne lâche un petit rire nerveux. Garrigou eut un petit sourire, puis il retourna à son observation sans ajouter un mot. Je me blottis dans ma couverture, l’esprit encore plein des descriptions d’épouvante que venait de me faire mon camarade, et je crois bien que malgré cela, je finis par m’endormir sans m’en rendre compte, terrassé par la fatigue.
Je fis cette nuit-là un drôle de songe, tout droit sorti de l’histoire que je venais d’entendre. Dans ce rêve, je sortais de l’abri dans lequel je me trouvais ; il faisait à l’extérieur une grande lumière surnaturelle et l’on y voyait comme en plein jour. Plus de canons, plus de mitrailleuses : je me tenais debout sur le champ de bataille désert, stupéfait de ne pas être pris pour cible. Puis une cloche sonna au clocher de l’église toute proche, et je vis avec effroi sortir de la chapelle une longue procession de morts relevés de la boue, dégoulinant de sang, leurs boyaux fourmillant de vers. Je voulus fuir, mais la terreur me bloquait sur place ; mes yeux écarquillés me forçaient à voir et mes membres ballants ne m’obéissaient plus. Bientôt le macabre cortège passa devant moi, assez près pour qu’une odeur de décomposition m’assaille les narines, et je vis défiler un à un tous ces macchabées qui me fixaient au passage de leurs yeux fous, exhibant devant moi leurs blessures effrayantes. A ma grande horreur, je reconnus certains d’entre eux : je vis Martin Loiseau, que l’on surnommait « le petit », que je savais mort d’une balle entre les deux yeux la semaine dernière et qui me toisait maintenant férocement, un trou béant au milieu de la face ; je vis le grand Kermadec, qui marchait sur une jambe rongée par la gangrène, lui dont le corps avait été rapatrié vers sa Bretagne natale ; je vis aussi Yves Rajon, le ventre ouvert d’un coup de baïonnette ; et puis Richard et Léon Langlois, qui étaient morts le même jour, l’un fauché par une rafale de mitrailleuse et l’autre dans un lit d’hôpital en crachant ses poumons sous l’effet du gaz moutarde. Et puis je vis Fontaine, le gros Fontaine à qui il manquait toute une partie du crâne et que j’avais quitté en pleine santé quelques heures à peine auparavant.
Fou d’horreur, je tentai de hurler, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Et c’est alors que je le vis, Garrigou, le même Garrigou qui venait de partager l’abri froid avec moi en cette veille de Noël. Il venait en queue de cortège, parmi les derniers morts, vidé de son sang par son atroce blessure au dos. Tout comme les autres, il me toisa au passage, la pipe aux lèvres, le regard désolé. Puis il s’arrêta et me dit avec son accent du midi :
« Ne t’en fais pas Dornon, je te l’avais bien dit : c’est comme cela que ça devait finir… »
Puis il ajouta, avec son sourire étrange, en me montrant sa pipe :
« J’y suis trop attaché, je l’emporte avec moi. Tu peux garder le tabac, je n’en ai guère besoin. Allez, à bientôt, Louis. »
Et il repartit en boitillant, se hâtant pour rejoindre les autres avant le dernier des douze coups de cloche.
Je me réveillai en sueur, au petit matin, tout couvert de la boue dans laquelle j’avais dormi. Au fond de l’abri j’aperçus Garrigou, toujours sur sa caisse. Il ne bougeait plus, et je n’entendais plus le bruit léger de sa respiration. Une grande tache sombre teintait le dos de son pardessus. Je m’approchai et lui mis doucement la main sur l’épaule, mais son corps sans vie s’écroula sur le sol. Je n’eus pas le cœur de l’abandonner là le jour de Noël, aussi je pris la décision de le ramener avec moi dans la tranchée, à bout de bras, quoi qu’il m’en coûte.
C’est en tentant de le soulever pour l’emmener que je me rendis compte qu’il n’avait plus sa pipe. Je me mis à la chercher, dans ses poches, sur la caisse, sur le sol, dans la boue, en vain. Elle n’était plus dans l’abri.