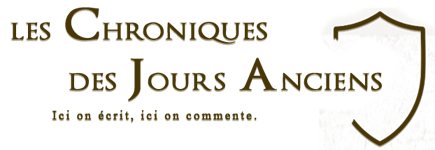[Les nouvelles qui composent les Fragments d'Apocalypse peuvent se lire indépendamment ou les unes après les autres, dans l'ordre de votre choix. Elles ont en commun leur univers, celui de l'Apocalypse.]
Je suis mort et je me souviens. Je me souviens du coup de feu qui allonge mon pas. Je me souviens de ma course dans l'herbe à peine humide. Je me souviens de l'espoir à la vue d'une ville, dans la vallée. Je me souviens du grognement du 4x4 lancé à ma poursuite. Je me souviens de l'inquiétude croissante de mon esprit, à toute allure. Parce qu'ils savaient que j'avais appris d'eux le secret qu'aucun ne doit savoir, et que je pouvais reconstituer, séquence après séquence, la tragédie de tous, lourde de conséquence. Celle de l'Apocalypse.
Leur laboratoire secret était perché tout en haut de la plus haute montagne de la région, sur un plateau que les habitants du coin nommaient « la plateau désossé ». Je n'ai jamais vraiment pu savoir pourquoi cet épithète avait été adossé au plateau ; les communautés quelque peu attardées de cultivateurs qui demeuraient là avaient été bien incapables de me le révéler. Il leur suffisait de savoir que personne n'y mettait jamais les pieds et que des vents y soufflaient nuit et jour, rendant toute villégiature à plus ou moins long terme absolument insupportable. Soit, leur avais-je dit, essayant de rassembler les quelques morceaux de patience qui me restaient encore après l'ascension (oui, car j'avais du supporter pendant trois heures d'escalade la logorhée désespérante du guide que l'on m'avait assigné : un brave type un peu pataud, qui était né ici et qui passait sa vie à faire l'aller-retour entre la cité et les communautés montagnardes). Les habitants, donc, m'affirmaient que rien ni personne ne demeurait là-haut. A part peut-être quelques coqs de bruyère. Ce qui n'avait pas de sens. Un jour auparavant, mon supérieur hiérarchique – ou plutôt son adjoint, évidemment – m'avait affirmé que l'objectif se trouvait très précisément sur le « plateau désossé » et que je devais m'y rendre au plus vite, aidé par Oscar, le guide. Il s'appelait Oscar. Cet élément précis me revient à présent au mémoire, ainsi que son visage plein de grimaces et de tics qui rendait toute conversation en vis à vis strictement impossible. Oscar. Un brave type. Un peu pataud. Qu'est-ce qu'il me disait déjà ? Il me parlait de sa mère qui était morte la semaine dernière, ou le mois dernier, ou quelques jours avant, et qu'on avait incinéré dans la décharge de la cité alors que la coutume était, pour les communautés, d'enterrer ses morts dans un sanctuaire bâti dans la montagne, entre les neiges. Alors il avait protesté, mais sans succès. Il me demandait si moi, depuis ma position, je ne pouvais pas l'aider à faire enterrer sa mère. J'ai dû lui expliquer que, si elle était déjà réduite à l'état de cendres stériles, on ne pouvait pas l'enterrer. L'inverse était possible : on pouvait récupérer un corps enterré et le brûler. Mais il était impossible de reconstituer un corps avec des cendres. Il ne voulait pas en démordre. Il me demandait d'agir auprès des autorités pour faire en sorte que le corps de sa mère soit ramenée dans les communautés et qu'ils l'enterrent selon leur coutume. Il ne voulait pas en démordre. Il m'affirmait que si, évidemment que c'était possible, qu'il suffisait qu'on n'incinère pas sa mère et tout irait bien. Mais sa mère était déjà incinérée. Ce n'est pas grave, me disait-il. Il ne voulait pas en démordre.
L'eau de la rivière se glisse le long de mon talon, coule entre mes jambes, m'inonde la poitrine. Seuls mes deux yeux émergent et sont encore capables de m'envoyer quelques informations. Dans le ciel persiste l'image d'un nuage gris dont je peux lire la forme. C'est un message qui m'est envoyé depuis le lointain, ou plutôt depuis le longtemps. Ses contours se dessinent sur un ciel rouge que l'on dirait mourir. Un peu comme moi. A moins que ce ne soit le sang qui... Comme moi, alors. Ce nuage m'obsède à tel point que je sais que sans lui, je ne peux pas poursuivre le cheminement de ma mémoire.
Pendant trois jours j'ai marché entre les sapins et les buissons de houx. Le chemin était long, très long, et Oscar ne cessait de me dire que l'on était bientôt arrivé. Il me disait ça dans son patois local, et je ne comprenais absolument rien. Mais je suppose qu'il voulait me rassurer. Soudain, au cours du cinquième jour, quand mes chevilles succombaient aux attaques d'orties pernicieuses, j'ai cru distinguer derrière un glacier la coupole. Oscar n'a rien vu et continuait de marcher. J'ai dû l'arrêter et lui expliquer que l'objectif avait été atteint et qu'il pouvait bien, à présent, rentrer tranquillement chez lui, enterrer sa mère calcinée et me laisser agir. Il n'a rien voulu savoir. Il me disait qu'on l'avait payé pour rester avec moi et que la contrepartie morale du pécule qu'il avait reçu était son respect indéfectible des ordres qui lui avaient été donnés. Son argent avait pour moi comme conséquence une série d'ennuis bien facheux que j'aurais évité si Oscar avait eu la bonne idée de désobéir. Mais sans doute la désobéissance est une qualité étrangère aux rustres qui passent toute leur vie sur ce plateau détestable. Alors il m'a suivi.
Si je parle d'Oscar, c'est que le pauvre homme est mort par ma faute. Pas exactement par ma faute si on admet qu'il ait été une créature douée de libre-arbitre et qu'il eût pu suivre mon conseil lorsque le dôme nous apparût. Je me souviens de la mort d'Oscar. Elle se forme une nouvelle fois devant mes yeux. Il arrive près de la porte. Il y a un garde. Il arrive près de la porte et dit à Oscar de s'arrêter et de décliner son identité. Oscar arrive près de la porte et parle au garde. Je ne sais plus ce qu'il lui dit. Oscar parle au garde. Il lui dit qu'il s'appelle Oscar. Il lui demande ce qu'il vient faire là, car la zone est interdite au personnel non-autorisé. Oscar répond, et là encore, je n'arrive plus à me souvenir. Le garde le met en joue et tire. Peut-être y a-t-il eu entre le moment de la seconde question (« Que venez-vous faire là ? ») et le moment du tir un dialogue entre les deux hommes que je n'ai pas pu percevoir puisque j'étais caché sous un monticule de neige, ou derrière un sapin, ou en contrebas de la réserve de bois. Ils se sont dits des choses. Oscar a dû lui parler de sa mère qu'on avait brûlé, il n'avait que ça à la bouche de tout le voyage. Il me parlait de sa mère comme si c'était le plus précieux trésor qu'il n'avait jamais eu, et la nuit, j'avais des images de cette mère horrible qui était comme un Oscar affublé d'une perruque grise et bouclée. Il n'arrivait pas à comprendre qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Il me disait si, si ! Il me disait qu'il n'y avait qu'à l'enterrer, qu'après la mission, il allait rentrer dans sa communauté et l'enterrer. Le pauvre bougre est mort avant, étendu dans l'herbe à peine gêlée devant la porte du laboratoire secret. Le garde est allé traîner son corps dans un tas de compost, à côté. J'en ai profité pour me glisser dans le bâtiment. C'était exactement comme ça que les choses étaient censées se dérouler.
Maintenant que l'eau a cessé de submerger mon corps, qu'elle s'est arrêtée juste au niveau de l'arête supérieur de ma joue, qu'elle soulage la douleur qui grimpe depuis l'impact laissé par la balle, je commence à comprendre le message du nuage. Il dessine un homme assis. Un vieil homme. Un vieil homme assis sur une chaise. Il a les mains crispées sur les accoudoirs. Une légère perspective, mais juste suffisante pour tromper la frontalité. Il a des tentacules qui lui sortent du crâne en longs serpents cotonneux. Ils sont reliés à un rectangle parfait.
Quand nous avons vu la coupole du laboratoire, Oscar m'a fait un signe. Il m'a montré du doigt l'édifice et m'a dit dans son patois : « Louque ! Louque ! », ce qui doit vouloir dire quelque chose comme « Regardez là-bas ! ». J'ai regardé et j'ai vu la coupole. Alors il m'a expliqué qu'il fallait emprunter un petit sentier qui bifurque et mène jusqu'à une sorte de structure en gradins. Il y avait là une réserve de bois et c'était l'endroit idéal pour espionner ce qui se passait et échafauder un plan. Je n'ai pas eu beaucoup de mal à l'échafauder, ce plan, une fois que nous eûmes atteint les rondins collés par le givre. Oscar se présenterait devant le garde, le distrairait d'une manière ou d'une autre, selon l'inspiration du moment, et j'en profiterais pour me glisser dans le bâtiment.
Dans le bâtiment, je me retrouvais face à deux portes. L'une était capitonnée et rouge. L'autre était en bois vert. Il me fallait choisir. Derrière la verte se trouvait un couloir qui distribuait quatre autres pièces de part et d'autre de son axe principal. Le toit du couloir était fait de dalles de polymères constellées de points noirs ; au fond à droite, une caméra. Derrière la rouge se trouvait un vaste hall en mezzanine dont les parois étaient de verre ; et derrière les parois s'agitaient des tas d'hommes et de femmes vêtus de blouses impeccablement blanches. Le grand escalier à vis placé au centre du hall et qui donnait donc sur la mezzanine laissait supposer que le laboratoire comprenait un voire plusieurs étages. Au-delà de la mezzanine, une porte. Il me fallut tromper la vigilance de la caméra en frôlant le mur et en guettant ses mouvements. Mon regard accoutumé à ce type de surveillance connaissait précisément l'angle de vue de l'appareil et, en quelques secondes, je fus arrivé à la première porte que j'ouvrais. Il ne fut pas très difficile de me faufiler dans le grand hall et d'arriver jusqu'à l'escalier à vis : les scientifiques (car il s'agissait sûrement de scientifiques) ne faisaient absolument pas attention à moi, trop occupés par leur tâche respective. Une fois sur la mezzanine, j'ouvrais la porte. Derrière la porte m'attendait une femme que j'identifiais tout de suite comme l'un des scientifiques à cause, justement, de sa blouse blanche et de ses mains gantées de latex. Elle me regarda, non sans un certain effroi zigzaguant d'un oeil à l'autre. Elle me regarda. Elle me dit quelque chose, à ce moment là.
Quand ils se mirent à me poursuivre, plus tard, je peinais dans la neige d'été qui me rentrait dans les chevilles et me ralentissait. Je les attendais qui montaient dans leur véhicule. Ils criaient : « Rattrapez-la ! Rattrapez-la ! » et je trouvais ça idiot car, après tout, j'étais un homme. Je me mis à courir de plus en plus vite, comme si mes pieds s'habituaient à la résistance de la neige. Il leur fallut un peu de temps avant de décider leur engin à me poursuivre et je profitais de cette avance. Le vent léger était frais contre mes oreilles peu friandes de températures extrêmes ; il me réchauffait presque. Les sommets les plus enneigés étaient très loin et perçaient le ciel résolument bleu, sans nuage, tranquille, comme j'entrais dans les premiers bois de sapins. Ils ne me poursuivaient pas. Je m'en étonnais à peine : autour de moi, la végétation me remplissait d'une confiance nouvelle, et je n'avais plus aucune peine à courir entre les arbres, à sauter par-dessus les branches mortes tombées à terre, à écarter d'un geste celles qui, contrairement à leurs consoeurs, étaient encore vivantes et me barraient le chemin. La neige ne recouvrait pas le sol dans ce bois de sapins. Je continuais à courir. Je courrais encore. Je poursuivais ma course.
Le nuage se dévoile. Oui, c'est bien un vieil homme assis sur une chaise et entouré par des tuyaux montant jusqu'à un écran... Mon sang cesse de couler, ou alors je ne le sens plus. Un vieil homme... Oui, je crois que je me souviens d'un vieil homme. Etait-ce celui dans la cabane ? Non, c'était une femme, bien qu'elle fût elle aussi assise, et que ses cheveux bouclés formait comme une crinière rayonnante qu'on aurait pu confondre avec les tuyaux de mon vieil homme. Non, le vieil homme est une autre histoire...
Quand la scientifique me vit, elle commença à paniquer. Elle était en train d'agiter ses doigts sur une console garnie de boutons de couleurs et parcourue d'écrans oscilloscopiques. Elle m'ordonna de fermer la porte. Je fermais la porte.
La vieille femme s'imprime sur ma rétine, maintenant. Elle est assise. Elle lève un doigt. Mon corps recommence à sombrer dans l'eau de la rivière. La vieille femme me tend une main tremblante à laquelle il manque un doigt. Je tends mon bras à nouveau. Mais je ne peux pas bouger mon bras. Elle essaye pourtant de m'atteindre. Mais l'eau ralentit mes mouvements et mon bras droit pèse une tonne. Le gauche aussi. La vieille femme marmonne quelque chose, dans un patois incompréhensible. D'où vient-elle ? Pourquoi se superpose-t-elle ainsi au nuage gris ? Il me semble que cela aussi me revient en mémoire. Dans la forêt de sapins, il y avait une petite cabane. Elle était à peine cachée et une fumée s'échappait de la cheminée de brique. Je n'étais pas poursuivi, mais je ne voyais pas d'autres solutions que de m'y cacher. Soit il n'y avait personne, et j'y resterais dans ce cas le temps qui serait nécessaire ; soit il s'y trouvait quelqu'un, et il m'allait falloir improviser. Par malchance, ou par chance, deux personnes attendaient, assises dos à l'âtre. Là me revient la vieille femme au doigt levé. A côté d'elle, Oscar me sourit et m'explique que sa mère a quelque chose à me dire. Je lui demande pourquoi sa mère n'est pas morte. Il me dit qu'elle sera enterrée demain et que tout est prêt. Mais avant, elle a quelque chose à me dire. Je m'assois à même le sol en terre battue. La vieille femme lève un doigt ; ses contours se détachent sur fond de flammes et de fumée. Elle me parle. Elle m'explique que, pour l'instant, ils sont à la poursuite de la femme. Elle m'explique qu'ils vont ensuite venir fouiller dans cette cabane, car c'est le seul endroit pour se cacher. Elle m'explique qu'ils vont me trouver et que je devrai fuir et qu'ils m'attendront à la sortie du bois, là où la vallée devient plus verte et où la neige fond en été. Elle m'explique qu'ils me tueront quelque part en contrebas. Je lui demande comment elle sait tout cela. Elle me dit qu'elle s'en souvient.
Dans le ciel passe une volée d'étourneaux qui brise le nuage gris. Elle me dit qu'elle s'en souvient. De quoi se souvient-elle ? Et moi, de quoi je me souviens, alors que l'eau s'en prend à ma respiration et m'étourdit plus encore que la douleur de la balle ?
Je me souviens que quand la scientifique me vit, elle conserva la maîtrise de ses gestes précis sur le tableau de commande. Elle m'affirma que je devais être celui qui était envoyé par la cité pour trouver le laboratoire. Puis, elle m'informa qu'elle était elle aussi un agent de la cité, envoyée là à une époque éloignée pour recueillir les informations en interne et les transmettre plus tard à sa hiérarchie par l'intermédiaire d'un homme, ou d'une femme, qui arriverait un jour. Je devais être cet homme. C'était le cas. Ma mission était de retrouver l'agent qui travaillait pour nous, de prendre en note les informations qu'il avait rassemblées et de les ramener à la cité. On ne m'avait rien dit sur l'agent en question au cas où la sécurité du laboratoire secret m'arrêtait avant que je ne le trouve et me torture pour obtenir l'identité de la taupe inflitrée au sein de leurs services. La scientifique m'ordonna de fermer la porte, précisant, comme si ce fût nécessaire, qu'elle était ma supérieure par le grade, et m'indiqua qu'il lui restait quelques manipulations à faire. J'attendais. La salle était joliment décorée, quoique sombre. Le blanc des murs éclairait assez l'endroit pour qu'un simple néon suffise à l'oeil. Elle me dit alors, avec un sourire (Elle avait un très joli sourire qui, d'après moi, ne devait pas beaucoup sortir. J'évaluais rapidement les possibilités que j'avais de la séduire, comme sa blouse était un peu cintrée à la taille et qu'elle ne devait être guère plus âgée que moi. Plusieurs arguments s'opposèrent à mon désir : elle était ma supérieure, elle ne regardait absolument pas dans ma direction mais fixait constamment son écran, nous étions tous deux en mission dans un laboratoire secret dont la majorité des occupants nous en voudraient s'ils venaient à réaliser que nous nous connaissions.). Elle me dit de me préparer, car j'allais avoir sous les yeux ce que j'étais venu chercher. Elle appuya sur un bouton et les persiennes qui recouvraient l'un des murs de la pièce se lévèrent lentement.
Derrière les persiennes, une grande pièce. Dans cette pièce, un vieil homme assis sur une chaise. Il ne bougeait pas, et ses deux mains étaient nouées par des cordes aux accoudoirs. Des tuyaux jaunes et verts partaient du sommet de son crâne et l'auréolaient, tel un ange à la peau grise et au teint blanc. Au-dessus de lui, sur un écran, se formaient et se déformaient des formes de pourpre et de cyan. L'impassibilité de son visage laissait un affreux doute quant à sa condition : se pouvait-il que le mutisme de ses yeux, de sa bouche, de sa machoire, indiquât qu'il fût mort ? Mort. La question me traversa l'esprit. Mort. Elle dut atteindre ma bouche. Mort. Comme moi bientôt, dont l'eau de la rivière remplit les poumons.
La femme lut ma question et s'y attendait. Le vieil homme était la clé de la connaissance. Les scientifiques qui oeuvraient dans ce laboratoire se servaient de lui, et de dizaines d'autres vieux morts pour leurs expériences. Jusque là, je ne parvenais pas encore à comprendre le rapport qu'il pouvait y avoir entre des vieux morts et le secret de l'Apocalypse. Elle me l'expliqua pourtant, avec un calme atroce. Il y avait, je me souviens, deux éléments à mettre en rapport. Premier élément : ces vieux ont vécu l'Apocalypse. Ils étaient là, ils y ont assisté. Deuxième élément : la machine composée de tuyaux (de tuyaux) et d'un écran (d'un écran) est le fruit d'une technologie de pointe qui permet de matérialiser sur écran le contenu de la mémoire. Conclusion (la conclusion à laquelle étaient parvenus les scientifiques) : en interrogant la mémoire de ces vieux nés avant l'Apocalypse, il devenait possible de voir, comme à travers une caméra, les évènements de l'Apocalypse. Tout ça n'était qu'une question de réglages (de réglages).
Je me souviens des analogies qu'elle me proposa et de l'avis qu'elle me donna : « La méthode est la même que celle qui, dit-on, a permis de savoir ce qui s'était passé durant la Big Bang : avec un télescope suffisamment puissant pour remonter loin dans l'espace, et donc dans le temps, et apercevoir les premières lueurs de l'apparition de l'univers. Mais franchement, est-ce que tu crois, toi, que l'on peut faire à la confiance à la mémoire d'un mort pour remonter le temps ? Il ne nous réflète que des fragments de pourpre et de cyan qui se fondent les uns dans les autres et s'évanouissent. ».
Ils me rattrapèrent, comme l'avait prédit la vieille femme, au sortir du bois de sapins, juste après une petite butte de terre. Ils avaient sans doute, à cette heure, rattrapés la femme, et c'était elle qui, par sa fuite, avait permis la mienne.
Ils me rattrapèrent entre deux hêtres sans feuilles, agonisant de froid, à plusieurs dizaines de mètres du bois que je venais de traverser, là où l'herbe redevient, par endroit, un peu plus verte.
Je me souviens de cette grande descente faite de buissons d'épines, courant jusqu'à la rivière.
Je me souviens du grognement du 4X4 lancé à ma poursuite.
L'eau qui se mêle à mon sang et noie le ciel au fond mes yeux s'allume de tâches de pourpre et de tâches de cyan. Je me souviens que je me laisse couler jusqu'à l'embouchure, remontant mes souvenirs et le cours de la rivière comme on remonte le temps avec un télescope, et des tuyaux.