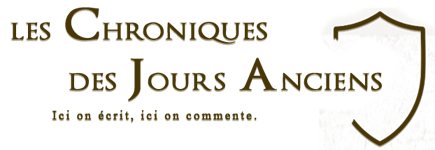1.
Aujourd'hui, j'arrive à Likoutsk. La ville est très grande. C'est une très grande ville, avec des maisons, avec des fenêtres, avec des rues, avec des lumières – beaucoup de lumières, et des grandes lumières très lumineuses. Je sais que le nom de la ville est Likoutsk, et j'en suis certain, parce que c'est le nom que le conducteur a crié avant de partir de l'usine et il criait très fort pour que je l'entende bien. J'étais dans le wagon juste devant la locomotive où se trouvait le conducteur qui criait le nom de la ville : Likoutsk ! Likoustk ! Au début, j'ai cru qu'il appelait quelqu'un. Et puis je me suis souvenu de ce qu'Alexandra m'avait dit le jour avant le départ du train. Elle avait prononcé le nom de Likoutsk, et ça ne pouvait pas être une coïncidence qu'elle et le conducteur (ils ne se connaissent pas, je pense), prononcent exactement le même mot. Likoutsk ! Likoutsk ! Parce que pour arriver à la ville depuis l'usine, il faut prendre un train qui est dans une grande lande grise, et l'instant d'après, il est à Likoutsk. On sent juste quelques frémissements dans tout le corps ; la vue qui se brouille ; les oreilles qui se bouchent ; la gorge qui se râcle. Et voilà. La ville. Je passe tout mon temps à noter dans ma tête les nouveautés. Il y en a beaucoup, des nouveautés. Je ne dirais pas qu'il y en a trop, parce que s'il y en avait trop, il me suffirait d'arrêter de bouger, de rester tout seul dans ma chambre au dixième étage du grand immeuble du quartier des grands immeubles, et de me reposer d'avoir découvert tant de nouveautés. Il n'y en a pas encore trop. Je peux encore sortir dans la rue, faire le tour du pâté de maison, enregistrer deux ou trois nouveautés, et revenir. C'est un petit exercice que j'ai imaginé quand je suis arrivé. Je fais le tour du pâté de maison, et voilà. J'ai aussi imaginé une méthode pour me souvenir – si je pouvais, j'utiliserais la méthode du papier et du crayon que tout le monde utilise à la ville mais je sais lire mais je ne sais pas encore écrire, la méthode du papier et du crayon ne peut s'utiliser que si on sait écrire, sinon, elle ne sert absolument à rien, même si on sait lire. J'ai ma méthode à moi. Pour chaque chose nouvelle, je garde en tête une image fixe. Par exemple pour le train. Au début, Alexandra me dit qu'on prend le train pour aller à la ville (Likoutsk). Mais je ne sais pas ce que c'est que le train. Alors j'attends de voir (ce qui est important, c'est de voir). Le train est une habitation qui fume et qui bouge. Frémissement ; brouillard ; bouchon ; râclement. Quand je vois le train, j'imagine la chaîne de la visseuse (la chaîne de la visseuse avant l'incendie, parce que maintenant la visseuse n'existe plus et c'est très difficile d'imaginer quelque chose qui n'existe plus) ; le train est l'obus qui avance le long de la chaîne ; l'usine, c'est la grande cracheuse d'obus d'où sortent les trains-obus ; la ville, c'est moi quand l'obus s'arrête pour être vissé. Le bruit est le même ; l'odeur est presque la même. Le train est tout ça avec de la fumée.
Bien sûr, le jour où j'ai pris le train, je n'avais pas encore cette méthode. Je l'ai trouvé après, dans la ville. Dans la ville, il faut une méthode pour se souvenir, sinon, les choses sont trop nombreuses ; et en plus, chaque chose est importante : il ne faut rien oublier. Il faut tout apprendre, mais sans contremaître pour dire comment le faire. J'aime beaucoup la ville parce que je sens mon esprit qui bout comme une turbine chaque fois qu'il faut utiliser la méthode à souvenir. Des fois, j'arrive même à retrouver les sensations du train sans monter dedans, juste en faisant fonctionner mon esprit auprès des nouveautés. Frémissement ; brouillard ; bouchon ; râclement. J'ai souvent besoin de la méthode à souvenir. Pour la taille des rues, plus larges que trois allées d'habitation. Pour la taille des habitations, aussi grandes que dix habitations empilées les unes sur les autres et que l'on appelle des immeubles. Pour la perspective d'habitations, qui est comme la perspective d'habitations de l'usine, mais multipliée par vingt, au moins, parce que je n'arrive même pas à penser qu'il y ait un horizon, et la perspective n'est plus seulement verticale mais aussi horizontale et monte jusqu'au ciel, immense et gris infini. Pour la brume qui descend jusqu'aux genoux le matin et cache tout, bien au-delà de simplement l'horizon (et je sais maintenant que la brume se forme depuis la rivière, depuis les voitures, depuis les usines). Pour les usines qui encerclent la ville, et qui sont toutes sans exception les répliques exactes de l'usine de monsieur Andropov qu'on aurait clonée dans une machine à cloner, le long d'une chaîne de fabrication, avec à chaque étape des visseurs pour visser les toitures et les conduites d'eau, des visseurs pour visser la grande chaudière, des visseurs pour visser les poutres qui rythment l'intérieur de l'usine, des visseurs pour visser le sol en terre battue, des visseurs pour visser les visseuses et les ouvriers qui vissent, à l'intérieur. Pour les voitures qui se trouvent dans les rues, qui avancent sans cesse et sans jamais se percuter, et crachent autant de fumée que les cheminées de l'usine. Pour la fumée, qui devient une grosse brume opaque qui tousse. Pour la rivière, qui coule au coeur de la ville, sous les ponts, qui est un grand torrent de boue jaunâtre, et qui remonte en brume quand elle se mélange avec la fumée des voitures, et des cheminées, et des usines. Pour les voitures qui volent. Pour les tuyaux de vapeur au croisement des rues qui soufflent le vent sur les passants et font voler les chapeaux. Pour les passants que l'on croise et qui n'ont pas de numéro mais des noms et sont donc beaucoup plus compliqués à reconnaître que des ouvriers avec des numéros, parce qu'il y a Edgar, parce qu'il y a Dimitriev, parce qu'il y a Ivan, pace qu'il y a un deuxième Ivan, mais qui a une barbe et pas de chapeau qui vole avec la vapeur des tuyaux. Pour Alexandra qui n'est plus juste Alexandra, dans sa chambre de la maison de monsieur Andropov, dans sa robe jaune en pantin d'ombres, mais qui est Alexandra de ville, dans sa chambre de l'appartement de Likoutsk, dans son grand manteau soyeux mais sombre. Pour les mots d'Alexandra qui ne demandent ni de visser, ni de s'arrêter de visser, ni de se glisser la nuit entre les habitations, entre les ombres, entre les grilles. Pour la joie d'Alexandra qui n'a plus peur de monsieur Andropov et qui parle. Pour les chansons d'Alexandra qui ont des paroles à base de fleurs, à base d'amour, à base de larmes, à base de vins, à base de sang. Pour le geste machinal de la main d'Alexandra quand elle sort de l'appartement pour aller en voiture dans les quartiers riches de la ville, là où d'autres Alexandras en manteau soyeux se rendent tous les soirs, au théâtre, à l'opéra, au salon à la mode, pour se montrer (parce que les Alexandras se montrent si elles existent). Pour la voix d'Alexandra quand elle revient le soir, rauque à cause des fumées (celle des voitures, celle des usines et celle de ses cigares), tremblante et généreuse à cause des alcools, presque gentille avec moi qui la porte à sa chambre comme elle me le demande ; les fumées et les alcools rendent les voix fragiles comme des morceaux de verre incrustés dans la peau qui saigne. Pour les pleurs d'Alexandra après les fumées et les alcools (qui tendent les sentiments comme on tend le niveau pour mesurer la stabilité d'un mur). Pour tout un tas de nuances de la voix d'Alexandra : avec les alcools, avec la fumée, avec la fumée mais pas les alcools, quand elle me parle à moi seul, quand elle me parle à moi et que quelqu'un d'autre est là, quand elle parle à quelqu'un d'autre qui est là, quand elle parle à ce monsieur qui a une grande cravate et dont je ne sais plus le nom, quand elle parle à Ilya quand il revient de l'usine qu'il administre maintenant en tant que représentant des intérêts de madame Alexandra Andropov et de son mari. Pour la chambre d'Alexandra qui est toujours fermée quand Ilya vient nous voir, mais qui s'ouvre quand il n'est pas là (et c'est comme ça que je sais si Ilya est là où s'il n'est pas là, mais je n'ose pas plus lui parler qu'avant, même s'il n'est plus habillé en contremaître et qu'il a un chapeau, une canne et un manteau de fourrure avec des boutons de manchette en or). Pour la maison d'Alexandra qui a dix pièces, que monsieur Andropov nous a laissée, dans lequel je me perds toujours s'il n'y a pas l'odeur des cuisines, ou la couleur des murs, pour m'aider à m'y retrouver (comme il y avait à l'usine l'odeur de fruits pourris dans le réfectoire, que je pensais trouver dans toutes les cuisines). Pour la pièce avec le piano qui joue parfois des sons qui vont bien ensemble mais qui sont un peu tristes, le soir. Pour la pièce avec une table où l'on mange. Pour la pièce avec une table où l'on boit. Pour la pièce avec des livres. Pour la pièce avec le lit d'Alexandra. Pour la pièce avec mon lit. Pour la pièce avec la cuisine, et la cuisinière. Pour la pièce avec le lit de la cuisinière. Pour la pièce avec la table de roulette. Pour la pièce aux grandes fenêtres froides en hiver (et c'est l'hiver dans la ville). Pour l'emboîtement des pièces les unes dans les autres (la pièce aux livres derrière la pièce à la table où l'on mange mais devant la pièce aux murs blancs où le piano joue un air lourd, parfois la nuit). Pour la nuit qui n'est plus aussi silencieuse et plus aussi noire à cause des reflets des lampes, partout : dans la rue, dans les fenêtres, sur les murs, sur les plafonds de la chambre (et comme la lumière ne s'éteint jamais, la pensée n'a pas de fin). Pour les lumières de la ville qui sont des étoiles prisonnières qui ne s'arrêtent jamais.
Pour les lumières de la ville, j'ai une bien meilleure méthode pour me souvenir. Je lis les livres d'Ivanov qui me donnent des images à associer aux choses. C'est à cause de la bibliothèque d'Alexandra.
Dans l'appartement d'Alexandra, il y a une grande bibliothèque, avec des livres sur toutes les étagères. Il y a exactement 542 livres. 300 ont des reliures rouges. 201 ont des reliures vertes. 41 n'ont pas de reliure du tout. Le rouge est un rouge foncé, avec de petits reflets rose là où la teinture s'est un peu abimée avec le temps, et à force d'être saisie par des centaines de mains. Alexandra lisait beaucoup ses livres. Elle me dit qu'elle adore ça. Elle me dit que, quand elle était petite, elle passait des heures sur le fauteuil qui a de gros accoudoirs, juste au coin de la pendule avec les aiguilles qui, paraît-il, font passer le temps. Elle me dit qu'elle prend un livre dans l'étagère, qu'elle s'assoit dans le fauteuil, qu'elle écoute le feu crépiter dans la grosse cheminée et qu'elle oublie le rythme du temps, qu'elle lit. Il fait bon. Il fait chaud. Il fait douillet et confortable. C'est un peu comme les soirs avec les parents, à la ferme, dans la paille, quand le feu chauffe et que le père raconte sa journée. Elle me dit que ce sont d'anciens livres de monsieur Andropov qu'elle lui a volés. Elle me dit qu'elle les lisait quand elle était obligée de rester à l'usine, pour s'évader. Elle me dit aussi qu'ici elle ne les lit plus, pour plusieurs raisons : parce qu'elle les a déjà tous lus ; parce que maintenant, il y a tant d'autres choses à faire dans la ville que de lire des livres, comme boire du vin, ou fumer des cigares, ou aller au théâtre pour se montrer, ou acheter de beaux manteaux soyeux. Elle me dit : allez-y, c'est à vous de les lire, maintenant !
Ivanov est l'oncle d'Alexandra qui me dit parfois des choses sur lui. Il voyage dans l'espace et raconte ses voyages en faisant croire qu'il ne voyage pas et qu'il invente tout. Je n'ai pas exactement compris ce qu'Alexandra m'a dit : est-ce qu'il voyage ou est-ce qu'il invente ? En fait, ce n'est pas grave ; s'il l'écrit que l'espace est grand, alors l'espace est grand. Il y a un passage qui me permet de me souvenir dans le plus petit détail des lumières de la ville, parce que la ville et les étoiles se ressemblent et que comme ça, j'ai une image à associer.
L'espace est à la portée de la main pour qui veut y consacrer sa vie. Cette phrase a été prononcée par l'un des plus grands penseurs de notre pays. Sergueï Lioubakov savait parler aux âmes. Il a occupé pendant trente années le poste prestigieux de commissaire aux affaires spatiales. Il s'est battu pour que notre pays se hisse au rang des puissances pour lesquelles l'espace n'est plus un fantasme, mais un but à atteindre. Il n'est pas allé dans l'espace, parce que la technologie de son époque ne le permettait pas encore. Mais je ne mettrais jamais en doute qu'il y a consacré sa vie. Faut-il penser, alors, qu'il y est finalement allé ? Je reste persuadé que, d'une façon ou d'une autre, il a vu cet espace au-delà de ses seuls rêves, au-delà de ses calculs et théories, au-delà de ses plus brillantes spéculations. C'est à lui que je pense quand je me trouve entouré d'étoiles, dans ce si vaste champ dont nous entamons déjà la conquête, conscients qu'il faudra bien plus d'une seule génération pour en venir à bout.
L'espace est grand. L'espace est majestueux. L'espace est sans fin. Sergueï Lioubakov disait un jour à ses élèves de l'académie des sciences d'Osko que le but réel compte moins que le chemin pris pour arriver à ce but. Le plaisir est dans l'accomplissement, et le but n'est qu'un rêve formé par notre esprit pour donner l'espoir. Sans un but, l'homme n'existe pas. Son but, il le dessine lui-même. Il le connaît comme il connaît sa femme, et ses enfants. Alors quand je suis dans l'espace, entouré d'étoiles, je sens à mes côtés le regard insistant de Sergueï Lioubakov qui a déjà tout vu des grandeurs infinies et qui m'invite à rêver aussi haut que lui. Le rêve et l'espoir : n'est-ce pas là ce qu'il faut retenir des enseignements d'un maître ?
Le ciel est constellé, il brille. Je suis dans les étoiles comme dans ma demeure. L'espace n'est que lumières et lanternes. Il ressemble à un jour de parade dans une grande ville animée ; les gens se rassemblent dans les rues et remuent des lampions ; les fenêtres s'allument et s'éteignent à tour de rôle ; les couleurs se mélangent les unes avec les autres. L'allégresse est partout ; la joie est auprès de chacun. Les plus grandes des étoiles, celles dont la lumière éblouit trop, sont de solides matrones agitant des drapeaux et criant à pleins poumons. Les petites, les polaires, semblent d'abord s'éteindre. Mais ensuite elles se rallument, et se mettent à clignoter. Elles prennent des couleurs qu'on ne leur soupçonnait pas et leur costume surprend le visiteur de passage. Là, regardez ! C'est une étoile mouvante. Elle se déplace de droite à gauche et semble venir dans ma direction. Elle est maintenant suivie par trois autres de ses compagnes. L'une est verte, l'autre est rouge. La dernière est bleu vif et éclate comme un feu de Bengale en la gerbe la plus fantastique que je n'ai jamais vue. Mes yeux pleurent. Est-ce la lumière qui m'éblouit, ou l'émotion qui me prend ?
Le spectacle qui s'offrait à mes yeux ce jour-là allait résolument changer ma vie. C'était ma première sortie dans l'espace. Les conseils du vieux sage d'Osko me revenaient en tête, comme s'ils ne m'avaient jamais véritablement quitté. Ainsi était-ce cela, le plaisir de l'accomplissement dont il nous parlait sans cesse en levant les yeux vers le plafond de la salle de cours où était peinte une gigantesque constellation d'étoiles. Je comprenais que ces images resteraient à jamais gravées dans mon esprit, et que ma voie était à présent trouvée : je serais spationaute. L'espace serait mon continent.
N'est-ce pas si beau, tout cela, que l'on aimerait, comme Sergueï Lioubakov, le rêver plutôt que de le vivre ?
Quand je ne lis pas, je vais aux réunions du club Rafael. Au début, je ne savais pas ce qu'était le club Rafael. Ivanov n'en parle pas dans ses livres. Mais c'est Ilya qui me l'a expliqué. Le club Rafael rassemble quelques uns des membres du conseil restreint des grands possédants selon un système de cooptation. C'est une institution officieuse auprès de laquelle le gouvernement prend des avis. Il est impératif pour chaque grande entreprise d'y avoir un représentant, pour se tenir au courant des futures décisions politiques. Voilà ce qu'Ilya m'a dit. La première fois que j'y suis allé, j'ai surtout compris que c'est un endroit où on boit, et où on fume (la ville est pleine de fumée et de vapeurs d'alcools : elle fonctionne comme ça, comme les machines de l'usine fonctionnent avec du charbon), et où les autres parlent.
« Pourquoi une figure si sombre ? Les progrès des scientifiques du spatioport de Gord ne sont-ils pas exceptionnels et si pleins de promesses ? »
L'homme qui parle est un patron : il porte un chapeau et une canne. Pas de manteau en fourrure. Mais je sais qu'il en a un, normalement, car je l'ai vu le donner à l'homme du vestiaire juste au moment où il est entré, juste avant de voir l'autre homme (sans chapeau, sans canne, sans fourrure, mais avec une moustache qui fait le tour de son menton, et les moustaches et les barbes sont aussi des détails importants pour repérer les patrons, comme je l'ai appris déjà à l'usine et beaucoup ici, aussi) et de ne même pas poser sa canne et son chapeau, alors que l'homme du vestiaire attend avec la fourrure qui lui encombre les bras. Je pourrais lui dire, mais je ne sais pas comment lui parler.
« S'il ne coûtaient pas si chers, mon ami, je m'en féliciterai. Mais l'argent... Il ne cesse de manquer, et nous ne cessons de le dépenser ! »
Sur les moustaches et les barbes, il faut que je sois plus clair, car ce que je sais est très compliqué, mais c'est un savoir très important. Avant, à l'usine, je pensais qu'il n'y avait qu'un patron. Et en fait, il n'y avait qu'un patron : monsieur Andropov. Mais maintenant, à Likoutsk, je sais qu'il y a plusieurs patrons et même plusieurs sortes de patrons, sûrement pour aller avec les différentes sortes d'usines qui entourent la ville. Et chez les patrons, il y en a de plus importants, et de moins importants. Importants, ça veut dire qu'ils posent les questions, et que les autres (moins importants) doivent répondre. Et ce que je sais, c'est que la taille de la barbe indique les degrés d'importance des patrons. Les patrons avec juste une toute petite moustache sur le dessus des lèvres sont des bas-patrons ; par contre, ceux avec une énorme barbe qui est aussi grosse que leur plastron, ce sont des hauts-patrons.
« Les budgets que le gouvernement nous accorde fondent trop vite dès qu'il s'agit de préparer... l'arme. Cette tâche prend du temps et occupe trop de personnel, telle est mon opinion. J'espère que le gouvernement changera d'avis sur ce point et remontera les budgets. »
Dans la pièce où je suis, par exemple, il y a un haut-patron debout face à la cheminée toute marbrée : je le sais parce que le miroir me dit qu'il a une barbe immense, grise.
« Etiez-vous invité au mariage d'Alexandra Andropov ? »
Le haut-patron à la barbe grise fait des gestes sur la cheminée. On dirait qu'il la dépoussière. Mais je ne pense pas. A Likoutsk, il y a des hommes qui sont là juste pour dépoussiérer les meubles. Ce sont souvent des femmes, mais pas toujours. Ils n'ont pas de moustache, et encore moins de barbes, évidemment. Le haut-patron doit être en train de faire autre chose, mais je ne vois pas quoi parce que le reflet de son geste dans le miroir est masqué derrière une grosse pendule qui indique l'heure, en bois doré et vernis.
« Le pendu impromptu était une telle trouvaille ! Il n'est guère difficile de savoir qui avait préparé le coup... Je m'y attendais presque pour dire le vrai, au point que j'ai à peine sursauté en le voyant. Il aurait été moins laid et loqueteux que j'aurais applaudi l'astuce ! Le vieux a encore le sens de la répartie. »
Il y a plusieurs pendules presque exactement identiques. J'en ai compté dix-neuf, et encore : je n'ai pas visité toutes les pièces de l'habitation (je ne sais pas si on doit appeler ça une habitation comme il n'y a pas de chambres). Chaque fois que je viens au club Rafael, j'essaie de découvrir une nouvelle pièce, mais plus je m'avance, plus je me perds. Je suis obligé de me représenter l'habitation comme un train où chaque pièce est une nouvelle station.
« Je ne sais plus bien... Gordon... Anton... Quelque chose comme ça. Bien sûr qu'il s'est laissé abuser ! »
Quand même, j'ai des repères par rapport à l'appartement d'Alexandra. Par exemple : dans les deux, il y a une pièce avec un piano, et une pièce avec une table de roulette. Par contre, au club Rafael, il y a plusieurs pièces avec une bibliothèque, et je me perds souvent.
« Vous ne pensez pas que c'est un peu la fin de son règne ? Les usines Andropov ne sont-elles pas les plus touchées par les actes terroristes ? Est-ce qu'il a raison de partager la direction avec son contremaître ? »
Le moyen que j'ai trouvé, c'est de retenir le nombre de livres qu'il y a dans chaque bibliothèque. Heureusement, il y en a un nombre différent à chaque fois. Mais c'est un peu long. Alors, comme je commence à savoir lire, je retiens aussi les titres, au bout d'un moment. Et les titres des livres, c'est un très bon moyen pour retenir dans quelle pièce on est.
« Est-ce vraiment cela votre opinion ? »
C'est amusant : je n'ai trouvé aucun des livres d'Ivanov. Je vais essayer de visiter une autre bibliothèque la prochaine fois que je viens.
« Il ne faudrait pas que l'exemple d'Andropov laisse à penser que notre génération est déjà à terre ! Ils sont nombreux, qui essayent en vain de ronger les reliefs de notre pouvoir. Ne leur laissons pas croire que nous leur abandonnons de bon grè de copieux morceaux par manque d'appétit. »
Au bout d'un moment, je reconnais tous les visages, toutes les moustaches et toutes les barbes. Toutes les pièces aussi. Onze. Dont deux qui sont fermées à clef et que je ne peux pas ouvrir, du coup, pour savoir s'il y a d'autres pièces derrière. Je ne sais pas si un jour je pourrais savoir le nombre précis de pièces de l'habitation. Toujours pas de chambre.
« Et sa face édentée... Et ses bras qui semblaient s'agripper aux branches du chêne... Et ses guenilles (il était presque nu)... J'aurais applaudi, vous dis-je, tellement la farce était réussie ! Un pantin sacrifié par son marionnetiste, pour une dernière représentation. »
Une statue en marbre blanc sur un socle en granit. Son bras gauche est replié vers l'intérieur de son corps. Son bras droit est tout droit, d'un coup, dirigé vers le vase de la pièce d'à-côté. Ou plutôt vers l'entrée de la pièce d'à-côté.
« Vous êtes trop pessimiste, mon ami. Nous n'avons pas à nous méfier de cet homme. Qu'est-il vraiment ? Un contremaître devenu contremaître-en-chef . Il arrêtera là ses manigances. Ce qu'il voulait, c'es t la fille, pas la direction. Il est de cette sorte d'homme qui se contente des plaisirs simples et charnels, et ne jalouse en rien la jouissance intellectuelle qui est la nôtre. Une question d'éducation, sans aucun doute. »
Les couleurs de l'habitation sont très belles. Pas aussi belles que celles des livres d'Anton. Plus sombres. Il y a plus de gris et de noir par exemple. Mais ça doit être à cause de la ville : les couleurs sombres sont les couleurs de la ville, et je ne vois pas raison pour que le club Rafael ne suive pas la même règle. Surtout si c'est l'endroit le plus important de la ville. Enfin, je crois.
« Et le gouvernement, sa décision vous semble-t-elle juste ? Elle était tellement inattendue. »
Parfois, pour ne pas me perdre quand il y a trop de pièces que je ne connais pas encore, je suis un homme. Plus il a de la barbe, et plus j'hésite à le suivre, alors quand j'arrive, la première chose que je fais, c'est de repérer les moustaches. C'est devenu un réflexe et maintenant, je les repère même dans la rue ! Je me demande si Ivanov a une moustache. Il n'est pas un patron, mais il est quelqu'un d'important.
« Il faut se méfier d'Andropov. Le surveiller ; autant qu'il a pu, lui, nous surveiller, du temps de sa splendeur. Depuis le fameux mariage, qui est sur toutes les lèvres, il mène ses ouvriers à la baguette. La rumeur dit qu'il en a déjà tué une vingtaine à la tâche ! »
Encore une pendule en bois doré et vernis sur une cheminée !
« Il les oblige à un travail sans fin : reconstruire son usine. Et il croit que tous ses ouvriers sont des terroristes, et en fait fusiller un par semaine, pour l'exemple... »
Voilà ce que je sais, et si je savais l'écrire, je l'écrirais : dans la ville, les pièces des habitations sont comme les habitations de l'usine. Il y en a beaucoup, et elles se suivent les unes les autres. D'ailleurs, à l'usine, les habitations n'ont qu'une seule pièce.
« Le gouvernement a eu parfaitement raison de proposer ces élections pour le mois à venir. Elles confirmeront aux ouvriers que nous sommes plus aptes à les diriger que leurs inutiles comités. Ayons confiance, que diable ! L'ordre est une force aussi immuable et naturelle que l'assise des montagnes. »
Pourtant, chez les parents, il y avait plusieurs pièces dans l'habitation... Ou pas ? Je ne sais plus, et comme l'habitation des parents a brûlé, je ne peux plus aller vérifier.
« Alors nous gagnerons ? »
Voilà pour l'habitation du club Rafael dont je connais toutes les pièces. Maintenant, dans chaque pièce, il y a des moulures au plafond, et je passe beaucoup de temps à regarder en l'air (du coup, j'ai mal au cou). Certaines sont juste des lignes en relief, comme des poutres posées horizontalement pour retenir les murs. Mais elles ne sont pas toutes pareilles. Il y en a qui sont des feuilles, alors qu'il n'y a pas d'arbres !
« Andropov est devenu fou, rien de plus. La majorité des ouvriers savent qu'ils peuvent nous faire pleinement confiance, que nous les nourrissons et, j'ose le dire, que nous les aimons ! Il n'y a de troubles que des agitateurs minoritaires dont il sera facile de se débarrasser. »
Au bout d'un moment, j'ai fini d'examiner les moulures du plafond et je connais par coeur le parcours de la liane en stuc qui court de la corniche à l'entrée jusqu'à la porte de la salle de bal. Du coup, j'ai trouvé comment ne plus m'ennuyer : j'emprunte un livre d'Ivanov dans la bibliothèque d'Alexandra. Je m'assois sur un fauteuil (au club Rafael ils ont les mêmes fauteuils que dans l'appartement : ça doit être le signe de reconnaissance des membres quand il s'invitent les uns chez les autres et qu'ils s'asseoient dans des fauteuils). Et je lis un passage de Les promesses de l'infini.
Le moteur du char Reskaï était clairement arrivé à bout de ses forces. Il devenait à présent certain qu'il ne pouvait plus évoluer à un tel dénivelé et que l'exploration de la planète sauvage allait devoir se faire à pied. Mes compagnons et moi, nous tremblions tous. Les éclaireurs avaient reperé un parti de Xlythoniens belliqueux qui ne demandaient qu'à en découdre. Nous étions pour eux des intrus, et je m'égarais parfois à penser qu'ils avaient raison, et que nous agirions de la même manière si notre pays était attaqué par des êtres de l'espace. Pourtant, le moment n'était pas aux regrets, mais à la survie. Nous n'avions que trop peu de temps avant que le second soleil de Xlython ne disparaisse et que le plateau ne soit plongé dans une obscurité qui ne pouvait que profiter à nos adversaires. Leurs yeux étaient adaptés au noir le plus total. Nous n'avions comme seules alliées que des lampes à hydrogène, ce qui rendaient notre sort plus qu'incertain. Parviendrions-nous à regagner la base arrière à temps ?
Les tambours résonnèrent plus vite que je ne l'avais pensé. Nous n'étions pas préparé à une attaque de cette ampleur. Déjà, plusieurs de mes compagnons se découragaient et voulaient faire demi-tour, sans se rendre compte que, face à l'ennemi, la fuite est la dernière étape avant la mort. C'est courageusement, et de front, que nous accueillerions les fusils à protons réoxygénés des Xlythoniens ! Les extraterrestres rajiformes préféraient nous attaquer en masse avant de connaître nos intentions, de parlementer. Soit. L'honneur était de notre côté. Le peur qui grandissait en moi ne faisait que nourrir ma détermination, et l'effroi était le moteur de ma bravoure.
Cinq de mes compagnons furent tués lors du combat. Les Xlythoniens capturèrent les deux autres et, pour ma part, blessé par un douloureux coup au tibia, je fus séparé d'eux. Les Xlythoniens me mirent dans une cage à part. Je me débattais comme un beau diable ! J'espérais me soustraire à l'emprise des tentacules visqueux de mes géôliers et m'enfuir pour retrouver la base. Une fois à la base, nul doute que nous serions suffisamment nombreux pour lancer une contre-attaque et délivrer les deux prisonniers. Les armes de Xlythoniens étaient puissantes, mais les armes à protons réoxygénés ne pouvaient pas grand chose face aux boucliers atomiques. Cette petite merveille de technologie n'avait encore jamais servi. Des centaines de boucliers attendaient leur heure dans les hangars de la base, et l'occasion serait trop belle de pouvoir en expérimenter le potentiel défensif.
Mais il n'y avait rien à faire : isolé, je ne pouvais rien. Les tentacules et la cage se refermaient sur moi. En temps de guerre, seul le nombre compte. Les héros les plus exceptionnels sont ceux qui savent se fier à leurs camarades. Les Xlythoniens me traînèrent jusqu'à ma prison. Déjà, j'avais perdu de vue les deux autres prisonniers, transportés dans je-ne-sais quelle autre geôle aussi inquiétante que la mienne. La cage était souterraine. Elle était sombre. Elle avait été creusée par les Xlythoniens dans un territoire où l'obscurité avait toujours régné. Eux-mêmes ne s'en approchaient pas sans émettre des piaillements que je reconnaissais sans peine comme les manifestations d'une peur larvée. Ainsi apprenais-je que mes adversaires aussi pouvaient avoir peur. Cette pensée me conforta brièvement, malgré la barrière de ténèbres et l'angoisse du silence profond.
Ce qui m'inquiétais, ce n'était pas la mort. Ce qui m'inquiétais, c'était la réponse à cette question que j'osais à peine me poser : pourquoi m'avaient-ils gardé vivant ? Les récits des rares patrouilleurs revenus d'entre les mains des Xiertch me revinrent accidentellement en tête. Me gardaient-ils vivant pour me confier à leurs scientifiques malsains avides de disséquer une créature humaine ? Devais-je servir de nourriture à un quelconque monstre des abîmes qu'ils vénéraient comme un de leurs dieux barbares ? Allais-je être réduit pour le restant de mes jours au rang d'esclave d'une race dont les moeurs étaient des plus répugnantes et qui était encore loin d'avoir atteint le degré de civilisation de la race humaine ? A mon grand dam, je n'eus pour seul réponse que le silence implacable.
Je lève la tête. Dedans, j'ai encore peur à la place d'Ivan. Alors j'ai un peu de mal à me souvenir d'où je me trouve. Les moustaches, les pendules, la liane d'entrée au bal.... Je suis au club Rafael, avec les moustaches et les barbes.
Parfois, je dois rentrer, alors je referme Les promesses de l'infini. Mais il y a des jours où je ne rentrent pas à l'appartement d'Alexandra. Souvent, c'est parce qu'il faut que j'aille chercher Alexandra quelque part. Au théâtre. Au cabaret. Dans un club qui n'est pas le club Rafael mais qui est un club quand même. Mais parfois, je ne rentre pas à l'appartement pour de toutes autres raisons. Par exemple : je me suis fait enlever.
Je me suis fait enlever en sortant du club Rafael, sur le trottoir, par une voiture noire. Par les occupants d'une voiture noire. Ils étaient trois avec des cagoules sur leur tête et je n'ai pas compris tout de suite pourquoi ils avaient des cagoules sur leur tête. Je sortais du club Rafael pour rentrer à l'appartement d'Alexandra. Devant moi, sur le trottoir, il y avait une moustache – un bas-patron – qui s'est retourné. Il avait peut-être oublié sa canne aux vestiaires du club Rafael – il n'avait pas sa canne, et c'est ça qui m'a intrigué et c'est pour ça que je l'ai fixé mais lui aussi me fixait, du coup. Comme on s'entrefixait, je n'ai pas vu qu'une voiture noire venait d'arriver. Je pense qu'elle a dû arriver très vite, parce que très peu de temps s'est écoulé entre le moment où je suis sorti du club Rafael, sur le trottoir (il n'y avait pas de voiture noire alors) et le moment où je me suis dit « Tiens, la moustache n'a pas de canne. ». Ce n'est que très longtemps après que j'ai réalisé qu'il pouvait y avoir un lien entre l'absence de canne et le fait qu'il se retourne. Sur le coup, si je l'ai fixé, c'était juste parce qu'il n'avait pas de canne. Comme je l'ai fixé, je n'ai pas vu la voiture noire arriver. Très longtemps après, je me suis aussi demandé si, en voyant la voiture arriver, j'aurais fait quelque chose de différent que ce que j'ai fait : rester là. Je ne sais pas. Et pourtant je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu cette histoire de canne et de moustache, je n'aurais pas été enlevé par la cagoule qui est sortie de la voiture noire, qui m'a pris par le bras, qui m'a traîné jusqu'à la voiture, qui a crié à la moustache de se taire. Je crois que la cagoule avait une arme, ce qui expliquerait pourquoi la moustache a obéi. Dans la voiture noire, ils étaient trois cagoules. Là j'ai commencé à ne plus rien comprendre. Est-ce que c'est possible qu'une même personne existe trois fois ? Et puis, il y avait trop de nouveautés en même temps et mon esprit surchauffait à cause de la canne, de la voiture noire, de la triple cagoule. Heureusement, ils m'ont mis aussi une cagoule sur la tête. Au moment où ils m'ont mis la cagoule sur la tête, j'ai senti mon esprit qui se refroidissait petit à petit. Pour trois raisons qui sont liées les unes aux autres. D'abord parce que je ne voyais plus de nouveautés (juste le noir). Comme je ne voyais plus de nouveautés, ensuite j'ai pu réinterpréter ce qui s'était passé. Pour la canne, je n'ai pas encore tout compris, mais je suis passé directement aux cagoules. Et là, enfin, j'ai compris que, de même que je me trouvais sous une cagoule, il devait y avoir d'autres ouvriers sous les cagoules, et donc possiblement des matricules différents. Tout rentrait dans l'ordre ! Il me restait juste à savoir s'ils s'étaient mis eux-mêmes leur propre cagoule où si, comme dans mon cas, c'était une autre cagoule qui leur avait mis la leur, un peu comme une chaîne de cagoules. C'était important, parce que dans ce cas, cela voulait dire que j'allais devoir mettre une cagoule à quelqu'un, et je ne savais absolument pas à qui. Il n'y a pas eu de réponse à ma dernière interrogation parce qu'on m'a enlevé la cagoule. De nouvelles questions ont recommencé à faire bouillir mon esprit : je ne trouvais plus le club Rafael, ni le trottoir du club Rafael ; surtout, je n'étais plus dans la voiture noire, mais dans une petite pièce sombre qui ressemblait beaucoup à mon habitation de l'usine. Est-ce que j'étais revenu à l'usine de monsieur Andropov ? Est-ce que j'avais pris le train ? Pourquoi est-ce que les autres cagoules avaient encore la leur, alors qu'on m'avait enlevé la mienne ? Rien n'allait plus : aux questions que je me posais moi, et auxquelles j'avais déjà bien du mal à répondre, maudissant le trop grand nombre de nouveautés et de ne pas avoir été prévenu, les cagoules se sont mis à me poser des questions ! Heureusement, je ne comprenais pas tout à leurs questions. Ils voulaient que je choisisse mon camp. Ils voulaient que je leur dise si j'étais avec eux ou contre eux. Ils voulaient que je leur dise si j'étais avec les ouvriers, ou avec le patronat. A cette dernière question, j'ai voulu leur répondre que j'étais avec le patronat (je venais de quitter le club Rafael quand ils m'ont enlevé, et ce n'était pas très difficile de deviner la bonne réponse), mais j'ai compris que c'était beaucoup plus compliqué. Après tout, j'étais un ouvrier il n'y a pas si longtemps. Comme je ne savais pas si on pouvait être à la fois ouvrier et patron – et que ce choix ne faisait pas partie des réponses qu'ils m'avaient suggérées – je n'ai rien dit. Alors ils m'ont appelé camarade Anton et ils ont reposé la dernière question. Avec les ouvriers ou avec le patronat ? Là, ils m'ont donné un indice qui m'a permis de trouver la bonne réponse : ils m'ont dit que si j'étais avec le patronat, alors ils me tueraient (ils avaient tous des fusils dans les mains). Je leur ai dit que j'étais avec les ouvriers en leur exposant pourquoi, quand on est un ouvrier, on le reste pour toujours (je n'en étais pas sûr moi-même mais, au moment de le dire, les idées me sont venues). Je pensais bien que la réponse allait leur convenir, mais ils ont insisté. Pour leur prouver que j'étais bien avec eux, et pas contre eux, il fallait que j'agisse. Il fallait que je tue monsieur Andropov. C'est là que les choses, qui n'étaient déjà pas très simples, ont commencé à être vraiment compliquées dans ma tête. Tuer monsieur Andropov ? Je ne voyais pas le rapport entre être un ouvrier et tuer monsieur Andropov. Ou alors cela avait un rapport avec la cagoule. Ils avaient tué monsieur Andropov pour avoir une cagoule ? Non, ça n'avait pas de sens. Je sentais bien, pourtant, qu'il devait y avoir une raison profonde, et j'espérais qu'ils allaient me la dire. Mais non. Il fallait que je dise si, oui ou non, j'étais prêt à tuer monsieur Andropov. Ils ont ajouté qu'il fallait que je tue monsieur Andropov « pour venger les crimes qu'il commettait contre les camarades ouvriers à l'usine. ». C'était un bon indice, et gentil de leur part (je trouve ça gentil quand on me donne des indices pour donner la bonne réponse aux questions). Malheureusement, je ne savais pas quels crimes monsieur Andropov commettait à l'usine. Plus tard, j'allais l'apprendre. Mais là, au moment précis où j'étais avec les trois cagoules dans la pièce qui ressemblait à une habitation de l'usine, je ne savais pas. J'ai un peu regretté de ne pas avoir plus écouté Ilya quand il venait faire ses rapports à Alexandra. Mais ce n'était pas facile de savoir que ça aurait pu me servir... Surtout pour tuer monsieur Andropov. Tout ça était encore un peu flou.
108 est entré dans la pièce. J'étais content pour plusieurs raisons. Parce que je ne m'étais pas trompé : la cagoule est certainement le signe des ouvriers. Parce que 108 est une des seules personnes à connaître autant de choses que moi, sur le pays, sur l'espace, sur la planète. Parce que quand 108 parle, j'arrive, en général, à comprendre ce qu'il dit. Il a crié quelque chose aux cagoules. Ils ont parlé fort entre eux. Et puis les cagoules sont sorties et je suis resté seul avec 108. Il m'a détaché les mains. Il avait l'air un peu en colère.
« Au nom des membres de l'Union des comités ouvriers, je m'excuse, Anton. Sincèrement.
Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que je ne comprends pas pourquoi je dois tuer monsieur Andropov.
« Oublie ce qu'ils t'ont dit. Les hommes auxquels tu viens d'être confronté sont les meneurs de l'aile extrêmiste de l'U.C.M. Nous ne sommes pas encore parvenus à contrôler tous les groupuscules qui se sont formés au sein de notre parti. Cette action a été organisée sans notre accord. Fort heureusement, comme tu l'as toi-même vu, ma position de secrétaire général de la section de Likoutsk me donne, malgré tout, un ascendant sur eux. Ils ne comprennent pas que la voie démocratique qui nous est offerte par le gouvernement – que ce soit ou non conscient de la part de nos dirigeants actuels – est une bénédiction. Ils ne pensent qu'à la révolution, et à la violence. Pourquoi faut-il que les hommes choisissent toujours la pire des issues ?
108 a vraiment l'air en colère. Presque triste. Je lui dis que je suis content de le revoir.
« Moi aussi, Anton. Moi aussi. Et je suis content que tes nouvelles fonctions aient si peu contaminé la douce discrétion de ton caractère. J'ai bon espoir que, parmi les patrons, certains soient à même d'entendre et de comprendre nos demandes. Ton mariage a été pour moi le signe qu'une porte s'était entrouverte vers un dialogue plus honnête entre ouvriers et patrons. Alors crois-moi : te revoir est une joie. Sans doute aurais-je préféré que ce fût dans d'autres conditions.
Est-ce que nous sommes à l'usine ?
« Non Anton, pas du tout... Nous nous trouvons encore à Likoutsk, dans un vieux hangar au bord du fleuve, abandonné suite aux inondations de l'année passée. Les extrêmistes révolutionnaires en ont fait leur quartier général parce qu'on ne peut y accéder qu'en barque, ou à la nage. C'est Pietr Ceskovitch qui m'a prevenu que tu t'étais fait enlever à la sortie de club Rafael. Il t'a reconnu. C'est un ouvrier de l'usine Andropov, lui aussi. Je suis venu aussi vite que j'ai pu, avec plusieurs membres du bureau de l'U.C.M. Nous pensons parvenir à calmer les révolutionnaires : ils n'ont aucun intérêt à être ostracisés par une structure qui rassemble la majorité des ouvriers du pays. Ils vont accepter de te libérer. Nous négocions pour qu'ils se rallient définitivement à la procédure de désignation des candidats de l'U.C.M. pour les prochaines élections. Il faut réunir tous les ouvriers autour d'une perspective commune. Ça ne va pas sans difficulté, tu dois t'en douter. Mais nous ne désespérons pas de remplir aussi cet objectif, qui sera une étape essentielle de l'arrivée au pouvoir de la classe ouvrière. Et, à terme, de l'abolition de toute distinction de classe, bien évidemment.
Finalement, 108 ne m'a pas aidé à mieux comprendre toute la situation comme je l'espérais. Mais au moins, plusieurs points ont été éclaircis pendant sa venue : je ne suis pas à l'usine, mais à Likoutsk, les cagoules sont bien des ouvriers, mais avoir une cagoule n'est pas le signe de tous les ouvriers. En revanche, je ne sais encore rien sur les crimes de monsieur Andropov. Je voulais le demander à 108, mais il a parlé plus vite que moi.
« Anton, je ne te demande pas si tu souhaites faire partie de l'U.C.M. : si grande que soit ton envie de participer à l'affranchissement de la classe dont tu es issu, la position que tu occupes actuellement ne te permet pas de te compromettre ainsi. Pourtant, je me plais à croire que tu auras, dans le futur, un rôle à jouer dans notre combat. Il n'est pourtant pas dans ma nature de croire à l'immutabilité des destins individuels ; le temps m'a appris que seuls les évènements collectifs ont une importance et un impact sur l'avenir, et qu'individuellement, les hommes n'ont aucun impact. Alors dis-moi, Anton, pourquoi ta présence me donne cette sensation qu'une vie suffit à changer le cours du temps ?
C'est facile : parce que je suis l'élu. Je croyais que 108 était au courant. Alors, pour ne pas le vexer, je lui dit que je ne sais pas. C'est aussi ce que j'ai répondu à Alexandra quand elle m'a demandé pourquoi on m'avait capturé. Et c'est vrai : les cagoules n'avaient pas été très claires dans leurs demandes. Comme ils m'ont relâché trop vite – à la gare de la ville – ils n'ont pas eu le temps de me poser toutes les questions qu'ils souhaitaient, sûrement. Ou alors c'est à cause de 108. Il y avait cette histoire de tuer monsieur Andropov, et 108 est arrivé pour me dire que ce n'était pas ça du tout, que c'était juste pour participer à un combat, qu'il fallait s'unir, et que j'étais l'élu. Le temps qu'Alexandra arrive (il y avait un policier à la gare qui m'a reconnu et qui m'a expliqué que toutes les polices de la ville me cherchait parce que j'avais été enlevé, ce qui était stupide, puisque s'ils savaient que j'avais été enlevé, ça ne servait à rien de me chercher) j'ai repassé dans ma tête le déroulement de l'enlèvement. L'exercice est le même que celui que je pratique à chaque tour de pâté de maison, sauf que, dans ce cas, les nouveautés se bousculent les unes sur les autres. Quoique. Il y avait 108, qui n'est pas vraiment une nouveauté. Quoique. 108 à Likoutsk, au contraire, c'est une nouveauté. Et il y avait les cagoules ; important, les cagoules : elles sont la marque des ouvriers. Quoique. Il y avait 108, qui n'avait pas de cagoule. A chaque nouveauté, 108 vient la percuter et la contredire. C'est pour ça que j'ai trouvé plus logique de ne pas parler de 108 à Alexandra et Ilya quand ils m'ont demandé de dire à la police ce qui s'était passé. 108, il ne rentre pas dans le trou. Il ne veut pas qu'on le visse. Il est en dehors de la chaîne. Mais ça, je le sais : 108 est à part, comme je suis à part, comme Alexandra est à part. Et raconter l'enlèvement avec 108 aurait été bien trop compliqué, parce qu'il aurait fallu classer les faits en fonction de leur degré de nouveauté. Alors, tout en haut, les cagoules des ouvriers. C'est certain : à Likoutsk, les ouvriers ont des cagoules. Après, il y a les fusils des ouvriers : à Likoutsk, les ouvriers ont des cagoules et des fusils ; et des voitures noires : les ouvriers ont des cagoules, des fusils et des voitures noires (de même que les patrons ont des chapeaux, des cannes, des manteaux de fourrure, et maintenant des moustaches ou des barbes). Dans les autres nouveautés, il y a « tuer monsieur Andropov ». Une sacrée nouveauté, parce que jamais elle n'aurait pu me venir à l'esprit, alors que les ouvriers et les cagoules, c'est simplement juxtaposer deux choses que je connais séparément, ce qui est nettement moins difficile. Mais à côté, il y a tout ce qui n'est pas une nouveauté : l'habitation dans laquelle ils m'ont emmené et 108. En même temps, les non-nouveautés posent problème par là où elle se trouvent : l'habitation et 108, oui ; mais l'habitation et 108 à Likoutsk, ça devient une nouveauté. Et une nouveauté qui n'est pas une nouveauté, je n'arrive pas encore à l'expliquer.
Du coup, j'ai dit à Alexandra et Ilya que je ne savais pas pourquoi on m'avait enlevé. Tout le reste aurait été bien trop compliqué. Le problème, c'est qu'Ilya sait que toute chose a forcément une raison et Alexandra me dit :
« Mais, mon pauvre Anton ! Ils ne vous ont pas enlevé comme ça, pour rien, sans rançon, ces horribles terroristes ! Ils vous ont fait du mal ? Ils voulaient quelque chose de vous ? Dites-moi ! Dites-le à moi, votre Sacha : qu'est-ce qu'ils voulaient ?
Du coup je lui dit qu'ils voulaient que je tue monsieur Andropov ; si je lui ai dit, c'est parce que le policier est parti et que je suis seul avec Alexandra. Ou plutôt je suis seul avec Alexandra et Ilya. Si je ne le dis pas au policier, c'est moins grave : le policier note les choses, il garde la mémoire écrite des évènements, et, à Likoutsk, la mémoire écrite est supérieure à la parole. Alexandra et Ilya ne m'ont plus rien dit. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'appartement. Alexandra me prend dans les bras.
« Mon pauvre, pauvre Anton ! J'ai eu tellement peur qu'il vous arrive quelque chose de grave... Qu'ils vous tuent ! J'étais ici, avec Ilya, quand un policier est venu nous prévenir de votre enlèvement, juste sur le porche du club Rafael. Et après ce qu'Ilya venait de me raconter sur l'usine, j'ai tout de suite pensé à une vengeance !
En effet, dans l'appartement, la porte de la chambre d'Alexandra est fermée : c'est le signe qu'Ilya est là. Mais je ne vois pas pourquoi Ilya voudrait se venger...
« Une vengeance des ouvriers de l'usine. Ils s'en prennent au plus vulnérable d'entre nous, à celui qu'ils doivent certainement considérer comme un traître. Ces gens-là n'ont pas d'autre morale que la loi du talion. Ils punissent avec la sauvagerie de leur caste les affronts qui leur sont faits ! Voilà ce qui m'a traversé l'esprit, mon pauvre Anton !
La vengeance des ouvriers, pas d'Ilya. Ce qui ne m'explique pas pourquoi ils voudraient se venger. Et contre qui ?
« Il faut que vous sachiez ce qu'Ilya m'a dit à propos de l'usine. Ilya ! Venez répéter votre rapport à Anton ! Qu'il sache !
Ainsi il y a quelque chose que je ne sais pas et que je devrais savoir... Savoir, c'est important.
« Bonjour, monsieur Anton. Ce qu'Alexandra entend que je vous sachiez est la situation exacte dans laquelle est plongée l'usine. Cette situation, catastrophique sur un grand nombre de points, peut impliquer, à terme, que vous preniez une part de plus en plus grande aux décisions concernant l'usine. J'en viens à présent à l'exposé des faits. Depuis le départ de mademoiselle Alexandra, votre beau-père présente tous les symptômes d'une démence avancée qui le rend inapte à diriger l'usine au moyen de critères objectifs. Je peux vous citer une partie des actes qui m'ont conduit à cette grave conclusion – grave pour l'usine, et grave pour la famille Andropov, bien entendu. En une semaine, il a fait fusiller par l'armée vingt ouvriers ; les motifs qu'il a avancé pour ce massacre n'ont rien de rationnels (même si, paradoxalement, votre récit abonde plutôt dans son sens). Il est persuadé que tous les ouvriers de son usine complotent contre lui. Pour déjouer le complot, il modifie au dernier moment l'organisation des travaux de reconstruction, et suite aux constants allers-retours qu'il impose aux ouvriers, les travaux en question sont cesse retardés. J'ajouterai que, personnellement, j'ai assisté à la conduite de tortures sur un ouvrier qu'il avait sélectionné au hasard, le matin-même. Une fois de plus, sans aucune raison. Enfin, il fait perdre un temps considérable au bataillon d'infanterie stationné dans l'usine en l'obligeant à rester sur place, toujours par crainte du complot, et ce alors que les soldats sont attendus en d'autres lieux pour des tâches bien plus importantes qui ont pour but de maintenir l'ordre à l'échelle de tout le pays. En conséquence de quoi le gouvernement, qui a déjà suffisamment de désordre à régler, commence à voir d'un très mauvais oeil celui qui règne à l'usine. Il pourrait la faire fermer. Ou pire : la nationaliser, en attendant que le conflit se tasse et que les révolutionnaires soient maîtrisés.
Si monsieur Andropov est fou, ça peut expliquer qu'il faille le tuer. Les fous, on les tue. Voilà ce qui me manquait et qui me permet de comprendre la demande des cagoules. Heureusement qu'Ilya est là !
Les cris des rebelles m'alertèrent. Ils allaient arriver d'une minute à l'autre et constater que j'avais tué leur leader. Si je ne m'enfuyais pas, je n'avais aucune chance de regagner la cabine où les seuls membres d'équipage qui m'étaient restés loyaux avaient trouvé refuge. Ces fidèles compagnons s'étaient barricadés dans la salle d'armes du vaisseau. Là, les fusils atomiques et leurs munitions illimitées nous assuraient de pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Les fusils atomiques ont été conçus par mon laboratoire de Gord et ont déjà fait leur preuve face à de nombreux races extraterrestres. Grâce à leur système de fission instantanée, ils n'ont jamais besoin d'être rechargés. En cela, ils représentent un changement de paradigme martial considérable. Alors, qu'est-ce qui me retenait dans le couloir ?
J'avais à mes pieds le cadavre sans vie du lieutenant Mariako. Il était l'instigateur de la mutinerie, mais aussi l'un des meilleurs hommes du spatioport de Gord. Ses dons de stratèges égalaient chez lui ses capacités scientifiques. Sa carrure d'athlète en faisait un allié de poids lors des combats au corps à corps. Avant lui, aucune recrue n'avait encore satisfait, l'année même de son arrivée à la base, aux exigences de la batterie de tests que tout prétendant à un voyage spatial devait passer. En une année, il avait appris ce que d'autres mettent dix ans à assimiler. Pour cette raison, j'étais prêt à voir en lui mon futur successeur à la direction scientifique du spatioport. Je considérais l'invitation à venir rejoindre mon équipe rapprochée que je lui avais adressée comme une dernière épreuve. Il l'avait interprétée comme l'occasion de trahir toute la confiance que j'avais mise en lui pour un peu de pouvoir.
Je n'avais pu lui asséner le coup fatal qu'en fermant les yeux. L'idée d'avoir à tuer un homme de cette qualité me répugnait, et c'était pourtant le seul moyen de rétablir l'ordre des choses. Dans l'espace, quiconque se risque à la demi-mesure est condamnée. L'homme y est seul face à son destin. Chacune de ses actions aura une importance cruciale sur sa survie et celle de ses compagnons. Laisser Mariako en vie, même affaibli, aurait été une folie. Le tuer de sang froid était la solution qui s'imposait d'elle-même. Mon esprit luttait pourtant contre elle aussi farouchement que contre un ennemi mortel. Je savais qu'en agissant ainsi, c'était tout mon systême de valeurs qui s'effondrait, toute la confiance que je pouvais avoir en l'homme. Etions-nous condamnés, y compris dans l'espace, à reproduire les mêmes vieilles querelles et les mêmes instincts que nos plus lointains ancêtres, encore trop proches des animaux pour agir en hommes ? En tuant Mariako, ne devenais-je pas moi-même un animal, ou pire, un de ces extraterrestres dont je conspuais la cruauté et la barbarie ? Mon autorité n'était-elle basée que sur la violence, et non, comme je l'avais d'abord cru, sur la sagesse et la reconnaissance mutuelle?
L'aventure a un goût amer, et le destin est aussi imprévisible qu'une tempête. Pour notre patrie, sur terre et dans l'espace, nous sommes amenés à agir tel que nous n'aurions jamais cru d'avoir à le faire. Les valeurs sont mises à mal, et les consciences vacillent. Il me fallut quelques secondes avant de retrouver mes esprits et de me souvenir que mes actions en ce lieu avaient un plus grand but. Elles étaient une parcelle infime de la grande marche de l'humanité. Rétablir l'ordre dans mon vaisseau était justement le meilleur moyen de prouver que les hommes sont plus que des animaux, qu'ils ont dépassé depuis longtemps l'instinct des tribus et qu'ils oeuvrent pour le bien commun, non pour leur survie au jour le jour. Les sacrifices individuels à accomplir n'ont pas lieu de disloquer une marche inévitable. Mes hésitations ne faisaient que ralentir le cours de l'Histoire. Apercevant les premiers têtes des mutins, je m'échappais par une porte d'acier.
Je reviens au club Rafael parce qu'il est impératif que chaque entreprise ait un représentant au club Rafael, qu'il vienne ou non de se faire enlever (je ne suis pas sûr de ce point du règlement, il faudra que je regarde parce que le règlement est collé sur la porte de l'entrée du club Rafael, c'est tellement plus pratique qu'à l'usine où il était enfoui dans un tiroir et que les membres de l'usine ne savaient pas lire).
« Mon pauvre ami ! Nous avons tous été informés de votre mésaventure ! Vous devriez vous reposer, après de telles émotions. C'est tout à votre honneur que de revenir parmi nous.
Il est impératif que chaque entreprise ait un représentant au club Rafael, qu'il vienne ou non de se faire enlever (comme personne ne réagit, ça doit vouloir dire que c'est bien dans le réglement).
« Les terroristes ne venaient-il pas des usines Andropov ?
Oui, mais avec des cagoules. Sauf 108.
« Les ouvriers n'ont pas de sens commun ! Ce ne sont que des vandales incontrôlables. Le gouvernement a pris un risque insensé en proposant des élections !
« Voulez-vous un peu d'eau-de-vie pour retrouver vos esprits ?
« Peut-être devrions-nous reconsidérer notre attitude face à Andropov, s'il devient aussi évident qu'il ne sait pas tenir ses ouvriers ?
« Mais est-ce qu'on est bien sûr que les ouvriers venaient des usines d'Andropov ?
« Et que diriez-vous d'un bon cigare ?
« Et que pensez-vous de tous les soldats qu'il monopolise ?
« J'irais même jusqu'à le soupçonner de s'être allié aux ouvriers. Ils ont dû lui promettre une place de choix dans leur futur gouvernement révolutionnaire. Andropov a toujours été un être profondément corrompu. Je vois mal comment, sans son aide, des ouvriers illettrés auraient pu s'organiser pour planifier un enlèvement en pleine rue, sur les marches du club Rafael. Peut-être même est-il à l'origine des révoltes du pays !
« Il est à présent certain que l'attitude conciliatrice qu'a choisi le gouvernement ne mène qu'au chaos. Dès le départ, c'est par la force qu'il fallait régler le conflit. Avant, il n'y avait pas tous ces problèmes, et les ouvriers étaient plus sages que maintenant...
« Pourquoi est-ce qu'ils se plaignent, alors qu'ils sont logés et nourris par nos soins ?
« Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour faire machine arrière ? Est-ce que revenir sur les élections ne risque pas de provoquer des émeutes plus graves encore ?
« Je propose que chacun de nous fusille les ouvriers les plus vindicatifs de son usine. Nous y trouverons deux avantages : réaffirmer notre autorité et éviter qu'un ouvrier soit élu par accident. Car restons sérieux : l'épidémie peut encore être contenue et nous avons toujours dans nos usines des ouvriers qui savent ce qu'ils nous doivent, et qui sauront bien voter le temps venu. Quelle triste époque vivons-nous. Cela ne m'amuse guère de gérer ainsi nos usines, par la violence, plutôt que par la sagesse et la reconnaissance mutuelle.
« Faites du bien à un vilain...
« Nous sommes perdus ! Les élections vont porter au pouvoir des terroristes ! Les usines fermeront toutes les unes après les autres et ils nous pourchasseront dans leur folie vengeresse, pour leur seul goût du sang et du feu ! Et s'ils ne sont pas élus, ils ruineront une à une toutes les provinces du pays, comme ils ont déjà commencé à le faire ! Ils feront de nos filles des prostituées et de nous des esclaves ! Ce sont des diables, mes amis, ne croyez pas autre chose : ce sont des diables envoyés sur terre depuis les Enfers pour écarter les hommes du salut divin !
« Il faut se débarrasser d'Andropov, d'une manière ou d'une autre. Même notre ami Anton ici présent doit en convenir.
Au plafond, je n'avais pas vu la fissure énorme juste au-dessus de la pièce du piano, entre deux moulures (une qui a une forme de serpe rouillée et l'autre d'un cyprès qui n'en finit plus, qui monte monte monte horizontalement jusqu'à l'autre bout de la pièce, jusqu'à toucher le manteau de la grosse cheminée en marbre rouge). Dans la fabrique, il y avait une fissure de la même taille, entre deux poutres métalliques, au-dessus de la tête de 60, et tous les jours, quand j'allais visser des obus, je la voyais grandir, et comme j'étais tous les jours à la même place, c'était une vie de fissure qui passait très lentement, qui ne pouvait bouger que de quelques centimètres tous les mois. Heureusement, comme la fabrique a brûlé, il n'y a plus de fissure, maintenant. Ou alors les ouvriers qui reconstruisent l'usine ont remis bien sagement une fissure au même endroit, au cas où la fabrique doive s'écrouler un jour. Ils ont raison d'être satisfaits, s'ils ont fait comme ça.
Après la cérémonie, je m'attardai un peu sur le balcon. Dedans, les invités bruissaient sans remarquer mon absence. Sur ma poitrine, la médaille d'honneur brillait aussi fort que les étoiles du ciel. Je les contemplais comme mes amies de toujours. Je connaissais chacun de leur nom. J'avais, auprès de chacune d'elle, un souvenir pendant. La récompense que vous adresse votre patrie est la plus belle que tout spationaute rêve de recevoir. Je caressais les contours émoussés du médaillon doré. Que n'avais-je pas accompli pour l'obtenir ? Quels dangers n'avais-je surmontés pour revenir sur Terre et me sentir fier d'avoir servi un dessein plus grand que le mien ?
Et pourtant, pourtant, je sentais au fond de mon coeur comme un étrange pincement. D'où venait-il ? Qui était-il ? Mon regard ne savait quitter l'infini. Et si ce séjour terrestre n'était que l'épisode le moins intéressant de mon existence ? Ne devais-je pas repartir dans moins d'une semaine pour une nouvelle mission, sur une nouvelle étoile ? Le plaisir de l'aventure vécue n'est-il pas plus essentiel que tous les honneurs terrestres ? Ne devais-je pas garder en tête l'enseignement du vieux professeur d'Osko qui affirmait que le but réel compte moins que le chemin pris pour arriver à ce but ?
J'en étais là de mes rêveries solitaires quand j'entendis des pas. Quelqu'un marchait vers moi le long du balcon, sans dire un mot. Je me retournai. Kassandra me fit face et les étoiles ne furent plus qu'un souvenir. Elle approcha sa main et caressa tendrement ma joue. Les mots qui lui vinrent alors furent pour moi une révélation. N'était-ce pas la réponse ultime à mes interrogations nocturnales ?
« Tu m'apportes la fierté immense d'avoir à aimer un héros. »
Kassandra m'apprit alors ce que Sergueï Lioubakov n'aurait jamais pu m'enseigner. Il faut vouloir aller jusqu'aux étoiles pour la plus belle récompense : le sourire d'une femme.
Comme j'ai fini mon dernier livre d'Ivanov, je sors du club Rafael pour rentrer à l'appartement m'en chercher un nouveau. Au moment de sortir, je vérifie qu'il n'y ait pas de moustache sans canne : je ne veux pas me faire enlever une seconde fois. Ce n'est pas trop gênant, mais c'est bien trop de nouveautés à assimiler en même temps, et c'est un risque de surchauffe pour mon esprit. Les rues sont vides. La seule nouveauté, ce sont les soldats avec leurs fusils postés devant chaque habitation. Au début, j'ai un peu peur qu'ils viennent frapper à ma porte, parce qu'à l'usine, quand les soldats sont arrivés, ils frappaient aux portes des habitations. Mais il faut que je prenne en compte deux éléments : la seule fois où les soldats sont venus me chercher à l'usine, je me suis marié ; à Likoutsk, les soldats sont devant les portes, mais n'y frappent pas. Je suis rassuré quand j'arrive à l'appartement d'Alexandra : aucun soldat n'a frappé à la porte pendant que je marchais dans la rue.
« Mon ami ! Je vous cherchais partout. Je viens de faire envoyer un messager au club Rafael ; vous avez dû vous croiser.
Est-ce qu'il m'apportait un livre d'Ivanov ?
« Pauvre ami, votre enlèvement vous a tellement perturbé... Il ne s'agit pas de romans, mais de la réalité. La réalité de la situation de l'usine. Vous ne pouvez pas ne pas en avoir entendu parler !
Ils n'ont pas remis la fissure dans le plafond de la fabrique ?
« Ilya est revenu avec des nouvelles effroyables. Il n'a d'ailleurs pas pu rester pour vous attendre et est reparti par le premier train pour préparer votre venue.
Ma venue ? Quand elle dit ça, je reconnais le sourire d'Alexandra, celui de sa chambre, celui de la robe jaune. Celui sans la fumée et les vapeurs d'alcool. Celui qui est inquiet, sans être heureux. Alors maintenant, comme elle me parle encore, je l'écoute.
« L'usine est encore loin d'être reconstruite. La plupart des charpentes ne sont pas posées et il reste encore de nombreux tas de cendres froides qui n'ont pas encore été évacués depuis l'incendie. Ils empuantissent toute la cour de l'usine, et jusqu'aux habitations des ouvriers qui sont couvertes d'un dépôt noirâtre – Ilya me dit que c'est la fumée qui, après être montée dans le ciel, est retombée en pluie sur toute la région pendant dix jours.
Pendant qu'elle me parle, Alexandra marche de la porte d'entrée de l'appartement jusqu'à la porte de sa chambre, ou parfois la porte de la pièce où il y a les livres. Du coup, je me souviens du pantin d'ombres dans la nuit de l'usine, dansant entre les habitations, bondissant jusqu'à la grille. Le pantin d'ombres ne danse plus. Je me dis qu'il regrette que je ne l'ai pas plus écouté pendant mon séjour à Likoutsk. J'étais plongé dans les livres d'Ivanov parce qu'ils parlaient d'espaces, mais j'avais oublié qu'avant l'espace, il y a le pays, et même l'usine. Je suis allé trop vite, et c'est de ma faute si les choses vont si mal. Il faut faire attention à l'ordre des choses : on ne visse pas un obus avant qu'il soit laminé. Comment j'ai pu oublier ça ?
« Et le retard dans la reconstruction de l'usine n'est pas encore le pire... S'il n'y avait que ça ! Le pire, m'a dit Ilya, c'est l'attitude de mon père. Il agit comme s'il voulait détruire l'usine ! Tous les jours, il envoie les soldats fouiller dans les habitations des ouvriers, à la recherche de preuves pour pouvoir les accuser de terrorisme. Et quand il ne trouve pas de preuve, ce n'est pas ça qui l'arrête et l'empêche de faire arrêter un ou deux ouvriers innocents. Il arrive même, dans ses pires accès de folie, après une colère particulièrement longue et bruyante, qu'il ordonne à l'armée de mettre le feu à un des bâtiments que les ouvriers ont construit le matin-même. Il prétend qu'ils y ont caché des armes ! Mon pauvre ami, si ce n'était que de la folie, je ne m'en ferais pas : les hommes vieillissent, rien n'est plus normal. Mais quand la folie mène à la ruine – et la ruine de notre héritage – il faut agir. Qu'ils sont dociles et courageux, ces ouvriers, de supporter un patron pareil... Alors bien sûr, ils se révoltent. Toutes les nuits, Ilya est réveillé par des affrontements entre ouvriers et soldats. Parfois, c'est un petit groupe qui tente de s'échapper dans la campagne. Parfois, c'est une troupe armée de bâtons et de tuyaux de cuivre qui marche vers la maison où mon père s'est retranché – un des seuls bâtiments encore intact. Mais hier, les ouvriers ont pris le contrôle de la fabrique et demandent la démission de mon père !
Alexandra s'arrête. Me regarde. Tremble. Picote.
Comme je suis resté immobile, avec le dernier livre d'Ivanov à la main – celui qui parle d'aller jusqu'aux étoiles pour la plus belle récompense le sourire d'une femme – je n'ai pas le temps de m'écarter quand elle me prend dans ses bras et qu'elle parle tout près de mon oreille.
« C'est le chaos qui a contaminé notre usine, Anton ! Cela n'a rien avoir avoir la révolte du pays, ni avec les élections... Il y a l'ordre, et il y a le chaos... Actuellement, le chaos s'est abattu auprès de nous. Je vous en supplie, Anton, vous seul pouvez rétablir l'ordre ! Vous seul réunissez à la fois le courage et la discrétion nécessaire à cette mission. Ilya voulait s'en charger, d'abord, mais je lui ai fait comprendre qu'il serait incapable de tuer qui que ce soit. Sa voix tremblait, le pauvre, quand il me l'a suggéré. Il n'a pas la force de caractère de ceux qui accomplissent de grandes choses. Peut-être avons-nous passé trop peu de temps ensemble, ici, à Likoutsk, mais je pense vous connaître assez pour savoir que vous ne me decevrez pas, et que la perspective d'un dangereux sacrifice ne vous fera pas peur. J'ai vu comme vous avez surmonté triomphalement l'épreuve de l'enlèvement. Vos ravisseurs vous ont relâché parce qu'ils ont senti votre force, n'est-ce pas ? Je le sais, Anton ! Je le sais : c'est à vous que doit revenir la dure tâche de chasser la folie hors de l'usine. Je sais que vous n'aurez peur à aucun moment, que tous vos muscles ne serons tendus que vers un seul but, que vous garderez l'audace contenue qui est la vôtre en toute circonstance.
Sa voix s'éloigne un peu de mon oreille et j'entends Alexandra moins fort. Ou alors elle me parle d'une voix plus basse. Elle murmure et est toujours près de mon oreille, mais je ne savais pas qu'elle savait murmurer.
« Vous prendrez le train en direction de la gare de l'usine où Ilya vous attend. Il vous exposera le déroulement exact du plan. Les ouvriers deviennent plus belliqueux chaque jour et les soldats ont autre chose à faire que de protéger le patron de l'usine. Il vous transmettra un couteau aiguisé qui appartient à mon père, pour qu'on croit à un suicide. Vous n'aurez qu'à suivre ses instructions, et tout ira bien. Maintenant, mon ami, hâtez-vous : il reste si peu de temps !
Si je devais donner un conseil à toi, lecteur, qui t'interroges sur le devenir de l'homme, écoute bien ceci, que je tiens moi-même du vieux professeur d'Osko qui t'es maintenant aussi familier qu'à moi. L'action est le meilleur remède contre le doute. Dans le doute, agis, tant que, par tes actes, tu accomplis le bien et participes au progrès de l'humanité entière. Le destin de chacun est l'avenir de tous.